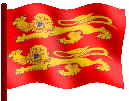-

Amélie Ermenault, chef de rubrique cuisine et décoration à www.plurielles.fr nous retrace ici l’Histoire de la baignoire.
Nous devons beaucoup des charmes et des pensées de notre civilisation à la période de l’Antiquité.
Ce sont en effet les Grecs et les Romains de l’époque qui nous ont légué les baignoires qu’eux-mêmes aimaient en pierre, en métal ou, pour les plus riches, en grès, en marbre ou en argent.
La baignoire arrive chez nous, depuis les Romains de l’Empire oriental, par l’intermédiaire des Croisés qui en ramènent le concept. Au Moyen Âge, la baignoire a été remplacée par une grosse cuve en bois qui était le plus souvent réalisée dans un simple tonneau.Mais il serait injuste d’attribuer aux mœurs du Moyen Âge l’abandon de la baignoire !
Les gens allaient souvent aux étuves pour prendre des bains publics et ce n’est que par la suite que ces endroits sont devenus des lieux de débauche et de pauvres.
Véritables nids à microbes et à maladies, ces bains publics sont fermés.
On préfère aux bains désormais les ablutions.
Seuls les riches du XVIe siècle offrent des bains privés à leurs invités et en font un cérémonial des sens à grand renfort d’huiles et d’encens !
Les bains et baignoires sont délaissés et Louis XIV, s’il est célèbre pour avoir été un grand roi, l’est aussi pour ne jamais prendre de bain. Il faut dire que l’époque le voulait ainsi : on ne s’essuyait les parties visibles du corps qu’avec un linge sec.
Ouf, Louis XVI remet à la mode les salles de bains et les baignoires en cuivre. Jusqu’au XIXe siècle, moment où l’hygiène devient plus exigeante, on se baigne encore dans les rivières.Les bains publics ouvrent à nouveau et les bains médicamenteux se développent en même temps que les stations thermales.
C’est seulement à partir du deuxième tiers du XXe siècle que les salles de bains et baignoires se démocratisent et que les maisons commencent à en abriter.
http://www.ma-baignoire.com/tag/au-moyen-age/
-
Les gens du Moyen âge ne se lavaient pas
D'où vient cette idée reçue ?
Il semblerait que les coupables soient une fois de plus les auteurs républicains du XIXe siècle, dont l'objectif inavoué était de "noircir" l'époque médiévale afin de glorifier la république.
Ces derniers, outre le mythe d'un Moyen âge crasseux, élaborèrent d'autres fariboles tout aussi ridicules,
telles que "le droit de cuissage".
Histoire de l'Hygiène au moyen âge
L'hygiène n'est pas un bienfait des temps modernes.C'est un art qui connut ses heurs et malheurs.
Un art que le siècle de Louis XIV méprisa mais que le Moyen Age, en dépit de sa mauvaise réputation, cultivait avec amour. L'eau était alors un élément sacré, un remède, et surtout, un immense plaisir.
On pourrait imaginer, à en juger par le manque de propreté corporelle qui caractérisait les moeurs, il n'y a pas si longtemps encore, que les hommes et les femmes du Moyen Age ne prenaient guère soin de leur corps ; et on pourrait croire que l'hygiène -l'art de bien se porter est une notion récente.
C'est injuste ! Le Moyen Age avait inventé l'hygiène, et bien d'autres civilisations avant lui... Mais là n'est pas notre sujet.En tout cas, dès le 12e siècle, les sources qui nous révèlent que l'eau faisait partie du plaisir de vivre sont innombrables.
Et notamment certains documents tels que les traités de médecine, les herbiers, les romans profanes, les fabliaux, les inventaires après décès, les comptes royaux et princiers.
Les enluminures des manuscrits nous permettent également de saisir le geste de l'homme en son environnement et en son temps.
L'enluminure, ou miniature, reste le document irremplaçable, dans la mesure oÙ la gestuelle correspond bien souvent au climat psychique ou moral de l'époque qu'elle dépeint ; elle nous livre ainsi une clef parmi d'autres des mentalités de ces hommes et de ces femmes du passé.Comme nous allons le voir, on se lavait fréquemment, non seulement pour être propre, mais aussi par plaisir. Le petit d'homme est lavé plusieurs fois par jour, ce qui ne sera plus le cas à partir du 16e siècle. Des milliers de manuscrits illustrent ce bain et de nombreux textes en parlent.
Ainsi, Barthélemy l'Anglais, Vincent de Beauvais, Aldébrandin de Sienne, au 13e siècle, par leurs traités de médecine et d'éducation, instaurent une véritable obsession de la propreté infantile.
Le bain est donné "quand l'enfant ara assez dormi, ci le doit-on laver trois fois par jour". Les cuviers sont bâtis aux dimensions d'un nouveau-né allongé ; généralement ils sont ovales ou circulaires, faits de douelles de bois. Dans les milieux princiers, ils peuvent être métalliques.Ainsi, dans les Chroniques de Froissart, en 1382, il est écrit que, en pillant le mobilier du comte de Flandres, on trouva une "cuvelette où on l'avait d'enfance baigné, qui était d'or et d'argent". Certains cuviers possèdent un dais, sorte de pavillon de toile nouée au sommet d'une perche de bois qui surmonte la cuve, afin de protéger l'enfant des courants d'air ; ce raffinement est réservé aux milieux aristocratiques.
Dans la plupart des miniatures, on voit toujours la mère ou la servante tâter l'eau avant d'y tremper l'enfant car elle doit être "douce et de moyenne chaleur".On ne donne pas le bain à l'enfant sans prendre quelques précautions : le cuvier est placé devant la cheminée où flambe un bon feu ; la sortie de bain est assez grande pour bien envelopper le bambin. Elle est toujours à fond blanc même si, parfois, des rayures et des franges l'agrémentent.
Un moment important de la journée : le bain de l'enfant. La servante vérifie de la main la température de l'eau, qui doit être "douce et de moyenne chaleur". Fresque de Menabuoi, Padoue, baptistère.La fréquence des bains s'explique par les valeurs curatives qu'on leur attribue."On le baigne et oint pour nourrir la chair nettement", dit Barthélemy l'Anglais, auteur du Livre des propriétés des choses qui fut diffusé jusqu'au 17e siècle avant de sombrer dans l'oubli. A l'instar des coutumes de l'Antiquité, le premier bain de la naissance est un rite de reconnaissance par la communauté familiale.
A l'époque chrétienne, on peut dire que le baptême de l'enfant nouveau-né a repris à son compte la gestuelle de l'hygiène néonatale à cette différence près qu'il s'agit de débarrasser l'enfant non plus de ses mucosités, mais du péché originel. De toute façon, que l'usage en soit symbolique ou matériel, l'eau est considérée sous l'aspect bienfaisant et purificateur.
A l'âge adulte, les bains semblent tout à fait intégrés à la vie quotidienne, surtout à partir du 14e siècle.

Dans les centres urbains, au bas Moyen Age, chaque quartier possédait ses bains propres, avec pignon sur rue. Il était plus facile, pour la plupart des gens, d'aller aux étuves que de se préparer un bain chaud chez soi.
Au point du jour les crieurs passaient dans les rues pour avertir la population que les bains étaient prêts : " Seigneurs, venez vous baigner et étuver sans plus attendre... Les bains sont chauds, c'est sans mentir " (fin du 13e siècle). Le souvenir de l'importance des étuves dans les moindres villes d'Europe subsiste encore, aujourd'hui, dans le nom de certaines rues.
A Paris, en 1292, la ville compte 27 étuves inscrites sur le Livre de la taille ; elles existaient avant cette date puisque Saint Louis essayait déjà de réglementer le métier en 1268. On ne sait pas exactement à quel moment se sont créés les premiers bains. Seraientils un avatar des thermes romains ? On sait qu'à l'époque carolingienne, les palais renfermaient des bains, ainsi que les monastères.

Il semble cependant plus vraisemblable que la mode des bains ait été remise en honneur en Occident par l'intermédiaire des croisés, qui avaient découvert avec émerveillement l'Empire romain d'Orient et ses habitudes d'hygiène héritées de l'Antiquité romaine.
Ayant pris goût à la relaxation du bain, ils rapportèrent en Occident cette pratique de bien-être. Aux 14e et 15e siècles, les étuves publiques connaissent leur apogée : Bruxelles en compte 40, et il y en a autant à Bruges. Bade, en 1400, en possède une trentaine.
En France, en dehors de Paris, on sait, grâce à des études faites par J. Garnier et J. Arnoud, que Dijon, Digne, Rouen, Strasbourg sont équipées de bains. Une petite ville comme Chartres en a cinq.
Ces établissements sont extrêmement florissants et rapportent beaucoup d'argent. Dans plusieurs villes de France, certains d'entre eux appartiennent au clergé ! A l'origine d'ordre essentiellement hygiènique, il semble qu'au fil des ans cette pratique ait pris un caractère plaisant prétexte à toutes sortes d'agréments galants. Etuves publiques.
Des couples, après avoir festoyé autour d'une table, installée dans un imense cuvier rempli d'eau, se dirigent vers les chambres à coucher.La prostitution, malgré les nombreux édits qui l'interdisent, sera l'une des causes de la disparition progressive des étuves.
Manuscrit de Valerius Maximus.

Bains chauds, bains tièdes et bains de vapeur
Au 13e siècle, on se contentait de s'immerger dans de grandes cuves remplies d'eau chaude.A la fin de ce siècle seulement, semble-t-il, apparaissent les premiers bains saturés de vapeur d'eau.
En 1258, Etienne Boileau, prévôt de Paris sous Saint Louis et auteur du Livre des métiers, qui codifie les usages corporatifs, fait déjà la différence entre les bains et les étuves dites sèches et humides.
Il y avait deux manières pour créer de la vapeur dans un lieu clos :
chauffer celui-ci soit par l'extérieur, en envoyant un courant d'air chaud
(étuve sèche),
soit en y faisant pénétrer la vapeur d'eau (étuve humide).
Les prix des bains d'eau chaude et des étuves n'étaient pas les mêmes. A Paris, nous savons, par l'ordonnance des métiers de 1380, que le prix du bain de vapeur est de deux deniers, celui du bain d'eau tiède de quatre deniers ; mais s'estuver et se baigner coûte huit deniers.Si deux personnes vont ensemble au bain, elles paieront douze deniers pour s'estuver et se baigner, donc moins cher.
Le bain de vapeur est économique parce qu'il ne nécessite que quelques pierres placées et un seau d'eau.A cela, il faut ajouter un denier pour un drap.
A titre comparatif, rappelons que, à la même époque, une grosse miche de pain se vendait un denier.
L'établissement thermal de Pouzzoles, en Italie. Sur la gauche, la cabine de déshabillage; sur la droite, la piscine collective.Là aussi, hommes et femmes prennent le bain ensemble.
Les eaux sont un lieu de cure mais aussi de rencontre, comme elles le seront au XIXè siècle. Manuscrit de Pierre d'Eboli.
Les étuviers sont constitués en corps de métiers, et leurs prix sont fixés par le prévôt de Paris. Il leur incombe d'entretenir leurs étuves : dans leurs statuts, il est écrit que "les maîtres qui seront gardes du dit métier, pourront visiter et décharger les tuyaux et les conduits des étuves, et regarder si elles sont nettes, bonnes et suffisantes, pour les périls et les abreuvoirs où les eaux vont".Cet édit est très intéressant, dans la mesure où il nous prouve qu'on avait tout à fait conscience, au Moyen Age, des dangers qu'une eau polluée pouvait faire courir à la population.
Les statuts interdisaient d'accueillir les malades, principalement les lépreux, mais aussi les prostituées. Déjà, dans le règlement de Saint Louis, en 1268, ce sujet est abordé : "Que nul du dit mestier ne soutienge en leurs étuves, bordiaux de jour et de nuit."Cela démontre bien que, déjà à cette date, les bains commençaient à attirer les débauchés. Il est bien évident qu'au début les gens y allaient pour se laver et se relaxer.
On n'ignorait pas le côté prophylactique des bains ; tous les médecins répétaient que cette pratique aidait à se conserver en bonne santé, et cela dès le 1le siècle : Aldébrandin de Sienne, dans son traité de médecine, écrit :
"Li baigners en eau douce fait en étuve et en cuve, et en eau froide, fait la santé garder."
Si l'eau est froide, il faut être prudent et ne pas y séjourner trop longtemps, juste le temps nécessaire pour renforcer et stimuler la chaleur interne. Mais pour nettoyer correctement le corps, seul le bain chaud peut "expulser l'ordure que la nature cache par les pertuis de la chair".
Baignoire médiévale. Musée de Cluny. Photo de LYDIA
(http://notabene.forumactif.com/t7981-l-hygiene-au-moyen-age)
Barthélemy l'Anglais, au 13e siècle, conseille, lui aussi, de se laver souvent la peau, les cheveux et la bouche. Il y a tout un environnement social qui pousse les gens, surtout en ville, à prendre soin de leur corps.De plus, les produits de toilette ne manquaient pas.
Le savon existait - à Paris, un décret de fabrication rend obligatoire l'apposition d'un sceau sur le savon.
Si on n'avait pas de savon on se servait de plantes, comme la saponaire, une herbacée à fleur rose et odorante dont le suc, dissous dans l'eau, mousse.Il y avait trois sortes de savon :
le gallique, le juif et le sarrasin, selon qu'il était fabriqué avec de l'huile ou de la graisse animale mélangée à de la potasse.
Dentifrice, shampooing et déodorant
Se laver la tête ne pose pas plus de problème.Un herbier du 13e siècle conseille le jus de bette pour éliminer les pellicules et les feuilles de noyer ou de chêne pour obtenir une belle chevelure.
Dans ce même herbier, on préconise, pour éviter la "puanteur" de s'arracher les poils et de laver les aisselles avec du vin, associé à de l'eau de rose et à du jus d'une plante appelée casseligne.
Pour se blanchir les dents, il faut se les frotter avec du corail en poudre ou de l'os de seiche écrasé.
Bref, tant que les établissements de bain étaient modestes, on y allait pour se laver, bien sûr, mais aussi pour discuter, retrouver ses amis. Encore au début du 12e Siècle, la simplicité un peu rude des moeurs faisait que l'on ne voyait pas malice à se mettre nu et qu'on s'accommodait très bien d'une liberté des sens que notre propre morale réprouverait aujourd'hui.
On prenait les bains en commun, et nus. Ne dit-on pas que saint François d'Assise (1180-1226) prêcha nu devant ses fidèles, en signe de dépouillement ! Aurait-on pu imaginer cela un siècle plus tard ?Baignoires, tables bien garnies, chambres à coucher, tout est en place pour le plaisir des sens.
Avec la croissance des villes, due à la reprise économique en Europe, les étuves deviennent de grands établissements et les coutumes changent.
La ville attire de plus en plus d'étrangers et de vagabonds, et la prostitution se développe.Les bains sont mis sous la surveillance de chirurgiens-barbiers. J. Garnier nous propose une bonne description d'un établissement de la rue Cazotte, à Dijon, au 14e siècle.
D'abord, un rez-de-chaussée sur cave où on plaçait deux énormes fourneaux en brique (en airain, dans les maisons princières).Ce rez-de-chaussée était divisé en deux grandes pièces avec une antichambre commune.
La première pièce est une vaste salle de bain, possédant en son milieu une spacieuse cuve en bois et, sur les côtés, de nombreuses baignoires en bois pour une ou deux personnes.
La seconde pièce est la salle d'étuve, rappelant le laconicum romain (pièce la plus chaude), dont le plafond est constitué par une massive maçonnerie se terminant en coupole, percée de trous au travers desquels s'échappe l'air chaud. Autour, des sièges et des gradins pour se relaxer.Aux étages supérieurs, des chambres à coucher, ce qui favorisait la prostitution.
"On oyait crier, hutiner, saulter..."
Parmi les miniatures représentant ces pratiques, peu nous montrent l'aspect purement hygiénique.Deux miniatures issues du manuscrit La Bulle d'or de Charles IV, roi de Bohême (fin du 14e siècle) l'illustrent cependant :
on voit le roi Venceslas en train de se faire laver les cheveux par une servante ou fille de bain, charmante personne tout à fait plaisante dans sa robe transparente.
Le signe de profession de ces jeunes femmes étaient le houssoir (plumeau à crins ou à plumes) qui servait à frotter le client ou la cliente, et aussi le baquet d'eau chaude pour laver les têtes.
Etuves publiques.Ici les cuviers sont plus raffinés, réduits à la dimension d'un couple et garnis d'un baldaquin. sur la gauche une jeune femme semble se défendre contre les avances d'un barbon.
Manuscrit de Valerius Maximus.Les autres miniatures, plus tardives
(15e siècle) révèlent principalement le côté libertin.
La plupart ornent les nombreux manuscrits de Valerius Maximus.Dans ces petits tableaux, qui nous dévoilent l'ambiance dans ces étuves, tous les objets sont en place pour le plaisir des sens.
Dans les grandes cuves se tiennent des couples nus, auxquels on sert de véritables festins ; les servantes s'affairent autour d'eux, chargées de collations.
Toutes ces miniatures montrent à peu près les mêmes scènes - tables bien garnies dressées à l'intérieur d'immenses cuviers et couples enlacés, assis autour de la table, toujours à l'intérieur du cuvier, et se caressant sans aucune retenue.
On aperçoit parfois les chambres à coucher où les couples vont prendre leur divertissement.

La scène la plus étonnante représente le moment où, après avoir bien festoyé, les couples se lèvent de table, se tenant par la main, à la recherche d'une chambre libre pour leurs ébats.Quelquefois, dans l'encadrement d'une porte, on remarque la présence de deux chirurgiens barbiers occupés à surveiller.
Les règlements qui répètent avec obstination, surtout à partir de la moitié du 14e siècle, que l'accès aux bains doit être interdit aux bordiaux semblent bien inefficaces.
Au début du 15e siècle un grand nombre d'étuves commencent à instaurer la séparation des sexes ; ainsi à Dijon, en , une ordonnance prescrit que, sur quatre étuves, deux seront réservées exclusivement aux femmes et deux autres, exclusivement aux hommes,sous peine d'avoir à payer une amende de 40 sols.

En 1412, une autre ordonnance décide que les étuves seront réservées aux femmes le mardi et le jeudi, et aux hommes le mercredi et le lundi.Les autres jours, les vendredi, samedi et dimanche, les étuves se transforment en lieux de plaisirs en tout genre.
Cette seconde ordonnance démontre bien que la juridiction du pouvoir municipal, à laquelle étaient soumises les étuves, avait du mal à faire appliquer ses décisions et était obligée de tergiverser.
Cependant, à la fin du 15e siècle, les procès se multiplient ; le voisinage supporte de plus en plus mal la présence de "baigneries".On peut lire dans les minutes du procès intenté à Jeanne Saignant, maîtresse des étuves, cette phrase :
"On oyait crier, hutiner, saulter, tellement qu'on était étonné que les voisins le souffrissent, la justice le dissimulât, et la terre le supportât."
Beaucoup d'étuves étaient en même temps des bordels,
mais ce n'était pas là un phénomène récent.

On peut donc se demander pourquoi, soudain, on cesse de le tolérer.Alors qu'on sait que, en pleine épidémie de peste, au milieu du 14e siècle, un médecin parisien nommé Despars faillit être lapidé par le peuple, pour avoir conseillé de les fermer par prudence...
Lorsqu'on sait, aussi, qu'en 1410 la reine de France récompensait les artisans travaillant pour elle en leur offrant un "abonnement" aux étuves.
La fermeture des étuves s'explique-t-elle par l'apparition de la syphilis qui touche le monde occidental ?Par le trop grand nombre d'étrangers qui envahissent la ville et que les autorités de la cité n'ont plus les moyens de contrôler, notamment dans les lieux publics, où ils sèment l'agitation ? Ou par un retour à la moralisation des moeurs, la notion de péché envahissant de plus en plus les consciences en cette fin de siècle ?

Pique-niques sur tables flottantes
Une miniature du début du 16e siècle illustre une scène où des prostituées se lavent en attendant le client.L'aspect ludique a disparu ; ici l'eau n'est plus source de plaisir, mais moyen d'hygiène banal :
les cuviers sont de dimensions si réduites qu'on ne peut s'y laver que les pieds ou les cheveux. Finis les bains d'immersion, voici venue l'ère des ablutions.
Le temps des " bordiaux ", où les prostituées et les clients s'aspergeaient copieusement, est bel et bien révolu.On l'a déjà dit, l'eau n'est pas réservée au seul plaisir. On est convaincu, dès le 11e siècle, qu'elle a des vertus thérapeutiques.
Dans tous les traités de santé du temps, on vante les bienfaits des eaux thermales.L'établissement thermal de Pouzzoles, en Italie : le bain de vapeur.
Un curiste est allé chercher de l'eau avec une amphore préalablement chauffée sur les pierres brulantes disposées sous le plancher.
Déjà Galien, au 2e siècle après Jésus Christ, avait décrit les bienfaits des cures thermales, pour la santé.
On commence à les redécouvrir grâce à la venue d'empereurs comme Frédéric de Hohenstaufen en Italie, grands amateur d'eaux.
Le poète Pierre d'Eboli, attaché à la cour de Frédéric, au début siècle, en chante les louanges, et la plupart des miniatures que nous possédons proviennent des manuscrits représentant les thermes et les curistes.
L'eau bouillante qui pugnest les morts Je vous di que celle meisme Malades vifs rent saints et fors Vous qui n'avez denier ne maille Et qui voulez estre garis Garis serez aus bains...
Ce sont principalement les sources de Pouzzoles, de Cumes, et Baïes en Campanie, qui sont vantées, pas seulement par Pierre d'Eboli mais aussi par Barthélemy l'Anglais ; ces miniatures nous montrent les piscines et le comportement des curistes.On y voit aussi les cabines de déshabillage. Selon les textes, hommes et femmes prenaient ensemble leur bain, mais les images ne sont guère révélatrices. En 1345, aux bains de Prorecta, il est conseillé de rester un jour sans se baigner pour s'habituer à l'air du pays et se reposer des fatigues du voyage.
Puis le malade doit passer au moins une heure dans le bassin de pierre empli d'eau tiède, avant de boire, jusqu'à ce que le bout des doigts se crispe.Ce bain ne fatigue nullement, au contraire ; il mûrit les humeurs diverses dans tout le corps et les prépare à être évacuées.
Nous avons un témoignage assez étonnant sur les bains de Baden, écrit par Le Pogge, humaniste italien, en 1415. Au centre de cette ville d'eau, "se trouve une place très vaste, entourée de magnifiques hôtelleries dont la plupart possèdent leur piscine particulière. Dans les bains publics s'entassent, pêle-mêle, hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles, et tout le fretin environnant.
Dans les piscines privées hommes et les femmes sont séparés par une cloison, criblée de petites fenêtres qui permettent aux baigneurs et aux baigneuses de prendre ensemble des rafraîchissements, de causer et, surtout, de se voir. Le costume des hommes consiste en un simple caleçon et celui des femmes en un léger voile de lin ouvert sur les côtés, qui ne voile d'ailleurs ni le cou, ni la poitrine, ni les bras".D'après ce témoin, les femmes faisaient souvent "ces repas en pique-nique, servis sur des tables flottantes, dans les bassins, auxquels les hommes sont invités".
On peut imaginer qu'il y avait dans ces lieux de véritables malades, mais surtout des gens bien portants qui venaient là pour conserver la santé d'autant plus que ces eaux chlorurées sodiques sont excellentes, de toute manière, et aussi pour se divertir, pour y trouver des moments de détente et de bonheur, enfin pour y faire des rencontres.Une baigneuse (nue mais toujours coiffée). "Miséricorde" (petite console en bois sculpté placée sous la sellette à abattement d'une stalle de choeur) de Villefranche-de-Rouergue.
En France aussi, à la même époque, les stations thermales sont très fréquentées. Ainsi Flamenca, roman du 13e siècle, fait état des bains de Bourbon-l'Archambault aux vertus bienfaisantes.
"Il y avait de nombreux établissements où tous pouvaient prendre des bains confortablement. Un écriteau, placé dans chaque bain, donnait des indications nécessaires. Pas de boiteux ni d'éclopé qui ne s'en retournât guéri.On pouvait s'y baigner dès qu'on avait fait marché avec le patron de l'hôtel, qui était en même temps concessionnaire des sources.
Dans chaque bain jaillissaient de l'eau chaude et de l'eau froide.
Chacun était clos et couvert comme une maison, et il s'y trouvait des chambres tranquilles où l'on pouvait se reposer et se rafraîchir à son plaisir."
Le seigneur du lieu, le compte d'Archambault, mari jaloux, fréquente ces lieux, puisqu'il y amène son épouse pour la distraire et qu'il reste en faction devant la porte pour la surveiller. Il est vrai qu'il la conduit dans l'établissement le plus cher et le plus luxueux de la ville afin qu'elle recouvre prétendument la santé...Pour elle, il est ordonné de laver soigneusement la cuve et d'y renouveler l'eau. Ses servantes y apportent les bassins, les onguents et tout ce qui est utile au bain.
Grâce à ce roman, on apprend que les hôteliers exagèrent toujours leurs prix et qu'il faut souvent marchander. Les plus belles chambres sont " à feu ", et fort bien décorées.A la fin du 15e siècle ce qui était purification devient souillure, et le bain un danger pour l'âme comme pour le corps.
Les stations thermales, on l'a dit, attirent une clientèle variée. Mais il semble que beaucoup de curistes venaient s'y régénérer, dans l'espoir d'une nouvelle jeunesse.Ce mythe de la fontaine de jouvence, souvent attesté par les manuscrits des 14e et 15e siècles, parcourt toutes les civilisations et le lien entre les vertus médicinales et la vertu fécondante de l'eau explique ces cérémonies religieuses au cours desquelles on plonge la Vierge Marie dans un bain rituel, pour la régénérer.
Au Moyen Age, on immergeait aussi les saints, le Christ.
Cependant, à la fin du 15e siècle, se profile un changement complet dans les mentalités, qui s'étalera sur plusieurs siècles.
L'eau estime-t-on - est responsable des épidémies et des maladies, croyance non dénuée de fondement en cette fin de Moyen Age où les tanneurs, les teinturiers, les bouchers jettent leurs déchets dans les rivières et les polluent.
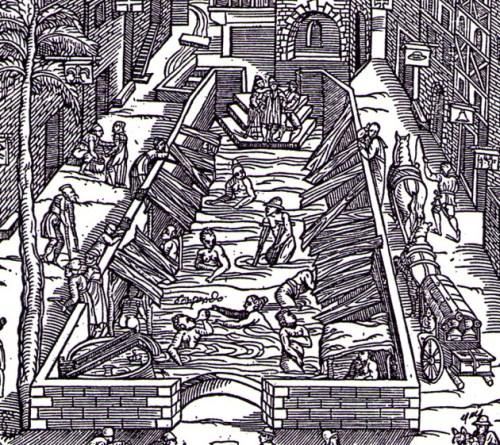
Extrait de l’édit du Duc de Lorraine à l’entrée du grand bain (XVIe siècle) :
Description du grand bain par Montaigne, en 1580 :
« …Il y a plusieurs beings, mais il y en a un grand el principal, basti en forme ovalle d’une antienne structure. Il a trente cinq pas de long et quinze de large. L’eau chaude sourd par le dessoubs à plusieurs surgeons, et y fait-on par le dessus escouler de l’eau froide pour modérer le being selon la volonté de ceux qui s’en servent. Les places y sont distribuées par les costés avec des barres suspendues, à la mode de nos équiries, et jette on des ais par le dessus pour éviter le soleil et la pluye. Il y a tout autour des beings trois ou quatre degrés de marches de pierre à la mode d’un théâtre, où ceux qui se beingnent peuvent estre assis ou appuyés. On y observe une singulière modestie, et si est indécent aux hommes se s’y mettre autrement que tout nuds, sauf un petit braiet, et les fames sauf une chemise ».
Par réaction, les médecins commencent à penser que le bain lui-même est malfaisant pour le corps, que les miasmes de la nature pénètrent d'autant plus facilement à l'intérieur du corps, que les pores sont dilatés sous l'effet de la chaleur, laissant un libre passage aux maladies. Plus question de chanter les louanges du bain : il faut se méfier de l'eau et n'en user que très modérément.Dans un tel climat, ne subsisteront des pratiques antérieures que celle des pèlerinages aux sources guérisseuses, en tout cas en France.
L'Allemagne, en effet, ne se privera pas totalement du recours à ses bains.
Cette disparition de l'hygiène dans notre pays va de pair avec une évolution de l'Eglise romaine, qui tend de plus en plus vers une rigidité morale niant le corps.L'ère de la crasse commence, et elle durera jusqu'au 20e siècle.
SOURCES :Madame Monique CLOSSON
- lien http://medieval.mrugala.net/Bains/Bains.htm
photos google
-

ORIGINE DES NOMS DE FAMILLE
Origine des noms de famille
Il convient avant tout de définir la notion de nom. Les noms sont divisés en deux ensembles distincts.Les premiers à apparaître dans l'histoire de l'anthroponymie sont les noms individuels, répartis en trois sortes :
- Les prénoms (ou noms de baptême) sont ceux que l'on a reçus à la naissance ; on peut en posséder un ou plusieurs.
- Les surnoms (ou sobriquets) sont ceux que l'on peut recevoir au cours de sa vie.
Les surnoms.
Les surnoms constituent la catégorie de base des noms de famille. S'ils peuvent être facilement confondus avec les surnoms dits « physiques » ou « moraux », ou encore les « sobriquets », ils étaient motivés par un trait marquant de l'individu qui se trouvait ainsi nommé sans ambiguïté, dans le cercle restreint de son village et de ses proches.C'est ainsi, par exemple, que deux personnes ayant le même nom de baptême, se verront distinguées par l'attribution d'un adjectif qui, au fil des évolutions, deviendra son nom de famille. Par exemple, si deux personnes d'un même village portent le nom de Bernard, on attribuera à l'un des deux un nom faisant référence soit à une de ses qualités propres, soit à son lieu d'habitation. Le nom ainsi donné sera alors Petibernard ou Bernarmont.
Les surnoms peuvent également désigner une expression employée fréquemment. Ainsi, un homme répétant souvent « par la grâce de Dieu » se verra appelé Pardieu.
Nous allons poursuivre en évoquant ci-dessous différentes formes de surnoms utilisés pour caractériser leurs porteurs : les noms de lieux, les noms « d'état », les noms de métiers, les sobriquets, puis les surnoms moraux et physiques.
Les noms de lieux :
Au Moyen-Âge, pour différencier les personnes (nobles et roturiers) qui n'avaient qu'un nom de baptême, on les surnommait souvent du nom de leurs terres d'origines. C'est à cette époque que des noms comme Duhamel (« le hameau »), Dumas (« la ferme ») ou Castel (« le château ») virent le jour.A l'heure actuelle, les noms de lieux constituent une grande partie des noms de famille. Ils font référence à deux types de lieux:
-
Les lieux-dits :
Ce sont des noms empruntés aux domaines dont la propriété passait d'une génération à une autre au rythme des héritages. Parmi les porteurs de ces noms, il en est beaucoup qui ne possèdent plus les domaines correspondants. Pourtant, il n'est pas rare de retrouver certains porteurs de noms de lieux non loin de l'endroit en question.
-
La provenance :
Ces noms désignaient les lieux proches du domicile d'un individu (route, chemin, source, cours d'eau, marécage, toponymie alpine, monastère, chapelle, etc.), ou les régions d'origine de nouveaux habitants (hameau, village, ville, région, pays, etc.).
Il pouvait s'agir, par exemple, d'une personne vivant près d'un pont (Dupont, Dupontet, Dupontel etc.), ou venant d'Auvergne (Lauvergne, Larverne, Larvergne etc.).
Mais on désignait également l'individu par un terme rappelant la caractéristique de sa maison : Kergoat (« maison en bois »), Piarresteguy (« demeure de pierre »).
Les noms dit « d'état » :
Cette catégorie regroupe des noms issus des fonctions occupées par les personnes auxquelles ils ont été attribués.Ils apparaissent en France à partir du XIIème siècle, époque à laquelle la vie sociale prend une véritable place en France. C'est en effet la période où naît la petite bourgeoisie englobant les artisans, les petits commerçants, ainsi que toutes les professions issues de la fonction publique. Les avocats et les religieux, jusqu'alors au service de la noblesse, se mettent a côtoyer cette bourgeoisie génératrice de développement économique.
Les porteurs de ces noms n'exerçaient pas forcement cette profession. En effet, le maître dont ils dépendaient transmettait a ses serviteurs son nom générique.
La quasi totalité de ces noms révèlent une caractéristique liée a la vie sociale (Ex. : Avoyer « Avocat », Chevalier, Maréchal, Prévosts, Clerc, Abbey, Évêque).
Il est a noter que ces noms se retrouvent sur l'ensemble du territoire français, avec dans certains cas des modifications orthographiques liées au changement de région, le sens ne changeant guère.
De part leur spécificité ces noms sont les plus rares en France.
Les noms de métiers :
Entre le Vème et le Xème siècle, les habitants de la France ne portaient que leurs noms de baptême. A partir du XIIème siècle, pour différencier les homonymes devenus trop nombreux, certains noms de métiers furent adoptés pour désigner les individus.C'est plus tard, au hasard d'un acte de baptême, de mariage ou de sépulture que les noms de métiers sont devenus héréditaires, se transformant en nom de famille.
Il est a noter, que ces noms relèvent plutôt d'une origine citadine. En effet, c'est dans les bourgs et dans les lieux de foires que l'on retrouve le plus souvent artisans et négociants. Voici quelques exemples de noms de métiers : Couturier, Fournier, Lefebure, Barbier, Wagner (charron), Schumacher (cordonnier), Mitterand (le mesureur).
Les sobriquets :
Il est assez difficile de bien repérer un nom répertorié comme « sobriquet ». Ces noms sont en effet des déformations humoristiques ou fantaisistes. Cependant, ils peuvent également exprimer une caractéristique morale ou physique, sans pour autant devoir être considérés comme des noms dits « à caractère physiques ou moraux ».Ils ne sont pas forcément péjoratifs, mais expriment plutôt une particularité chez un individu. Ce dernier, une fois dénommé par ses pairs, créait sa propre famille autour de ce nom.
Ces noms sont apparus au Moyen-Âge et sont dans bien des cas des adjectifs. Par exemple : Bachelard (« jeune garçon a marier »), Gagnebin (« qui sait gagner de l'argent »), Lesot (« celui qui ramenait l'eau »), Couard (« désignait un homme peureux »), Romeu (rappel le pèlerinage d'un individu à Rome), Lesoldat, etc.
Les surnoms « moraux » :
Les noms dits « moraux » sont apparus en France aux alentours du XIIème siècle. Ils désignaient les personnes qui se distinguaient par leurs qualités ou leurs défauts : Vaillant, Hardy (« homme brave »), Doucet (« homme gentil », « doux »), Lesage (« homme savant »), Agassi (« celui qui jacasse »).Les animaux servaient aussi de référence pour qualifier les surnoms moraux : Renard (« le rusé »), Chevrier (« chèvre », désignait un homme leste, agile), Cocteau (« coq », désignait un homme vaniteux, orgueilleux, querelleur).
Les surnoms « physiques » :
Les noms a caractéristique « physiques », sont apparus en France, comme d'autres types de noms, aux alentours du XIIème siècle.Ces noms de famille étaient donnés aux personnes qui présentaient une particularité physique apparente permettant de les distinguer. Ces particularités étaient bien souvent en rapport avec la morphologie.

- Les pseudonymes sont ceux que l'on se donne soi-même, pour une raison ou pour une autre.
Les noms individuels sont attachés aux personnes qui les portent.
Ils disparaissent à leur mort sans être transmis à qui que ce soit.
Apparus plus tardivement, les noms collectifs sont ceux qui nous intéressent ici ; il s'agit des noms de famille.
A l'heure actuelle en France, ils sont généralement uniques et demeurent héréditaires.
Afin d'avoir une idée précise du parcours du nom de famille, de ses origines à sa forme actuelle, plusieurs point sont à étudier. Dans un premier chapitre, l'histoire du concept d'identification d'une personne par un nom qui lui est attaché sera évoquée.
Dans un deuxième temps, l'origine linguistique des noms fera l'objet d'une étude regroupant les origines des noms français, les origines spécifiques à certaines régions et les noms étrangers.
Enfin, nous verrons les différents types de noms de famille : ceux formés à partir de prénoms, de surnoms, ceux exprimant la parenté et ceux d'origines incertaines, pour terminer en évoquant le cas des noms à particule.
I - HISTOIRE DES NOMS DE FAMILLE
Dans la plupart des civilisations antiques, un seul nom servait à désigner l'individu. Ce nom restait attaché à la personne de sa naissance à sa mort, sans être toutefois héréditaire.
Seuls les Romains utilisaient un système de trois noms :
le prénom, le gentilice (nom du groupe de familles) et le cognonem (surnom, devenu nom de famille).
Cependant, les gens du peuple ne portaient en général que deux noms : le prénom et le cognonem.
Avec l'expansion romaine, le système à trois noms s'est étendu sur tout l'Empire et notamment la Gaule.
Les invasions barbares du Vème siècle détruisent l'Empire romain d'Occident et font disparaître le système à trois noms de la Gaule.
En effet, les populations adoptent alors la coutume des vainqueurs, qui était la leur avant l'arrivée des Romains.
Il ne portent désormais qu'un nom individuel, qui ne se transmet pas d'une génération à l'autre.
Ce système va perdurer jusqu'au Xème siècle.
C'est en effet au Xème siècle que le processus de création des noms de famille s'amorce. Face aux problèmes engendrés par un trop grand nombre d'homonymes, le nom individuel est peu à peu accompagné par un surnom. Avec l'usage, ce surnom tend à devenir héréditaire.
Ce phénomène se rencontre d'abord parmi les famille nobles, puis s'élargit à l'ensemble de la population à partir du XIIème siècle.
A partir du XVème siècle, un long processus de fixation des noms de famille s'amorce. Par ailleurs, le pouvoir politique s'intéresse à la question et réglemente progressivement l'existence des noms de famille.
En 1474, Louis XI interdit de changer de nom sans une autorisation royale.
En 1539, François Ier promulgue l'ordonnance de Villers-Cotterêt.
Celle-ci rend obligatoire la tenue de registres d'état-civil.
Cette tâche est confiée aux curés, le Clergé constituant la seule « administration » présente dans tout le royaume.
En fait, la décision royale officialise et généralise une pratique déjà en usage depuis le siècle précédent, principalement dans les villes.
Avec la Révolution française, la tenue de l'état-civil quitte le cadre de le paroisse. Elle passe désormais dans les attributions de l'État et se fait à la mairie de chaque commune.
La loi du 6 fructidor de l'an II (23 août 1794) interdit de porter d'autre nom et prénoms que ceux inscrits à l'état-civil.
Cependant, le Conseil d'État peut autoriser un changement de patronyme (ils sont actuellement environ 800 par an).
En 1870, l'apparition du livret de famille fige définitivement l'orthographe de tous les patronymes.
II – ORIGINES DES NOMS DE FAMILLE
Les noms existants en France sont liés aux origines de la population française, formée par les colonisations, les invasions et l'immigration. Chacun a apporté avec lui sa propre langue et donc ses propres noms.
En effet, l'onomastique est étroitement liée à la linguistique, la plupart des noms ayant une signification précise.
Nous allons donc étudier les différentes origines des noms présents sur l'ensemble du territoire ; puis les origines spécifiques à certaines régions ayant eu une histoire ou un peuplement particulier ; enfin, nous terminerons en évoquant succinctement les origines des noms apparus avec l'immigration.
Typologie des noms de familleMartin

Il y a en France près de 240 000 personnes portant le nom de famille Martin. Sa popularité peut être attribuée à Saint Martin de Tours, qui était autrefois le saint le plus populaire en France.
C’est peut être aussi un vieux nom de famille donné aux enfants des orphelinats, qui n’a jamais été un prénom très répandu au Moyen Age, mais qui est maintenant très fréquent en tant que prénom et nom de famille.
Martin peut aussi signifier la charité envers les orphelins.
Origine des noms de famille
Jusqu'au 11e siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Au 12e siècle, l'explosion démographique oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin d'éviter les confusions.
Etymologie des noms de famille
Connaître l'origine du nom est intéressante. Elle donne quelques informations sur l'origine de vos ancêtres (origine géographique, origine sociale, métiers…).
Les noms de famille viennent :
- d'anciens prénoms de baptême : Nicolas…
- de professions : Meunier, Maréchal, Boulanger…
- de sobriquets et surnoms de toutes sortes liés à l'apparence physique (Roux, Brun, Borgne…), aux traits de caractères (Lesage)
- de lieux géographiques : Dupont (habitant près d'un pont), Dupré
- de plantes, d'arbres, d'animaux…
- du rang social…
Les noms ont évolué au cours des siècles. Ils existent de très nombreuses variantes orthographiques d'un nom (Laurent, Lorant, laurant, Laurans) et des diminutifs (avec des variantes orthographiques :Laurencin, Laurancin, Laurençon, Lauranson, Lauransot, Laurensot… ).
La Bretagne, la Corse, le Pays basque, les Flandres françaises, l'Alsace-Lorraine, le Roussillon et les régions de langue occitane et franco-provençale ont des patronymes spécifiques (histoire, langue…). Il arrive que les noms de famille apparaissent selon les actes en langue régionale ou en français. Il faut donc en tenir compte dans ces recherches.
Quelques explications sur les noms de famille d'origine régionale, étymologie des noms basques
Transmission du nom de famille
En Italie, en Belgique et au Luxembourg, l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père.
On donne d'ailleurs comme définition du patronyme : "nom de famille". Etymologiquement, patronyme vient du latin pater, le père. Il existe aussi le matronyme, nom transmis par la mère, du latin mater.
En Espagne, par exemple, l'enfant légitime porte à la fois le nom de son père et celui de sa mère.
En Angleterre et au Pays de Galles, les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'enfant légitime.
En Allemagne et au Danemark, l'enfant légitime porte le nom de famille de ses parents et, à défaut d'un nom commun aux parents, ces derniers choisissent le nom qu'ils lui transmettent.
-

Le boucher est un artisan chargé de la préparation et de la vente de la viande. L'origine étymologique de ce mot vient de l'activité marchande qu'exerce une personne à vendre de la viande de bouc.
Il achète la viande dans les abattoirs ou chez des grossistes, déjà abattue.

Il la découpe et la désosse, puis s'occupe de sa vente dans la boucherie. Habituellement, il se limite aux viandes de bœuf, de veau, de porc et de mouton et d'agneau, et vend aussi de la volaille.
Le commerce des viandes de porc est traditionnellement réservé aux charcutiers.
La viande de cheval est vendue par le boucher chevalin.
De nos jours, cette stricte délimitation des rôles tend à s'estomper.
Dès les origines les bouchers ont été des commerçants influents.
Au Moyen Âge, les corporations de bouchers de Paris ou Limoges sont très riches et puissantes.

Le Bœuf Gras, est une importante figure festive que les bouchers ou garçons bouchers exposent ou – et – font défiler solennellement en musique, généralement au moment du Carnaval. Il peut s'agir d'un animal vivant ou d'une représentation sculptée.

Cet article offre un panorama non exhaustif des festivités du Bœuf Gras dans le monde.

Le Bœuf Gras au Carnaval de La Nouvelle-Orléans, gravure de 1875.
-
Charlemagne,ou le premier empereur de l'Occident médieval
Charles Ier, dit « le Grand » (en allemand Karl der Große, en latin Carolus Magnus d'où Charlemagne)1, né en 742, 747 ou 748 et mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle3 d'une affection aiguë qui semble avoir été une pneumonie, est le membre le plus éminent de la dynastie franque à laquelle il a donné son nom alors qu'il n'en est pas le fondateur : les Carolingiens.
Fils de Pépin le Bref, il est roi des Francs à partir de 768, devient par conquête roi des Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800, relevant une dignité disparue depuis l'an 476 en Occident.
Monarque guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la soumission a été très difficile et très violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en Italie et les Musulmans d'Espagne.
Souverain réformateur, soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et les lettres et est à l'origine de la « renaissance carolingienne ».
Son œuvre politique immédiate, l'empire, ne lui survit cependant pas longtemps. Se conformant à la coutume successorale germanique, Charlemagne prévoit dès 806 le partage de l'Empire entre ses trois fils5. Après de nombreuses péripéties, l'empire ne sera finalement partagé qu'en 843 entre trois de ses petits-fils (traité de Verdun).
Le morcellement féodal des siècles suivants, puis la formation en Europe des États-Nations rivaux condamnent à l'impuissance ceux qui tentent explicitement de restaurer l'empire universel de Charlemagne, en particulier les souverains du Saint-Empire romain germanique, d'Otton Ier en 962 à Charles Quint au XVIe siècle, voire Napoléon Ier, hanté par l'exemple du plus éminent des Carolingiens6.
La figure de Charlemagne a été l'objet de déchirements en Europe, notamment l'enjeu politique entre le XIIe et XIXe siècles entre la nation germanique qui considère le Saint-Empire romain comme le successeur légitime de l'empereur carolingien et la nation française qui en fait un élément central de la continuité dynastique des Capétiens.Pourtant, il peut être considéré comme le « Père de l'Europe »7,8,9, pour avoir assuré le regroupement d'une partie notable de l'Europe occidentale, et posé des principes de gouvernement dont ont hérité les grands États européens10.
Les deux principaux textes du IXe siècle qui dépeignent le Charlemagne réel, la Vita Caroli d'Éginhard et la Gesta Karoli Magni attribuée au moine de Saint-Gall Notker le Bègue, l'auréolent également de légendes et de mythes repris au cours des siècles suivants :« Il y a le Charlemagne de la société vassalique et féodale, le Charlemagne de la Croisade et de la Reconquête, le Charlemagne inventeur de la Couronne de France ou de la Couronne impériale, le Charlemagne mal canonisé mais tenu pour vrai saint de l'Église, le Charlemagne des bons écoliers
-

Cassini est surtout connu pour ses travaux d'astronomie.
Cette dynastie d’astronomes et cartographes légua à la France la carte de l’Académie passée à la postérité sous le nom de « carte de Cassini ».
L’échelle adoptée est d’une ligne pour cent toises, soit une échelle de 1/86400 (une toise vaut 864 lignes).
Cette carte constituait pour l’époque une véritable innovation et une avancée technique décisive. Elle est la première carte à s’appuyer sur une triangulation géodésique dont l’établissement prit
plus de cinquante ans.
Ses recherches ont porté sur des domaines très divers, allant de la rotation des planètes à la lumière zodiacale ou aux comètes.
On lui doit tout particulièrement la découverte de la division de l'anneau de Saturne qui porte aujourd'hui son nom.
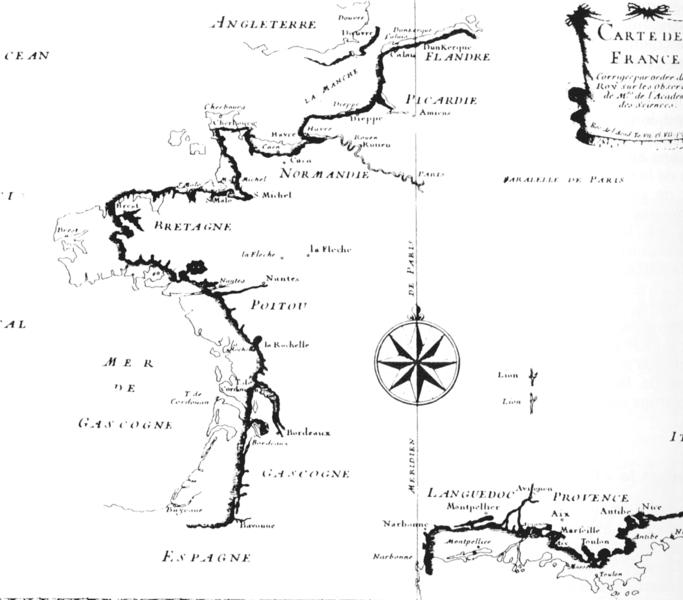
Cassini est également l'auteur de travaux de géodésie et cartographie, menés dans le cadre de ses fonctions à l'Académie des sciences et à l'Observatoire.

L'Observatoire au temps de Cassini
Jean-Dominique Cassini a profondément marqué l'histoire de l'Observatoire de Paris.
Il s'y installe très peu de temps après son arrivée en France, en 1669, alors que la construction est à peine achevée.
Au sein de ce bâtiment, modifié selon ses instructions, Cassini effectue la majeure partie de ses travaux.
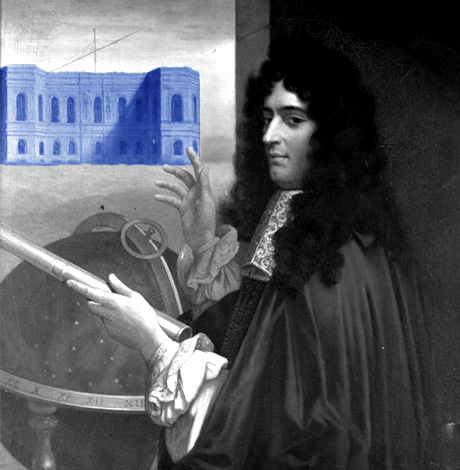
http://expositions.obspm.fr/cassini/pages/observatoire.php

La carte de Cassini ou carte de l'Académie est la première carte générale et particulière du royaume de France.
il serait plus approprié de parler de carte des Cassini, car elle fut dressée par la famille Cassini, principalement

César-François Cassini (Cassini III) et
son fils Jean-Dominique Cassini (Cassini IV) au XVIIIe siècle.

L'échelle adoptée est d'une ligne pour cent toises, soit une échelle de 1/86 400 (une toise vaut 864 lignes).
Cette carte constituait pour l'époque une véritable innovation et une avancée technique décisive.

Elle est la première carte à s'appuyer sur une triangulation géodésique dont l'établissement prit plus de cinquante ans.
Les trois générations de Cassini se succédèrent pour achever ce travail.

La carte ne localise pas précisément les habitations ou les limites des marais et forêts, mais le niveau de précision du réseau routier ancien est tel qu'en superposant des photos satellite orthorectifiées aux feuilles de la carte de la France, on obtient de spectaculaires résultats.

Jean Dominique Cassini 1748
Le travail des Cassini laissa même son empreinte sur le terrain où l'on trouve encore aujourd'hui des toponymes dits « Signal de Cassini », qui révèlent les lieux où s'effectuèrent les mesures de l'époque.

Ces points de repères correspondent aux sommets des mille triangles qui formaient la trame de la carte de Cassini.
De nos jours, les chercheurs consultent fréquemment les feuilles de la carte des Cassini, soit sa forme papier en salle de lecture du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, soit sa forme numérique en ligne (voir Liens externes).
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php
Elle intéresse tout particulièrement les archéologues, les historiens, les géographes, les généalogistes, les chasseurs de trésors et les écologues qui ont besoin de faire de l'écologie rétrospective ou de comprendre l'histoire du paysage.

César-François dit Cassini III
César-François Cassini de Thury (17 June 1714 – 4 September 1784)
Opérations préalables
La carte de Cassini est la première carte géométrique couvrant l'intégralité du royaume de France.
Préalablement aux levés, il a fallu procéder à une triangulation du territoire.
Objectifs
Voici comment César-François Cassini (Cassini III) voyait la carte qu'il allait commencer :
- « mesurer les distances par triangulation et assurer ainsi le positionnement exact des lieux » ;
- « mesurer le Royaume, c’est-à-dire déterminer le nombre innombrable de bourgs, villes et villages semés dans toute son étendue » ;
- « représenter ce qui est immuable dans le paysage ».

Levés de la carte
Les levés ont été effectués entre 1756 et 1789 et les 181 feuilles composant la carte ont été publiées entre 1756 et 1815.
Mort en 1784, César-François Cassini ne verra jamais l'achèvement des levés. Son fils, Jean-Dominique finit les travaux de son père.
Les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et une partie de celui des Alpes-Maritimes ne faisaient pas partie du Royaume de France à l’époque des levés opérés au XVIIIe siècle. Ils ne sont donc pas représentés sur la carte de l’Académie.
De plus, l'île d'Yeu et la Corse ne seront jamais levées.
La plupart des feuilles ont fait l'objet d'une nouvelle édition datée de 1815.
Financement
En 1756, Cassini de Thury fonde une société de cinquante associés afin de rassembler les fonds nécessaires pour finir les levés de la carte. Des personnalités de l'époque y participent. La plus célèbre d'entre elles est la marquise de Pompadour.
Défauts et remplacement
En 1808, Napoléon Ier décida l'établissement d'une carte destinée à remplacer celle de Cassini ; toutefois durant tout l'Empire, les ingénieurs-géographes qui devaient s'y attacher eurent à accomplir des travaux plus pressants : cartes des champs de batailles, travaux topographiques sur les frontières du Nord...
Ainsi il fallut attendre la Seconde Restauration pour que la mise en œuvre de cette nouvelle carte puisse débuter avec les premiers travaux d'une triangulation appuyée sur la méridienne de Delambre et Méchain.
Les travaux de cette carte s'étalèrent entre 1817 et 1866, en essayant plusieurs échelles différentes. Ce fut une carte à l'usage des militaires, la carte de l'État-Major, à l'échelle 1/80 000.
Malgré l’existence de ces dernières cartes, bien plus exactes, les cartes de Cassini sont encore restées une source pour la cartographie du XIXe siècle.
En témoigne la carte de France du Service du génie militaire de 1878 dont les tracés des cours d'eau et les noms des divers villes et villages reprennent les tracés et les graphies des cartes de Cassini.
Utilisations contemporaines
Ces cartes, bien que peu précises concernant les données paysagères, apportent - en complément d'autres sources - des informations intéressantes pour :
- la géographie historique
- l'étude de la toponymie
- l'archéologie récente
- l'écologie rétrospective, l'histoire environnementale, dont par exemple l'évaluation des forêts anciennes (donnée importante pour la protection ou restauration de la biodiversité

sources wikipedia
article :http://decouverte-bocage-gatinais.fr/cartographie.php
http://vierville.free.fr/41-CartesPlans.htm
-

les Huns
Lisa Garnier
Si, depuis le premier siècle de notre ère, les peuples situés au-delà de la frontière de l'Empire romain sont restés relativement calmes malgré quelques escarmouches, tout bascule en 375. Les Huns, ces barbares venus des steppes eurasiatiques, s'attaquent aux royaumes wisigoth et ostrogoth d'Ukraine.
C'est le début d'un grand bouleversement au sein des territoires germaniques. Cette fois, les Barbares n'hésitent pas à se replier sur l'Empire.
À la différence des Ostrogoths, les Wisigoths insoumis devant les Huns traversent la frontière du Danube et pénètrent dans l'Empire romain d'Orient.
Trente ans plus tard, ce sont les Vandales et les Suèves, également Germains orientaux, et les Alains, nomades iranophones, qui franchissent le Rhin gelé à la fin de 406 et déferlent sur la Gaule.
Englobés sous les noms de Germains occidentaux et orientaux, ces peuples nous sont connus grâce aux divers témoignages écrits. Ainsi « dès l'an 100, Tacite situe les principaux peuples germaniques, note Patrick Périn, directeur du musée d'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. D'ailleurs, en l'étudiant, on remarque que plus on s'éloigne du Rhin et du Danube, moins les peuples décrits sont nombreux. Il faut dire qu 'à cette époque les Romains ne s'aventuraient jamais trop loin dans ces contrées. » En revanche, la localisation des sites archéologiques prouvant la véritable présence des peuples germaniques à ces époques se révèle beaucoup plus difficile.
D'une part, parce que depuis le Ier siècle, ils changeaient régulièrement de territoire. D'autre part, certaines de ces terres étaient déjà peuplées par les Celtes qui étaient répartis du bassin des Carpâtes jusqu'à l'Angleterre.
« Dans les régions d'Allemagne moyenne, on ne sait pas toujours différencier les sites archéologiques celtes et germaniques, souligne Patrick Périn. Il n'y a pas mille et une façons de construire une maison en bois, par exemple. »
La plupart des Barbares incinéraient aussi leurs défunts. Seules les élites comme les rois ou chefs de clan ainsi que leurs familles étaient parfois inhumées.

Établis dans la région de l'Oural, les Huns déferlent vers l'Europe et
attaquent, en 375, les royaumes ostrogoth et wisigoth. C'est le début
des grandes invasions.Ci-dessus, Les Huns au combat contre les Alains
Illustration de Johann Nepomuk Geiger (1873)C'est donc avec la diffusion de quelques objets et de coutumes - en particulier des inhumations - que l'on peut tenter de reconstituer leur culture. « L'étude de leurs costumes traditionnels est un bon point de départ, explique Katalin Escher, spécialiste des populations burgondes.
Les femmes de bonnes familles étaient enterrées avec leurs bijoux.
C'était des distinctions traditionnelles qui ne s'échangeaient pas. »
En revanche, on ne sait pas si le costume mortuaire correspondait à celui qu'elles portaient dans la vie quotidienne.
« Pour les hommes, c'est plus difficile, poursuit l'historienne. S'ils étaient enterrés avec leurs armes, ce qui n'est pas toujours le cas, celles-ci pouvaient être romaines puisque nombre d'entre eux étaient aussi des soldats romains. Et puis, il y a la forme des peignes, des fibules, des types de poterie... »
Aujourd'hui, les historiens distinguent les Germains orientaux qui comprennent les Burgondes, les Goths, les Vandales, les Gépides, les Skires et les Hérules, les Germains occidentaux avec les Francs et les Alamans, les Germains de l'Elbe avec les Suèves et les Lombards et enfin les Germains de la mer du Nord avec les Ruges, les Angles, les Jutes, les Saxons et les Frisons.
Les recherches archéologiques ont d'ailleurs montré que plusieurs cultures archéologiques proches se répartissent entre les fleuves Oder et Vistule du Ier siècle au début du IIIe siècle
après Jésus-Christ.
Appelées de Przeworsk, de Wielbark, de Luboszyce et de Debczyno, elles ont laissé de nombreuses nécropoles - dont les traces sont peu visibles parce que la population ne réalisait pas encore d'aménagement spécifique architectural
- et des habitats non fortifiés.
http://www.lecerclemedieval.be/histoire/Huns.html
-

Les Goths.
Les Goths, des Germains orientaux, seraient originaires de la
péninsule de Jutland au Danemark actuel, et du sud de la Suède.Germains orientaux, les Goths auraient comme territoire d'origine la péninsule de Jutland et la région de Gôtaland en Suède.

On retrouve leurs traces dans l'arrière-pays polonais et allemand pendant près d'un siècle.
Au début du IIIe siècle, ils s'installent au bord de la mer Noire d'où ils délogeront des peuples d'origine iranienne, les Scythes, les Alains et les Sar-mates.
Cinquante ans plus tard, les Wisigoths partent à l'ouest dans la région forestière qui s'étend entre le Danube et le Dniestr.

Les Ostrogoths se fixent à l'est où, comme les Wisigoths, ils fondent un vaste État. Les Goths ont laissé d'importantes traces archéologiques regroupées sous le nom de la culture de Tchernjahov.
Dans les sépultures, les défunts avaient soit la tête à l'ouest - ils étaient généralement des gens modestes - soit la tête au nord. Dans ce cas, ils étaient accompagnés d'un mobilier plus riche.
Caractéristique principale des Goths :
les hommes n'étaient jamais - ou très exceptionnellement- enterrés avec une arme.

Les femmes portaient deux fibules, une sur chaque épaule, qui refermaient le col de leur manteau.

Elles avaient suspendu à leur ceinture des peignes, des miroirs métalliques, des couteaux et d'autres objets.

Partis de Scandinavie, les Goths se seraient implantés en Poméranie au IIe s.
Au IIIe s.,ils sont au bord de la mer Noire (Pont-Euxin).
Sous la poussée des Huns, les Wisigoths
partiront à l'ouest (Thrace), les Ostrogoths, eux, se fixant à l'est.Les habitats étaient généralement à proximité des cours d'eau sur le versant des vallées. Ils étaient toujours installés sur des terrains propices à l'agriculture.
Au regard des outils agricoles mis au jour, les Goths avaient une technique de labourage évoluée parfaitement adaptée aux terres fertiles de la région.
Ils cultivaient l'orge, le seigle, le millet, le chanvre, les pois et les lentilles.
Chats et chiens partageaient les habitations et selon les régions, l'élevage était plus porté sur les porcs ou les chevaux.
L'habitation comportait une ou deux pièces avec des murs en argile soutenus par une armature en bois ou en jonc.
Les nombreuses amphores romaines qui devaient contenir du vin ou de l'huile prouvent que les Barbares importaient des objets de l'Empire et ne se contentaient pas de leur propre production.
Au IVe siècle, les Goths regroupent une fédération de tribus - ils se sont alliés avec d'autres Barbares, germaniques et non germaniques, thraces et iraniens - devenue célèbre et puissante. Mais l'arrivée des Huns change tout.
Lorsque les Wisigoths prennent la fuite en Thrace sous la protection de l'Empire, leurs témoignages archéologiques se raréfient, les populations ayant tendance à s'assimiler à la population locale romaine.
En 377, les Wisigoths disparaissent presque en tant que peuple et deviennent un groupe social de guerriers.
Les Ostrogoths, quant à eux, restent sous l'emprise des Huns et conservent leur artisanat, leur agriculture et leur commerce développé.
http://www.lecerclemedieval.be/histoire/goths.html
-

Les Francs
Ces Germains occidentaux que sont les Francs n'ont pas réalisé de grands déplacements en Europe.

Leurs cavaliers appartenant à l'aristocratie franque, étaient armés d'une épée
longue, d'une hache de jet (francisque), d'une lance et d'un long javelot angon.A la différence des Germains orientaux, les Francs n'ont pas réalisé de grandes migrations à travers l'Europe.
En revanche, les guerres incessantes entre tribus ennemies voisines ont eu pour conséquences de nombreux petits déplacements territoriaux. La particularité des Francs repose sur la formation d'une ligue issue de diverses populations: les Chamaves, les Bructères, les Tenctères, les Usipètes, les Amsivariens, etc.
Les Francs étaient de redoutables guerriers et des marins accomplis.
D'un point de vue archéologique, on ne sait pas différencier ces populations et leur histoire matérielle au IIIe siècle reste très méconnue.
Français : Grégoire de Tours, Histoire des Francs, livres 1 à 6.
Initiale P en forme de poisson ouvrant le livre consacré à Clovis. Luxeuil ou Corbie, fin du VIIe siècle. BnF, Manuscrits, Latin 17655 fol.13v-14.
Transcrit dans une écriture cursive difficile à lire, ce célèbre ouvrage relatant l'histoire mérovingienne est orné d'initiales dont les motifs géométriques ou zoomorphes cloisonnés et rehaussés de couleurs vives illustrent bien le vocabulaire décoratif pratiqué en Gaule au VIIe siècle.
Pratiqué sur le continent durant les VIIe et VIIIe siècles, en particulier à Bobbio, Luxeuil et Corbie, le style mérovingien se caractérise par ses initiales multicolores, inspirées des émaux cloisonnés qui ornaient les bijoux. Les initiales, comme ici, sont souvent composées de poissons et d'oiseaux stylisés, dont les formes arrondies s'adaptent à la structure de la lettre : le début du second livre, consacré à Clovis, est ainsi orné d'un P à la boucle en forme de poisson.
Ces initiales rouges, jaunes et vertes sont typiques d'un décor que le scriptorium de Luxeuil contribue à diffuser ; elles sont dues aux copistes, habituellement auteurs à cette époque à la fois de l'écriture et de la décoration.
Leurs incursions en Gaule sont cependant prouvées dès 238 par la multiplication des trésors monétaires dans toutes les contrées limitrophes du Rhin et notamment sur le territoire de la Belgique actuelle.
L'armement des Francs était probablement proche de celui des Germains de l'Elbe. Leur lance était légère avec une longue flamme triangulaire, leur bouclier rond, en bois et avec un centre conique en fer. Ils devaient aussi se servir de javelots et de haches.

Fibule ronde mérovingienne en bronze, recouverte d'or et de
pâtes de verre découverte dans une nécropole. (VIIe siècle.)Les campagnes guerrières n'avaient généralement pas lieu en hiver ni pendant les récoltes estivales qui permettaient de moissonner le blé et l'avoine.
Les terres cultivées subissaient une rotation de culture environ tous les deux ou trois ans.
Les hommes étaient d'habiles forgerons et le commerce avec les régions méditerranéennes développé.

Les femmes franques étaient enterrées avec leurs objets de toilette
et leurs bijoux. Fibule mérovingienne en argent doré, VIe siècle.Au IVe siècle apparaissent en Gaule des inhumations qui tranchent avec le contexte funéraire gallo-romain. D'une part, les défunts sont orientés la tête vers le nord, comme dans presque toutes les tombes germaniques.
D'autre part, les hommes sont enterrés avec leurs armes et les femmes avec leurs bijoux, leurs paires de fibules en métal précieux et leurs ustensiles de toilette. Les objets accompagnant les défunts sont aussi luxueux pour l'époque : verrerie, récipients en métal ou en bois.
Ces pratiques funéraires s'étendent aussi à l'extérieur des frontières de l'Empire où les inhumations plus modestes ont duré jusqu'au Ve siècle.
Pour les historiens, ces tombes luxueuses sont le reflet d'une population de nouveaux riches barbares.

Commerçants ou fervents défenseurs de l'Empire qui les rétribuaient en conséquence, ils ne cachaient pas leur richesse. Au contraire, plutôt fascinés par les coutumes romaines, ils adoptaient - en partie - les pratiques funéraires de la Gaule romaine.
http://www.lecerclemedieval.be/histoire/francs.html
-
Les Burgondes

Originaires de l'île danoise de Bornholm (ici, château de Mammershus),
les Burgondes fonderont deux royaumes, l'un sur le Rhin, et l'autre à l'est de la Gaule.Classés parmi les Germains orientaux, les Burgondes proviendraient d'une île danoise appelée Bornholm. Ils auraient ensuite migré dans la vallée de la Warta, qui s'écoule dans l'actuelle Pologne. Le nom prendrait son origine dans bhrghus voulant dire « grand, haut, fort ». Les Burgondes seraient ainsi le peuple du « haut pays ». Les fouilles archéologiques ont montré qu'ils étaient intégrés à la civilisation de Wielbark dans le nord de la Pologne.
Cette civilisation est caractérisée par des céramiques montées sans tour - elles se différencient ainsi des poteries romaines fabriquées avec tour -, des pots assez simples, hauts, ventrus et à larges ouvertures. L'économie était basée sur l'élevage et l'agriculture. On a ainsi découvert des traces de labourage croisé sur un sol ancien et conservé sous un tumulus.
La moitié du cheptel comprenait des bœufs.
Les chèvres et les moutons constituaient un quart de l'élevage.
Les porcs étaient aussi présents ainsi que les chevaux, mais ces derniers étaient peu nombreux.

Roi des Burgondes de 516 à 523, Sigismond qui se convertit au christianismesera canonisé.
Détail d'une fresque, fin XVe s., dans une église de Pavie.
Après deux siècles et demi de présence, ils quittent les bords de la rivière pour s'installer entre le Main et le Danube.
Soit dans l'actuelle Allemagne. Le peuple, polythéiste et divisé en plusieurs clans très larges dont chacun avait à sa tête une sorte de roi, prend à nouveau de la puissance. Vers 373, certains textes font état de 80000 Burgondes. Les témoins archéologiques de ce premier royaume sont assez clairsemés. Proches du peuple Alaman, il est difficile de les différencier.
À Trêves cependant, une pierre tombale proclame qu'Hariulf était de la « lignée royale des Burgondes ». Dans la banlieue de Francfort à Kahl am Main précisément, des fouilles ont mis au jour les vestiges de 11 petites maisons et un cimetière germanique.
La population semblait être dans une période de transition puisque les objets retrouvés possèdent des caractéristiques proches des Burgondes de la moitié du Ve siècle.
Les écrits mentionnent une solide réputation pour l'artisanat du bois.
L'étude des inhumations montre que les femmes tenaient leur tunique fermée par deux fibules à tête triangulaire et d'autres modèles à ressort.
Elles utilisaient des peignes de forme caractéristique et à dos arqué.
En 406, les Burgondes sont les voisins directs de l'Empire romain. Ils ont alors conquis les territoires de la vallée du Main tenus jusqu'alors par les Alamans.
Sidoine Apollinaire décrit les Burgondes (Carmina, X. 460)
Pourquoi me demandes-tu de composer (...) un poème (...) quand je vis au milieu de hordes chevelues, que j'ai à supporter leur langage germanique et à louer incontinent, malgré mon humeur noire, les chansons du Burgonde gavé, qui s'enduit les cheveux de beurre rance?
(...) Heureux tes yeux et tes oreilles, heureux aussi ton nez, toi qui n'as pas à subir l'odeur de l'ail ou de l'oignon infect que renvoient dès le petit matin dix préparations culinaires, toi qui n'es pas assailli, avant même le lever du jour, comme si tu étais leur vieux grand-père ou le mari de leur nourrice, par une foule de Géants si nombreux et si grands qu'à peine les contiendrait la cuisine d'Alcinoüs (...)»
Traduction d'André Loye. Poèmes, Belles Lettres, tome I, 1960.
http://www.lecerclemedieval.be/histoire/burgondes.html
-
La période féodale :
l'ancien français
(IXe - XIIIe siècle)
Plan du présent article
1. La naissance du français
L'avènement des Capétiens
Le premier «roi de France»
L'expansion du français en Angleterre
La langue du roi de France
2. L'état de l'ancien français
Le système phonétique
La grammaire
3. Les langues parlées en France
4. La domination culturelle du latin
La langue de prestige
La création des latinismes
Un phénomène ininterrompu de latinisation
5. L'influence de la langue arabe
Les emprunts au français
Les chiffres arabesLes caractéristiques principales du régime féodal furent le morcellement et la fidélité. Afin de s'assurer la fidélité de ses vassaux, un suzerain (seigneur) accordait à chacun d'eux un fief (une terre) qui leur servait de moyen de subsistance; en retour, les vassaux s'engageaient à défendre leur seigneur en cas d'attaque extérieure.
Quelles furent les conséquences politiques de ce système?
Le morcellement du pays et la constitution de grands fiefs, eux-mêmes divisés en une multitude de petits fiefs; les guerres entre seigneurs étaient très fréquentes parce qu'elles permettaient aux vainqueurs d'agrandir leur fief. Chacun vivait par ailleurs relativement indépendant dans son fief, sans contact avec l'extérieur. Dans un tel système, la monarchie demeurait à peu près sans pouvoir.
1 La naissance du français
On situe la naissance du français vers le IXe siècle, alors qu'il faut attendre le Xe ou le XIe siècle pour l'italien, l'espagnol ou l'occitan.
Mais ce français naissant n'occupait encore au IXe siècle qu'une base territoriale extrêmement réduite et n'était parlé que dans les régions d'Orléans, de Paris et de Senlis (voir les zones en rouge sur la carte) par les couches supérieures de la population.
Le peuple parlait, dans le Nord, diverses variétés d'oïl: le françois dans la région de l'Île-de-France, mais ailleurs c'était le picard, l'artois, le wallon, le normand ou l'anglo-normand, l'orléanais, le champenois, etc. Il faut mentionner aussi le breton dans le Nord-Ouest. Les rois de France, pour leur part, parlaient encore le francique (une langue germanique) tout en utilisant le latin comme langue seconde pour l'écrit.
À cette époque, les gens du peuple étaient tous unilingues et parlaient l'un ou l'autre des nombreux dialectes alors en usage en France. Seuls les «lettrés» écrivaient en «latin d'Église» appelé alors le «latin des lettrés» et communiquaient entre eux par cette langue.
Dans le Sud, la situation était toute différente dans la mesure où cette partie méridionale du royaume, qui correspondait par surcroît à la Gaule la plus profondément latinisée, avait été longtemps soumise à la domination wisigothe plutôt qu'aux Francs.
Les variétés d'oc, plus proches du latin, étaient donc florissantes (provençal, languedocien, gascon, limousin, etc.), surtout que l'influence linguistique wisigothe avait été quasiment nulle, sauf dans la toponymie. Dès le Xe siècle, le catalan se différencia de l'occitan par des traits particuliers; en même temps, le basque était parlé dans les hautes vallées des Pyrénées.
Quant aux langues franco-provençales (voir le texte de Manuel Meune à ce sujet) du Centre-Est, elles correspondaient plus ou moins à des anciennes possessions des Burgondes, puis de l'empereur du Saint Empire romain germanique. Bref, à l'aube du Xe siècle, l'aire des grands changements distinguant les aires d'oïl, d'oc et franco-provençale étaient terminées, mais non la fragmentation dialectale de chacune de ces aires, qui ne faisait que commencer. Soulignons qu'on employait au singulier «langue d'oïl» ou «langue d'oc» pour désigner les langues du Nord et du Sud, car les gens de l'époque considéraient qu'il s'agissait davantage de variétés linguistiques mutuellement compréhensibles que de langues distinctes.
1.1 L'avènement des Capétiens
En mai 987, Louis V, le roi carolingien de la Francie occidentale était décédé subitement dans un accident de chasse en ne laissant aucun héritier direct. Le 1er juin, les grands seigneurs du royaume se réunir à Senlis pour élire un successeur au trône de la Francie occidentale. L'aristocratie franque élit Hugues Ier qui fut sacré quelques jours plus tard, le dimanche 3 juillet 987, dans la cathédrale de Noyon. Il fut surnommé aussitôt le «roi à chape» en raison de son titre d'abbé laïc qu'il détenait dans les nombreuses «chapes» ecclésiastiques — la chape (la «capa» ou cape) étant le manteau à capuchon que portaient les abbés —, d'où le terme Capet.
Avant d'être couronné «roi des Francs» (rex Francorum), Hugues Ier était un puissant seigneur respecté; il était comte de Paris, comte d'Orléans, duc des Francs et marquis de Neustrie (nord-ouest de la France sans la Bretagne), et possédait de nombreuses seigneuries laïques et abbayes (Saint-Martin-de-Tours, Marmoutier, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Denis). Ses alliances familiales avaient favorisé son élection comme «roi des Francs» par l'aristocratie: il était frère d’Othon (duc de Bourgogne), beau-frère de Richard (duc de Normandie), et gendre de Guillaume III Tête d’Étoupe (duc d’Aquitaine), depuis son mariage en 970 avec la princesse Adélaïde, la fille de Guillaume III.
C'est avec l'avènement de Hugues Capet (en 987) que le premier roi de France (encore désigné comme le «roi des Francs») en vint à parler comme langue maternelle la langue romane vernaculaire (plutôt que le germanique), ce qui sera appelé plus tard comme étant le françois ou françoys (prononcé [franswè]).
Dans le système féodal de l'époque, la France était dirigée par une vingtaine de seigneurs territoriaux, descendants de fonctionnaires ou de guerriers carolingiens, qui détenaient des pouvoirs considérables parfois supérieurs à ceux du roi, comme ce fut le cas, par exemple dans le Nord, avec les comtes de Flandre et les ducs de Normandie, à l'est avec les ducs de Bourgogne et, au sud, avec les ducs d'Aquitaine.
En raison des invasions étrangères, ces seigneurs avaient obtenu du roi de vastes territoires en échange de leurs services. La légitimité de Hugues Capet état alors relativement fragile. Par exemple, lorsqu'il s'opposa à son vassal Adalbert de Périgord qui refusait de lever le siège de Tours, le roi lui lui demanda : «Qui t'as fait comte?» Et le vassal de lui répondre: «Qui t'as fait roi?»
Hugues Ier sera le fondateur de la dynastie des Capétiens et s'appuiera sur des règles d'hérédité, de primogéniture (priorité de naissance) et d'indivisibilité des terres domaniales. C'est donc Hugues Capet qui remplaça la monarchie élective en vigueur sous les derniers Carolingiens en une monarchie héréditaire.
D'ailleurs, Hugues Capet avait fait élire et sacrer son fils aîné Robert quelques mois après sa propre élection, soit le 25 décembre 987. La dynastie des Capétiens réussit à renforcer ainsi l'autorité royale et entreprit la tâche d'agrandir ses domaines. Contrairement aux rois précédents qui transportaient leur capitale d'une ville à l'autre, les Capétiens se fixèrent à Paris.
1.2 Le premier «roi de France»
Ce n'est qu'en 1119 que le roi Louis VI le Gros (qui régna de 1108 à 1137), un descendant de Hugues Capet, se proclama, dans une lettre au pape Calixte II «roi de France» (rex Franciai), plus précisément «roi de la France», non plus des Francs, et «fils particulier de l’Église romaine». C'est le premier texte où il est fait référence au mot France.
D'où le mot français (et «françois» ou «françoys»). En réalité, c'est le mot françois ou françoys (prononcé [franswè]) qui était attesté à l'époque, le mot francien ayant été créé en 1889 par le philologue Gaston Paris pour faire référence au «français de l'Île-de-France» du XIIIe siècle, par opposition au picard, au normand, au bourguignon, au poitevin, etc.
Mais il faut aussi considérer qu'au début du XIIIe siècle le terme françois ou françoys désignait autant la langue du roi que le parler de l'Île-de-France ou même toute autre variété d'oïl (picard, champenois, normand, etc.). Autrement dit, la notion de «françoys» recouvrait une réalité linguistique encore assez floue. Les mots France, Franc et françoys étaient souvent utilisés de façon interchangeable, que ce soit pour désigner le pays, le pouvoir ou la langue du pouvoir.
Dans les conditions féodales, les divergences qui existaient déjà entre les parlers locaux se développèrent et s'affermirent. Chaque village ou chaque ville eut son parler distinct: la langue évolua partout librement, sans contrainte. Ce que nous appelons aujourd'hui l'ancien français correspondait à un certain nombre de variétés linguistiques essentiellement orales, hétérogènes géographiquement, non normalisées et non codifiées.
Les dialectes se multipliaient et se divisaient en trois grands ensembles assez nettement individualisés, comme on les retrouve encore aujourd'hui (voir la carte de la France dialectale): l
es langues d'oïl au nord, les langues d'oc au sud, le franco-provençal en Franche-Comté, en Savoie, au Val-d'Aoste (Italie) et dans l'actuelle Suisse romande. L'une des premières attestations de l'expression langue d'oc est attribuée à l'écrivain florentin Dante Alighieri (1265-1321. Dans son De Vulgari Eloquentia («De l'éloquence vulgaire») rédigé vers 1305 en latin, celui-ci classait les trois langues romanes qu'il connaissait d'après la façon de dire oui dans chacune d'elles (par exemple, oïl, oc, si), d'où la distinction «langue d'oc» (< lat. hoc) au sud et «langue d'oïl» (< lat. hoc ille) au nord, pour ensuite désigner les parlers italiens (sì < lat. sic).
Le célèbre Florentin distinguait dans leur façon de dire «oui» les trois grandes branches des langues romanes (issues du latin) connues: «Nam alii Oc; alii Oil, alii Sì, affirmando loquuntur, ut puta Yispani, Franci et Latini», ce qui signifie «les uns disent oc, les autres oïl, et les autres si, pour affirmer, par exemple, comme les Espagnols, les Français et les Latins».
Bien que le français («françoys») ne soit pas encore une langue officielle (c'était le latin à l'écrit), il était néanmoins utilisé comme langue véhiculaire par les couches supérieures de la société et dans l'armée royale qui, lors des croisades, le porta en Italie, en Espagne, à Chypre, en Syrie et à Jérusalem.
La propagation de cette variété linguistique se trouva favorisée par la grande mobilité des Français: les guerres continuelles obligeaient des transferts soudains de domicile, qui correspondaient à un véritable nomadisme pour les soldats, les travailleurs manuels, les serfs émancipés, sans oublier les malfaiteurs et les gueux que la misère générale multipliait. De leur côté, les écrivains, ceux qui n'écrivaient plus en latin, cessèrent en même temps d'écrire en champenois, en picard ou en normand pour privilégier le «françoys».
Cette langue «françoise» du Moyen Âge ne paraît pas comme du «vrai français» pour les francophones du XXIe siècle. Il faut passer par la traduction, tellement cette langue, dont il n'existe que des témoignages écrits nécessairement déformés par rapport à la langue parlée, demeure différente de celle de notre époque. Les étudiants anglophones des universités ont moins de difficultés à comprendre cet ancien français que les francophones eux-mêmes, la langue anglaise étant bien imprégnée de cette langue! Voici un texte d'ancien français rédigé vers 1040 et extrait de La vie de saint Alexis. Dans ce document, Alexis renonce à sa femme, à sa famille et à la «vie dans le monde» pour vivre pauvre et chaste.
C'est l'un des premiers textes écrits en ancien français qui nous soit parvenu. Il s'agit ici d'un petit extrait d'un poème de 125 strophes. Ce n'est donc pas une transcription fidèle de la langue parlée du XIe siècle, même s'il faut savoir que la graphie était relativement phonétique et qu'on prononçait toutes les lettres:
Ancien français
1. bons fut li secles al tens ancïenur
2. quer feit iert e justise et amur,
3. si ert creance, dunt ore n'i at nul prut;
4. tut est müez, perdut ad sa colur:
5. ja mais n'iert tel cum fut as anceisurs.
6. al tens Nöé et al tens Abraham
7. et al David, qui Deus par amat tant,
8. bons fut li secles, ja mais n'ert si vailant;
9. velz est e frailes, tut s'en vat remanant:
10. si'st ampairet, tut bien vait remanant
11. puis icel tens que Deus nus vint salver
12. nostra anceisur ourent cristïentet,
13. si fut un sire de Rome la citet:
14. rices hom fud, de grant nobilitet;
15. pur hoc vus di, d'un son filz voil parler.
16. Eufemïen -- si out annum li pedre --
17. cons fut de Rome, des melz ki dunc ieret;
18. sur tuz ses pers l'amat li emperere.
19. dunc prist muiler vailante et honurede,
20. des melz gentils de tuta la cuntretha
21. puis converserent ansemble longament,
22. n'ourent amfant peiset lur en forment
23. e deu apelent andui parfitement:
24. e Reis celeste, par ton cumandement
25. amfant nus done ki seit a tun talent.Français contemporain
1. Le monde fut bon au temps passé,
2. Car il y avait foi et justice et amour,
3. Et il y avait crédit ce dont maintenant il n'y a plus beaucoup;
4. Tout a changé, a perdu sa couleur:
5. Jamais ce ne sera tel que c'était pour les ancêtres.
6. Au temps de Noé et au temps d'Abraham
7. Et à celui de David, lesquels Dieu aima tant.
8. Le monde fut bon, jamais il ne sera aussi vaillant;
9. Il est vieux et fragile, tout va en déclinant:
10. Tout est devenu pire, bien va en déclinant (?)
11. Depuis le temps où Dieu vint nous sauver
12. Nos ancêtres eurent le christianisme.
13. Il y avait un seigneur de Rome la cité:
14. Ce fut un homme puissant, de grande noblesse;
15. Pour ceci je vous en parle, je veux parler d'un de ses fils.
16. Eufemïen -- tel fut le nom du père --
17. Il fut comte de Rome, des meilleurs qui alors y étaient
18. L'empereur le préféra à tous ses pairs.
19. Il prit donc une femme de valeur et d'honneur,
20. Des meilleurs païens de toute la contrée.
21. Puis ils parlèrent ensemble longuement.
22. Qu'ils n'eurent pas d'enfant; cela leur causa beaucoup de peine.
23. Tous les deux ils en appellent à Dieu parfaitement
24. «Ô! Roi céleste, par ton commandement,
25. Donne-nous un enfant qui soit selon tes désirs.»Pour un francophone contemporain, il ne s'agit pas d'un texte français, mais plutôt d'un texte qui ressemble au latin. Pourtant, ce n'est plus du latin, mais du français, un français très ancien dont les usages sont perdus depuis fort longtemps.
1.3 L'expansion du français en Angleterre
Au cours du Xe siècle, les rois furent souvent obligés de mener une vie itinérante sur leur petit domaine morcelé et pauvre. Incapable de repousser les envahisseurs vikings (ces «hommes du Nord» — Northmans — venus de la Scandinavie), Charles III le Simple leur concéda en 911 une province entière, la Normandie. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte cédait au chef Rollon le comté de Rouen, qui deviendra le duché de Normandie. En échange, Rollon s'engageait à bloquer les incursions vikings menaçant le royaume des Francs et demeurait vassal du roi et devenait chrétien en 912 en la cathédrale de Rouen sous le nom de Robert (Robert Ier le Riche).
- L'assimilation des Vikings
Les Vikings de Normandie, comme cela avait été le cas avec les Francs, perdirent graduellement leur langue scandinave, le vieux norrois apparenté au danois. Dans leur duché, désormais libérés de la nécessité de piller pour survivre, les Vikings devinrent sédentaires et fondèrent des familles avec les femmes du pays. Celles-ci parlaient ce qu'on appellera plus tard le normand, une langue romane qu'elles ont apprise naturellement à leurs enfants. On estime que le langue des Vikings, encore vivante à Bayeux au milieu du
Xe siècle, n'a pas survécu bien longtemps au-delà de cette date. Autrement dit, l'assimilation des vainqueurs vikings s'est faite rapidement et sans trop de problèmes. L'héritage linguistique des Vikings se limite à moins d'une cinquantaine de mots, presque exclusivement des termes maritimes: cingler, griller, flâner, crabe, duvet, hauban, hune, touer, turbot, guichet, marsouin, bidon, varech, homard, harfang, etc.
Moins d'un siècle après leur installation en Normandie, ces anciens Vikings, devenus des Normands, prirent de l'expansion et partirent chercher fortune par petits groupes en Espagne en combattant les Maures aux côtés des rois chrétiens du Nord (1034-1064), ainsi qu'en Méditerranée, en Italie du Sud et en Sicile, jusqu’à Byzance, en Asie mineure et en «Terre Sainte» lors des croisades. Partout, les Normands répandirent le français hors de France.
- Les prétentions à la couronne anglaise
De plus, le duc de Normandie devint plus puissant que le roi de France avec la conquête de l'Angleterre. Rappelons que les Normands étaient depuis longtemps en contact avec l'Angleterre; ils occupaient la plupart des ports importants face à l’Angleterre à travers la Manche.
Cette proximité entraîna des liens encore plus étroits lors du mariage en 1002 de la fille du duc Richard II de Normandie, Emma, au roi Ethelred II d'Angleterre. À la mort d'Édouard d'Angleterre en 1066, son cousin, le duc de Normandie appelé alors Guillaume le Bâtard — il était le fils illégitime du duc de Normandie, Robert le Magnifique, et d'Arlette, fille d'un artisan préparant des peaux — décida de faire valoir ses droits sur le trône d'Angleterre.
C'est par sa parenté avec la reine Emma (décédée en 1052) que Guillaume, son petit-neveu, prétendait à la couronne anglaise. Selon les anciennes coutumes scandinaves, les mariages dits en normand à la danesche manere («à la danoise») désignaient la bigamie pratiquée par les Vikings implantés en Normandie et, malgré leur conversion officielle au christianisme, certains Normands avaient plusieurs femmes. Or, les enfants nés d'une frilla, la seconde épouse, étaient considérés comme parfaitement légitimes par les Normands, mais non par l'Église. Autrement dit, Guillaume n'était «bâtard» qu'aux yeux de l'Église, car il était légalement le successeur de son père, Robert le Magnifique (v. 1010-1035).
- La bataille de Hastings (14 octobre 1066)
Avec une armée de 6000 à 7000 hommes, quelque 1400 navires (400 pour les hommes et 1000 pour les chevaux) et... la bénédiction du pape, Guillaume II de Normandie débarqua dans le Sussex, le 29 septembre, puis se déplaça autour de Hastings où devait avoir lieu la confrontation avec le roi Harold II. Mais les soldats de Harold, épuisés, venaient de parcourir 350 km à pied en moins de trois semaines, après avoir défait la dernière invasion viking à Stamford Bridge, au centre de l'Angleterre, le 25 septembre 1066.
Le 14 octobre, lors de la bataille de Hastings, qui ne dura qu'une journée, Guillaume réussit à battre Harold II, lequel fut même tué. Le duc Guillaume II de Normandie, appelé en Angleterre «William the Bastard» (Guillaume le Bâtard), devint ainsi «William the Conqueror» (Guillaume le Conquérant). Le jour de Noël, il fut couronné roi en l'abbaye de Westminster sous le nom de Guillaume Ier d'Angleterre.
- Les nouveaux maîtres et la langue
Le nouveau roi s'imposa progressivement comme maître de l'Angleterre durant les années qui suivirent. Il évinça la noblesse anglo-saxonne qui ne l'avait pas appuyé et favorisa ses barons normands et élimina aussi les prélats et les dignitaires ecclésiastiques anglo-saxons en confiant les archevêchés à des dignitaires normands.
On estime à environ 20 000 le nombre de Normands qui se fixèrent en Angleterre à la suite du Conquérant. Par la suite, Guillaume Ier (1066-1087) exerça sur ses féodaux une forte autorité et devint le roi le plus riche et le plus puissant d'Occident. Après vingt ans de règne, l'aristocratie anglo-saxonne était complètement disparue pour laisser la place à une élite normande, tandis qu'il n'existait plus un seul Anglais à la tête d'un évêché ou d'une abbaye. La langue anglaise prit du recul au profit du franco-normand.
Guillaume Ier d'Angleterre et les membres de sa cour parlaient une variété de français appelé aujourd’hui le franco-normand (ou anglo-normand), un «françois» teinté de mots nordiques apportés par les Vikings qui avaient, un siècle auparavant, conquis le nord de la France. À partir ce ce moment, le mot normand perdit son sens étymologique d'«homme du Nord» pour désigner un «habitant du duché de Normandie».
La conséquence linguistique de Guillaume le Conquérant fut d’imposer le franco-normand, considéré comme du «françois» plus local, dans la vie officielle en Angleterre. Alors que les habitants des campagnes et la masse des citadins les plus modestes parlaient l’anglo-saxon, la noblesse locale, l’aristocratie conquérante, ainsi que les gens d'Église et de justice, utilisaient oralement le franco-normand, mais le clergé, les greffiers, les savants et les lettrés continuaient pour un temps d'écrire en latin.
Le françois de France, pour sa part, acquit également un grand prestige dans toute l'Angleterre aristocratique. En effet, comme tous les juges et juristes étaient recrutés en France, le «françois» de France devint rapidement la langue de la loi et de la justice, sans compter que de nombreuses familles riches et/ou nobles envoyaient leurs enfants étudier dans les villes de France.
Le premier roi de la dynastie des Plantagenêt, Henri II, du fait de son mariage avec Aliénor d'Aquitaine en 1152, englobait, outre l'Irlande et l'Écosse, plus de la moitié occidentale de la France. Bref, Henri II gouvernait un royaume allant de l'Écosse aux Pyrénées: c'était la plus grande puissance potentielle de l'Europe. Par la suite, Philippe Auguste reprit aux fils d'Henri II, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, la majeure partie des possessions françaises des Plantagenêt (Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Poitou, Aquitaine, Limousin et Bretagne). À ce moment, toute la monarchie anglaise parlait «françois», et ce, d'autant plus que les rois anglais épousaient uniquement des princesses françaises (toutes venues de France entre 1152 et 1445). Il faut dire aussi que certains rois anglais passaient plus de temps sur le continent qu'en Grande-Bretagne. Ainsi, Henri II passa 21 ans sur le continent en 34 ans de règne.
Lorsque, en 1259, Henri III d’Angleterre renonça officiellement à la possession de la Normandie, la noblesse anglaise eut à choisir entre l'Angleterre et le Continent, ce qui contribua à marginaliser le franco-normand au profit, d'une part, du français parisien, d'autre part, de l'anglais.
1.4 La langue du roi de France
Au cours du XIIe siècle, on commença à utiliser le «françois» à l'écrit, particulièrement dans l'administration royale, qui l'employait parallèlement au latin. Sous Philippe Auguste (1165-1223), le roi de France avait considérablement agrandi le domaine royal: après l'acquisition de l'Artois, ce fut la Normandie, suivie de la Touraine, de l'Anjou et du Poitou. C'est sous son règne que se développa l'administration royale avec la nomination des baillis dans le nord du pays, des sénéchaux dans le Sud.
Mais c'est au XIIIe siècle qu'apparurent des œuvres littéraires en «françois». À la fin de ce siècle, le «françois» s'écrivait en Italie (en 1298, Marco Polo rédigea ses récits de voyages en françois), en Angleterre (depuis la conquête de Guillaume le Conquérant), en Allemagne et aux Pays-Bas. Évidemment, le peuple ne connaissait rien de cette langue, même en Île-de-France (région de Paris) où les dialectes locaux continuaient de subsister.
Lorsque Louis IX (dit «saint Louis») accéda au trône de France (1226-1270), l 'usage du «françois» de la Cour avait plusieurs longueurs d'avance sur les autres parlers en usage. Au fur et à mesure que s'affermissait l'autorité royale et la centralisation du pouvoir, la langue du roi de France gagnait du terrain, particulièrement sur les autres variétés d'oïl. Mais, pour quelques siècles encore, le latin gardera ses prérogatives à l'écrit et dans les écoles. De fait, après plusieurs victoires militaires royales, ce françois prit le pas sur les les autres langues d'oïl (orléanais, champenois, angevin, bourbonnais, gallo, picard, etc.) et s'infiltra dans les principales villes du Nord avant d'apparaître dans le Sud. À la fin de son règne, Louis IX était devenu le plus puissant monarque de toute l'Europe, ce qui allait assurer un prestige certain à sa langue, que l'on appelait encore le françois.
A l'époque de l'ancien français (françois), les locuteurs semblent avoir pris conscience de la diversité linguistique des parlers du nord de la France. Comme les parlers d'oïl différaient quelque peu, ils étaient généralement perçus comme des variations locales d'une même langue parce que de village en village chacun se comprenait.
Thomas d'Aquin (1225-1274), théologien de l'Église catholique, donne ce témoignage au sujet de son expérience: «Dans une même langue [lingua], on trouve diverses façons de parler, comme il apparaît en français, en picard et en bourguignon; pourtant, il s'agit d'une même langue [loquela].» Cela ne signifie pas cependant que la communication puisse s'établir aisément. De plus, les jugements de valeur sur les «patois» des autres étaient fréquents. Dans le Psautier de Metz (ou Psautier lorrain) rédigé vers 1365, l'auteur, un moine bénédictin de Metz, semble déplorer que les différences de langage puisse compromettre la compréhension mutuelle:
En françois d'époque Et pour ceu que nulz ne tient en son parleir ne rigle certenne, mesure ne raison, est laingue romance si corrompue, qu'a poinne li uns entent l'aultre et a poinne puet on trouveir a jour d'ieu persone qui saiche escrire, anteir ne prononcieir en une meismes meniere, mais escript, ante et prononce li uns en une guise et li aultre en une aultre.
En traduction [Et parce que personne, en parlant, ne respecte ni règle certaine ni mesure ni raison, la langue romane est si corrompue que l'on se comprend à peine l'un l'autre et qu'il est difficile de trouver aujourd'hui quelqu'un qui sache écrire, converser et prononcer d'une même façon, mais chacun écrit, converse et prononce à sa manière.]
Conon de Béthune (v. 1150-1220) est un trouvère né en Artois et le fils d'un noble, Robert V de Béthune. Il a participé aux croisades et a tenu à son époque un rôle politique important. Il doit surtout sa renommée aux chansons courtoises qu'il a écrites. Lors d'un séjour à la cour de France en 1180, il chanta ses œuvres devant Marie de Champagne et Adèle de Champagne, la mère du roi Philippe Auguste. Le texte qui suit est significatif à plus d'un titre, car Conon de Béthune oppose deux «patois», le picard d'Artois et le «françois» de l'Île-de-France:
La roine n'a pas fait ke cortoise,
Ki me reprist, ele et ses fieux, li rois,
Encor ne soit ma parole françoise;
Ne child ne sont bien apris ne cortois,
Si la puet on bien entendre en françois,
S'il m'ont repris se j'ai dit mots d'Artois,
Car je ne fui pas norris à Pontoise.[La reine ne s'est pas montrée courtoise,
lorsqu'ils m'ont fait des reproches, elle et le roi, son fils.
Certes, mon langage n'est pas celui de France,
mais on peut l'apprendre en bon français.
Ils sont malappris et discourtois
ceux qui ont blâmé mes mots d'Artois,
car je n'ai pas été élevé à Pontoise.]Si le poète considère que ses «mots d'Artois» constituent une variante légitime du français, le roi et la reine estiment que l'emploi des picardismes est une façon de ne pas respecter le bon usage de la Cour et qu'il faut adopter une langue plus proche de celle du roi, ce qu'on appelle alors le «langage de France», c'est-à-dire la «langue de l'Île-de-France». Déjà à cette époque, les parlers locaux sont perçus de façon négative. Dans le Tournoi de Chauvency écrit en 1285, le poète Jacques Bretel oppose le «bon françois» au «valois dépenaillé» (walois despannei):
Lors commença a fastroillier
Et le bon fransoiz essillier,
Et d'un walois tout despannei
M'a dit: «Bien soiez vos venei,
Sire Jaquemet, volontiers.»[Il commença alors à baragouiner
et à massacrer le bon français,
dans un valois tout écorché
il me dit: «Soyez le bienvenu,
Monsieur Jacquemet, vraiment!»]Dans d'autres textes, on parle du «langage de Paris». Ce ne sont là que quelques exemples, mais ils témoignent éloquemment que le «françois» parlé à la Cour du roi et à Paris jouissait dans les milieux aristocratiques d'un prestige supérieur aux autres parlers. Ainsi, la norme linguistique choisie devient progressivement le «françois» de l'Île-de-France qui se superposa aux autres «langages», sans les supprimer.
Mais il faut faire attention, car la langue nationale qui commence à s'étendre au royaume de France n'est pas le «langage de Paris», plus précisément le parler des «vilains», c'est-à-dire celui des manants, des paysans et des roturiers, mais c'était le «françois» qui s'écrivait et qui était parlé à la Cour de France, donc la variété cultivée et socialement valorisée du «françois». Voici un témoignage intéressant à ce sujet; il provient d'un poème biblique (1192) rédigé par un chanoine du nom de Evrat, de la collégiale Saint-Étienne de Troyes:
Tuit li languages sunt et divers et estrange
Fors que li languages franchois:
C'est cil que deus entent anchois,
K'il le fist et bel et legier,
Sel puet l'en croistre et abregier
Mielz que toz les altres languages.[Toutes les langues sont différentes et étrangères
si ce n'est la langue française;
c'est celle que Dieu perçoit le mieux,
car il l'a faite belle et légère,
si bien que l'on peut l'amplifier ou l'abréger
mieux que toutes les autres.]Selon ce point de vue, le «françois» est ni plus ni moins de nature divine! C'est la plus belle langue, après le latin, et après le grec et l'hébreu, les trois langues des Saintes Écritures. Mais ce français c'était également le «françois» de l'Administration royale, celui des baillis et des sénéchaux, qui devaient être gentilshommes de nom et d'armes, ainsi que de leurs agents (prévôts, vicomtes, maires, sergents, forestiers, etc.).
Ce personnel administratif réparti dans toute la France exerçait au nom du roi tous les pouvoirs: ils rendaient la justice, percevaient les impôts, faisaient respecter la loi et l'ordre, recevaient les plaintes des citoyens, etc. Ces milliers de fonctionnaires — déjà 12 000 vers 1500 — étaient bilingues et pouvaient s'exprimer dans un «françois» assez normalisé. Près du tiers des commis de l'État se trouvait à Paris, que ce soit au Parlement, à la Chambre des comptes, à la Chancellerie, à la Cour du trésor, à la Cour des aides, etc.
À la fin du Moyen Âge, on trouvait partout en France des gens pouvant se faire comprendre en «françois». Dans son Esclarcissement de la langue francoyse écrit en anglais (1530), John Palsgrave apporte ce témoignage: «Il n'y a pas non plus d'homme qui ait une charge publique, qu'il soit capitaine, ou qu'il occupe un poste d'indiciaire, ou bien qu'il soit prédicateur, qui ne parle le parfait françois, quel que soit son lieu de résidence.» D'ailleurs, dès 1499, une ordonnance royale exigeait que les sergents royaux sachent lire et écrire le «françois».
T
ous ces gens écrivaient et produisaient en français des actes, procès-verbaux, comptes, inventaires, suppliques, pétitions, etc. C'est ainsi que la bureaucratisation a pu jouer un rôle primordial dans l'expansion de la «langue du roi». À partir du XIIe siècle, on s'est mis à écrire des chansons de geste, des chansons de trouvère, des fabliaux, des contes, des ouvrages historiques, des biographies de saints, des traductions de la Bible, etc., le tout en «françois du roi». Avec l'apparition de l'imprimerie dès 1470 en France, le français du roi était assuré de gagner la partie sur toute autre langue dans le royaume.
En même temps, les paysans qui constituaient quelque 90 % de la population, continuaient de pratiquer leur langue maternelle régionale. Parfois, des mots du «françois» pouvaient s'implanter dans leur vocabulaire, mais sans plus. Dans les écoles, on enseignait le latin, quitte à passer par le «françois» ou le patois pour expliquer la grammaire latine. Avec le temps, les écoles des villes se mirent à enseigner la langue françoise.
À la fin du Moyen Âge, la majorité des citadins pouvait lire le «françois», sans nécessairement l'écrire. Dans les campagnes, l'analphabétisme régnait, mais beaucoup de paysans pouvaient lire en «françois» des textes simples comme des contrats de mariage, des testaments, des actes de vente, des créances, etc.
2 L'état de l'ancien français
L'ancien français a transformé considérablement la langue romane au point de la rendre méconnaissable.
2.1 Le système phonétique
L'ancien français présentait un système phonétique de transition très complexe, qui ne devait pas durer. Il possédait de nombreux sons ignorés aussi bien du latin et du roman que du français moderne. Cet ancien français du XIIe siècle se caractérise par la surabondance au plan phonétique. Il s'agit bien de surabondance plutôt que de richesse fonctionnelle, car si le nombre des voyelles et des consonnes demeure élevé, leur rendement phonologique s'avère faible.
- La prononciation des consonnes
En finale de mot, la règle était de prononcer toutes les consonnes écrites. Cependant, les lettres n'avaient pas la même valeur qu'on leur donne actuellement. Ainsi, le -t final s'est prononcé [θ] (comme le th sourd de l'anglais) jusqu'à la fin du XIe siècle, dans des mots comme aimet, chantet et vertut; toutefois, ce [θ] constrictif est tombé en désuétude et il devait être rare dès le début du XIIe siècle.
Contrairement à ce qui se passe en français moderne, tous les -s du pluriel se faisaient entendre. Par exemple, chevaliers et les omes (hommes) se prononçaient [tchëvaljèrs] et [lèzom-mës]. La lettre finale -z des mots tels amez (aimez), chantez, dolz (doux) avait la valeur de l'affriquée [ts]. Enfin, la lettre -l était mouillée (palatalisée) en [λ] en fin de mot: il = [iλ], soleil = [sòlèλ], peril = [periλ].
Rappelons que la période romane avait introduit la prononciation d'un [h] dit «aspiré» dans des mots d'origine francique comme honte, haine, hache, haïr, hêtre, héron. etc. Cette prononciation du [h] s'est atténuée au cours de l'ancien français, qui finira par ne plus écrire le h initial dans la graphie. Par exemple, le mot « homme» du français moderne s'écrivait ome (du latin hominem) en ancien français. Le h graphique a été réintroduit dans les siècles suivants soit par souci étymologique (p. ex. ome < lat. hominem > homme) soit pour interdire la liaison (p. ex. harnais, hutte, etc.).
L'un des traits caractéristiques de cet état de langue ancien résidait dans la présence des consonnes affriquées. Au nombre de quatre, elles correspondaient aux sons [ts], [dz], [tch] et [dj]comme dans djihad. Dans la graphie, elles étaient rendues respectivement par c (devant e et i) et -z en finale, par z à l'intérieur du mot, par ch, et par g (devant e et i) ou j (devant a, o, u). Le graphème ë correspond au son [e] neutre comme dans cheval ou chemin; en finale de mot, les e se prononçaient tous: cire, place, argile, d'où le [ë] dans le tableau ci-dessous.
Lettres Son Ancien français Prononciation Français moderne c + i
c + e-z
[ts]
cire
placeamez
marz[tsirë]
[platsë][amèts]
[marts]cire
placeaimez
mars-z- [dz]
treize
raizon[treidzë]
[raidzon-n]treize
raisong + e
g + ij + a
j + o
j + u[dj]
gesir
argilejambe
jorn
jugier[djézir]
[ardjilë][djam-mbë]
[djòrn]
[djudjjèr]gésir
argilejambe
jour
jugerch- [tch]
chief
sache
riche[tchièf]
[satchë]
[ritchë]chef
sache
richeDans certains mots, les consonnes nasales [m] et [n], comme on les connaît en français contemporain, avaient déjà perdu leur articulation propre à la finale dans des mots comme pain, faim, pont, blanc, brun, etc. En fait, la consonne nasale était combinée avec la voyelle qui la précède et on ne la prononçait plus, et ce, même si elle était conservée dans la graphie: pain , bon, faim, etc.
En général, en ancien français, les consonnes nasales pouvaient garder leur articulation propre et n'étaient pas nasalisées avec la voyelle précédente (comme aujourd'hui): on prononçait distinctement la voyelle nasale ET la consonne nasale. Par exemple, on prononçait les mots bien, bon, jambe, sentir, rompre, etc., en faisant bien sentir la consonne [n] ou [m].
Par exemple, dans l'adjectif bonne, non seulement la consonne était prononcée (comme aujourd'hui), mais la voyelle [ò] était nasalisée (ce qui n'est plus le cas) et la voyelle finale, prononcée: [bon + n + në], [bien + n], [djam + bë], [sen + tir], [rom + m + prë]. Il faudrait noter aussi la chute de [s] devant une consonne sourde: hoste > hôte; maistre > maître; teste > tête; coustume > coutume; forest > forêt.
- La prononciation des voyelles
Comparé au système consonantique, le système vocalique (voyelles) est encore plus complexe en ancien français du
XIIe siècle. En fait, on à peine à imaginer aujourd'hui cette surabondance des articulations vocaliques dont était caractérisée l'ancienne langue française. De plus, il est difficile de déterminer si ces articulations étaient toutes des phonèmes ou si plusieurs de celles-ci correspondaient plutôt à des variantes combinatoires; certains spécialistes n'hésitent pas à croire qu'il s'agissait d'un système phonologique plutôt que simplement phonétique.
Les voyelles de l'ancien français étaient les suivantes:
- 9 voyelles orales: [i], [é], [è], [a], [o], [ò], [ou], [u], [ë]
- 5 voyelles nasales: [an], [ein], [in], [oun], [un]
- 11 diphtongues orales: [ie], [ue], [ei], [òu], [ai], [yi], [oi], [au], [eu], [èu], [ou]
- 5 diphtongues nasalisées: [an-i], [ein-i], [i-ein], [ou-ein], [u-ein]
- 3 triphtongues: [ieu], [uou], [eau]
Ce système donne un total impressionnant de 33 voyelles. Le français moderne en compte maintenant 16 et, par rapport aux autres langues, on peut considérer que c'est déjà beaucoup. Il s'agit là d'un système que l'on pourrait qualifier d'«anormal» dans l'histoire; d'ailleurs, il sera simplifié au cours dès le XIIIe siècles.
Au début du XIIe siècle, les voyelles notées avec deux lettres correspondaient à des diphtongues. On en comptait 16, dont 11 orales et 5 nasales. Autrement dit, toutes les lettres écrites se prononçaient. Le groupe oi était diphtongué en [oi], comme dans le mot anglais boy que l'on transcrirait phonétiquement [bòj] ou [bòi]; par exemple, roi se prononçait [ròj] (ou [ròi]. Pour les autres diphtongues, il fallait prononcer en une seule émission les deux «parties» de la voyelle: [ie], [ue], [ei], etc.
Voici des exemples d'anciennes diphtongues dont on retrouve les traces encore dans la graphie d'aujourd'hui: fou, voir, feu, sauver, saut, douleur, chaise, causer, truite, etc. La diphtongue [au] était prononcée [ao] plutôt que [au], et elle est demeurée diphtonguée durant tout le début du Moyen Âge dans des mots comme saut, sauver, etc. Elle se réduira à [o] au cours du XVIe siècle.
L'ancien français possédait aussi des triphtongues: [ieu], [uou], [eau]. On en retrouve des vestiges dans des mots contemporains en [eau] comme oiseau, beau, drapeau; en ancien français ces mêmes voyelles étaient triphtonguées, plus du tout aujourd'hui.
Au cours des XIIIe et XIVe siècles, l'ancien français continuera d'évoluer. Ainsi, la graphie oi est passée de la prononciation en [oi] comme dans boy à [oé], puis [oè] et finalement [wè]: des mots comme roi, moi, loi, toi, etc., étaient donc prononcés [rwè], [mwè], [lwè], [twè], etc. La prononciation en [wa] était déjà attestée au XIIIe siècle, mais elle n'était pas généralisée. Certains critiquaient cette prononciation en [wa], car elle était surtout employée par les classes modestes; elle triomphera à la Révolution française.
Il est difficile de se faire une idée de ce qu'était, au XIIIe siècle, la prononciation de l'ancien français. En guise d'exemple, prenons ce vers tiré de la Chanson de Roland:
des peaux de chievres blanches
[des peaux de chèvres blanches]À cette époque, l'écriture était phonétique: toutes les lettres devaient se prononcer. Par rapport à la prononciation actuelle [dé-po-t'chèvr' blanch], on disait donc alors, en prononçant toutes les lettres: dé-ss péawss de tchièvress blan-ntchess. Ce qui donne 26 articulations contre 13 aujourd'hui, où l'on ne prononce plus les -s du pluriel. C'est donc une langue qui paraîtrait rude à plus d'une oreille contemporaine, sans compter la «truculence verbale» courante à l'époque.
À cet égard, on aura intérêt à lire le petit extrait du Roman de Renart (fin du XIIIe siècle) reproduit ici:
Fin XIIIe siècle
1. Dame Hermeline ot la parole
2. Respond li comme dame fole
3. jalouse fu & enflamee
4. q'ses sires lavoit amee
5. & dist : ne fuce puterie
6. & mauvestie & lecherie
7. Grant deshonor & grant putage
8. Felstes vos & grant outrage
9. q'ant vos soufrites monbaron
10. Q'vos bati vostre ort crepon.Traduction contemporaine
1. Dame Hermeline prit la parole,
2. Elle lui répond en femme folle;
3. elle était jalouse et enflammée
4. parce que son mari Hersant l'avait possédée.
5. Et elle dit : ne fut-ce conduite de putain
6. et mauvaiseté et dévergondage?
7. Un grand déshonneur et une grande putinerie,
8. voilà ce que vous avez fait avec grand outrage
9. quand vous avez laissé mon mari
10. vous frotter votre sale croupion.4.2 La grammaire
Au plan morpho-syntaxique, l'ancien français conservait encore sa déclinaison à deux cas (déclinaisons) et l'ordre des mots demeurait assez libre dans la phrase, généralement simple et brève. Jusqu'au
XIIIe siècle, les deux cas de l'ancien français sont les mêmes que pour la période romane: le cas sujet (CS) et le cas régime (CR) issu de l'accusatif latin.
Déclinaison I: CS (cas sujet)
CR (cas non sujet)li murs (le mur)
le mur (le mur)li mur (les murs)
les murs (les murs)Déclinaison II: CS (cas sujet)
CR (cas non sujet)li pere (le père)
le pere (le père)le pere (les pères)
les peres (les pères)Déclinaison III: CS (cas sujet)
CR (cas non sujet)li cuens (le comte)
le comte (le comte)li comte (les comtes)
les comtes (les comtes)De façon générale, c'est le cas régime (autre que sujet) qui a persisté en français, car la déclinaison à deux cas a commencé à s'affaiblir dès le XIIIe siècle et, à la fin du XIVe siècle, le processus était rendu à son aboutissement: il ne restait plus qu'un seul cas, le cas régime. C'est sur celui-ci que repose la forme des mots français d'aujourd'hui.
- L'article
Une autre innovation concerne l'apparition de l'article en ancien français, alors que le latin n'avait pas d'article, son système sophistiqué de déclinaison pouvant se passer de ce mot outil. Le français a développé un système d'articles à partir des démonstratifs ille/illa/illud, qui ont donné les déterminants appelés «articles définis». Les articles en ancien français se déclinaient comme les noms en CS et CR, au masculin comme au féminin. Alors qu'en français moderne, on a l'opposition le / la / les, l'ancien français opposait li / le (masc.), la (fém.) et les (plur.).
Article
définiMASCULIN FÉMININ Singulier Pluriel Singulier Pluriel CS li li la les CR le les Pour l'article indéfini, ce sont les formes uns / un (masc.) et une (fém.), alors que le pluriel était toujours marqué par uns (en français moderne: des).
Article
indéfiniMASCULIN FÉMININ Singulier Pluriel Singulier Pluriel CS uns uns une unes CR un L'emploi du genre
De façon générale, la marque du genre se trouvait en latin dans la désinence des noms et des adjectifs, c'est-à-dire dans leur terminaison. Dans l'évolution du latin vers l'ancien français, les marques du genre ont perdu leurs caractéristiques d'origine. Pour simplifier la description, on peut indiquer les grandes tendances suivantes:
1) La déclinaison féminine en -as a donné des mots du genre féminin en français: rosam > rose / rosas > roses.
2) Les pluriels neutres latins en -a ont également donné des mots au féminin en français: folia > feuille; arma > arme.
3) Les mots masculins latins en -is sont devenus masculins en français: canis > chien; panis> pain; rex/regis > roi.
4) Les noms latins terminés en -er sont aussi devenus masculins: pater > père; frater > frère; liber > livre.
Pendant la période romane, le latin a perdu le neutre qui a été absorbé par le masculin; par exemple, granum > granus > grain (masc.). Du neutre latin, granum et lactis sont passés au masculin en français; du masculin latin, floris est passé au féminin en français; par contre, gutta et tabula sont restés au féminin; mais burra (bure) a conservé le féminin du latin pour passer au masculin lorsqu'il a désigné le «bureau» en français.
Cependant, beaucoup de mots d'ancien français ont changé de genre au cours du Moyen Âge. Ainsi, étaient féminins des mots comme amour, art, évêché, honneur, poison, serpent; aujourd'hui, ces mots sont masculins. À l'opposé, des mots aujourd'hui féminins étaient alors masculins: affaire, dent, image, isle (île), ombre, etc.
- La féminisation
L'ancien français semble une langue moins sexiste que le français contemporain, du moins si l'on se fie à certaines formes qui existaient à l'époque. Voici une liste de mots au masculin et au féminin:
Notons aussi l'opposition damoiselle (fém.) / damoisel (masc.) ou damoiselle/damoiseau pour désigner les jeunes nobles (femmes ou hommes), qui n'étaient pas encore mariés; au cours des siècles, seul le mot demoiselle est resté dans la langue, alors que les formes masculines damoisel/damoiseau sont disparus. Après tous ces changements, on ne se surprendra pas qu'on en soit arrivé à une répartition arbitraire des genres en français moderne.
Dans le Guide Guide d’aide à la féminisation des noms (1999), les auteurs rapportent des exemples de termes féminisés tirés du Livre de la Taille de Paris de l’an 1296 et 1297 :
aiguilliere, archiere, blaetiere, blastiere, bouchere, boursiere, boutonniere, brouderesse, cervoisiere, chambriere, chandeliere, chanevaciere, chapeliere, coffriere, cordiere, cordoaniere, courtepointiere, couturiere, crespiniere, cuilliere, cuisiniere, escueliere, estuveresse, estuviere, feronne, foaciere, fourniere, from(m)agiere, fusicienne, gasteliere, heaulmiere, la(i)niere, lavandiere, liniere, mairesse, marchande, mareschale, merciere, oublaiere, ouvriere, pevriere, portiere, potiere, poulailliere, prevoste, tainturiere, tapiciere, taverniere, etc.
- La numération
Il faut mentionner également le système de numération qui a profondément été modifié en ancien français. Les nombres hérités du latin correspondent aux nombres de un à seize. Le nombre dix-sept, par exemple, est le premier nombre formé d'après un système populaire (logique) qui sert pour tous les nombres suivants: 10 + 7, 10 + 8, 10 + 9, etc. En ce qui concerne les noms des dizaines, le latin possédait un système décimal; ainsi, dix (< decem) vingt (< viginti), trente (< tringinta), quarante (< quadraginta), cinquante (< quinquageni) et soixante (< sexaginta) sont d'origine latine.
Il en est de même pour les formes employées en Belgique et en Suisse telles que septante (< septuaginta > septante), octante (< octoginta) ou huitante (< octoginta > oitante) et nonante (< nonaginta) dans septante-trois, octante-neuf (ou huitante-neuf), nonante-cinq, etc.
Mais, l'ancien français a adopté dès le XIIe siècle la numération normande (d'origine germanique) qui était un système vicésimal, ayant pour base le nombre vingt (écrit vint ou vin). Ce système était courant chez les peuples d'origine germanique. Selon ce système, on trouvait les formes vingt et dix (écrites vins et dis) pour 30, deux vins pour 40, trois vins pour 60, quatre vins pour 80, cinq vins pour 100, six vins pour 120, dis vins pour 200, quinze vins pour 300, etc. Encore au XVIIe siècle, des écrivains employaient le système vicésimal. Ainsi, Racine écrivait à Boileau: «Il y avait hier six vingt mille hommes ensemble sur quatre lignes.»
Le système de numération du français standard est donc hybride: il est à la fois d'origine latine et germanique. Quant à un numéral comme soixante-dix, c'est un mot composé (soixante + dix) de formation romane populaire; il faudrait dire trois-vingt-dix pour rester germanique (normand). Le numéral quatre-vingt-dix est également d'origine normande auquel s'ajoute le composé populaire [+ 10].
C'est l'Académie française qui, au XVIIe siècle, a adopté pour toute la France le système vicésimal pour 70, 80, 90, alors que le système décimal (avec septante, octante, nonante) étaient encore en usage de nombreuses régions; d'ailleurs, ce système sera encore en usage dans certaines régions en France jusque qu'après la Première Guerre mondiale.
- Les verbes
Au Moyen Âge, plusieurs verbes avaient des infinitifs différents de ceux d'aujourd'hui. Ainsi, au lieu de l'infinitif en -er (issu du latin des verbes en -are, par exemple dans cantare > chanter), on employait celui en -ir: abhorrir, aveuglir, colorir, fanir, sangloutir, toussir, etc. On trouvait aussi des infinitifs tout à fait inexistants aujourd'hui: les verbes tistre (tisser), benistre (bénir) et benire (bénir). De plus, de très nombreux verbes, fréquents au Moyen Âge, sont aujourd'hui disparus: ardoir (<ardere: brûler), bruire (<*brugere: faire du bruit), chaloir (<calere: avoir chaud), doloir (<dolere: souffrir), enfergier (<en fierges: mettre aux fers), escheler (<eschiele: monter dans une échelle), ferir (<ferire: combattre), nuisir <nocere: nuire), oisever (<*oiseus : être oisif), plaisir <placere: plaire), toster <*tostare: rôtir), vesprer < vesperare: faire nuit).
L'ancien français a fait disparaître certains temps verbaux du latin: le plus-que-parfait de l'indicatif (j'avais eu chanté), le futur antérieur (j'aurais eu chanté), l'impératif futur (?), l'infinitif passé (avoir eu chanter), l'infinitif futur (devoir chanter).
En revanche, l'ancien français a créé deux nouvelles formes: le futur en -rai et le conditionnel en -rais. Le latin avait, pour le futur et le conditionnel, des formes composées du type cantare habes (mot à mot: «tu as à chanter»: chanteras), cantare habebas (mot à mot: «tu avais à chanter»: chanterais). Fait important, l'ancien français a introduit le «que» pour marquer le subjonctif; il faut dire que la plupart des verbes étaient semblables au présent et au subjonctif (cf. j'aime / il faut que j'aime).
Enfin, la conjugaison en ancien français ne s'écrivait pas comme aujourd'hui. Jusqu'en moyen français, on n'écrivait pas de -e ni de -s à la finale des verbes de l'indicatif présent: je dy, je fay, je voy, je supply, je rendy, etc.
De plus, l'emploi du futur n'a pas toujours été celui qu'il est devenu aujourd'hui. Beaucoup écrivaient je priray (prier), il noura (nouer), vous donrez (donner), j'envoirai (envoyer), je mouverai (de mouver), je cueillirai (cueillir), je fairai (faire), je beuvrai (boire), je voirai (voir), j'arai (avoir), je sarai (savoir), il pluira (pleuvoir).
- Le participe passé
Le participe passé (avec avoir et avec être) existait en ancien français, mais il n'y avait pas de règles d'accord systématique. On pouvait au choix faire accorder le participe passé avec être ou sans auxiliaire, mais on n'accordait que rarement le participe avec avoir.
anc. fr.: Passée a la première porte.
fr. mod.: Elle a passé la première porte.En général, le participe passé ne s'accordait pas avec un nom qui le suivait: Si li a rendu sa promesse.
Néanmoins, cette langue restait encore assez près du latin d'origine. En fait foi cette phrase, extraite de la Quête du Graal de 1230, correspondant certainement à du latin francisé: «Sache que molt t'a Notre Sire montré grand débonnaireté quand il en la compagnie de si haute pucelle et si sainte t'a amené.» Pour ce qui est de l'orthographe, elle n'était point encore fixée et restait très calquée sur les graphies latines.
- La phrase
La phrase de l'ancien français ressemble relativement à celle du français moderne dans la mesure où elle respecte l'ordre sujet + verbe + complément avec certaines différences, alors que l'ordre des mots en latin pouvait être plus complexe. En voici un exemple tiré de La Mort du roi Arthur, rédigé vers 1120-1240 par un auteur anonyme:
"Sire, fet Agravains, oïl, et ge vos dirai comment." Lors le tret a une part et li dist a conseill : "Sire, il est einsi que Lancelos ainme la reïne de fole amour et la reïne lui. Et por ce qu'il ne pueent mie assembler a leur volenté quant vos i estes, est Lancelos remés, qu'il n'ira pas au tornoiement de Wincestre ; einz i a envoiez ceus de son ostel, si que, quant vos seroiz meüz ennuit ou demain, lors porra il tout par loisir parler a la reïne." [«Oui, sire, dit Agravain, je vais vous expliquer comment.» Il l'entraîna à l'écart et lui dit à voix basse : «Sire, la situation est telle que Lancelot et la reine s'aiment d'un amour coupable. Comme ils ne peuvent pas se rencontrer à leur aise quand vous êtes là, Lancelot est resté chez lui et n'ira pas au tournoi de Wincestre; mais il y a envoyé ceux de sa maison, si bien qu'après votre départ, ce soir ou demain, il aura tout le loisir de parler avec la reine.»] 3 Les langues parlées en France
Dans la France de cette époque, les locuteurs du pays parlaient un grand nombre de langues. Généralement, ils ignoraient le latin d'Église, à moins d'être instruits, ce qui était rarissime. Ils ignoraient également le «français du roy», sauf dans la région de l'Île-de-France, d'où allait émerger une sorte de français populaire parlé par les classes ouvrières.
Pour résumer rapidement la situation linguistique, on peut dire que les habitants de la France parlaient, selon les régions:
- diverses variétés de langues d'oïl: françois picard, gallo, poitevin, saintongeais, normand, morvandiau, champenois, etc.
- diverses variétés des langues d'oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat-limousin, alpin-dauphinois, etc.) ainsi que le catalan;
- diverses variétés du franco-provençal: bressan, savoyard, dauphinois, lyonnais, forézien, chablais, etc., mais aussi, en Suisse, genevois, vaudois, neuchâtelois, valaisan, fribourgeois et, en Italie, le valdôtain.
- des langues germaniques: francique, flamand, alsacien, etc.
Bref, à cette époque, le français n'était qu'une langue minoritaire parlée dans la région de l'Île-de-Francemme langue maternelle) et en province par une bonne partie de l'aristocratie (comme langue seconde)
4 La domination culturelle du latin
Pendant la période féodale, le prestige de l'Église catholique en Europe était immense. Le pape agit comme un véritable arbitre supranational à qui devaient obéissance les rois et l'empereur du Saint Empire romain germanique.
4.1 La langue de prestige
Non seulement le latin était la langue du culte, donc de tout le clergé et des abbayes, mais il demeurait l'unique langue de l'enseignement, de la justice et des chancelleries royales (sauf en France et en Angleterre, où l'on employait le français pour les communications entre les deux royaumes); c'était aussi la langue des sciences et de la philosophie. Il faudra attendre le
XIIIe siècle pour voir apparaître timidement les premiers textes de loi en «françois». Sous Charles IV (1322-1328), une charte sur dix seulement était rédigée en «françois». Sous Philippe VI (1328-1350), le latin dominait encore largement au début de son règne, mais à la fin les trois quarts des chartes étaient rédigées en «françois».
Les gens instruits devaient nécessairement se servir du latin comme langue seconde: c’était la langue véhiculaire internationale dans tout le monde catholique. Hors d'Europe, le turc, l'arabe, le chinois et le mongol jouaient un rôle analogue. C'est pourquoi les princes du royaume de France se devaient de connaître le latin. Le poète Eustache Deschamps (v.1346-v.1407) affirme, par exemple, qu'un roi sans lettres (comprendre «illettré» ou «sans latin» était un «âne» couronné:
Roy sanz lettres comme un asne seroit
S'il ne sçavoit l'Escripture ou les loys,
Chacun de ly par tout se moqueroit;
Thiés doivent savoir, latin, françoys,
Pour miex garder leurs pas et leurs destrois
Et sagement à chascun raison rendre.[Un roi illettré serait comme un âne
s'il ne connaissait l'écriture ou les lois,
car partout chacun se moquerait de lui ;
les Allemands doivent connaître le latin et le français,
pour mieux conserver leurs droits et leur juridiction
et que chacun rende justice avec sagesse.]Néanmoins, malgré cette exigence du latin chez les aristocrates de haut rang, les faits ont souvent démontré que la maîtrise du latin demeurait souvent un voeu pieux. C'est pourquoi beaucoup de nobles, qui qui avaient des connaissances rudimentaires de latin, embauchaient des traducteurs. S'il est difficile de savoir le degré de connaissance du latin de l'aristocratie française du Moyen Âge, il est par contre plus aisé de supposer que l'aristocratie occitane ait pu maintenir un plus grand bilinguisme.
4.2 La création des latinismes
De fait, le Moyen Âge fut une époque de traduction des oeuvres rédigées en latin. Or, ces traductions furent très importantes, car elles ont introduit une quantité impressionnante de mots savants issus du latin biblique, surtout à partir du XIIe siècle. Ainsi, des noms de peuples juifs ont été francisés: israelite, philistin, sodomite, etc.
De nombreux mots grecs sont passé au français dans les traductions du Nouveau Testament: ange, cataracte, Christ, eglise, synagogue, holocauste, orphelin, paradis, patriarche, prophete/prophetesse, psaume, psautier, scandale, etc. Les latinismes passent au français par les traductions de la Vulgate: abominer, abomination, abominable, adorer, arche, circoncision, confondre, confusion, consommer, consommation, contrition, convertir, deluge, etc.
Dans la Bible historiale completee (vers 1380-1390) de Guyart des Moulins, on peut relever plusieurs doublets pour traduire un même mot latin, l'un provenant du latin biblique (lingua latina), l'autre du «françois» vulgaire (lingua gallica):
arche
iniquité
misericorde
omnipotent
opprobe
redempteur
ternerhuche
felunie
merci
tout puissant
reproce
rachateor
assayerAutrement dit, dès l'apparition du plus ancien français, la langue puisa directement dans le latin les mots qui lui manquaient. Il était normal que l'on songe alors à recourir au latin, langue que tout lettré connaissait. Dans de nombreux cas, le mot emprunté venait combler un vide; dans d'autres cas, il doublait, comme on vient de le voir, un mot latin d'origine et les deux formes (celle du latin populaire et celle de l'emprunt savant) coexistèrent avec des sens et des emplois toujours différents. Commençons avec les mots nouveaux qui ne viennent pas doubler une forme déjà existante.
Afin de combler de nouveaux besoins terminologiques, l'Église catholique a elle-même donné l'exemple en puisant dans le vocabulaire latin pour se procurer les mots qui lui manquaient: abside, abomination, autorité, discipline, glorifier, majesté, opprobe, pénitence, paradis, quotidien, résurrection, humanité, vérité, virginité, etc. La philosophie a fait de même et est allée chercher des mots comme allégorie, élément, forme, idée, matière, mortalité, mutabilité, multiplier, précepte, question, rationnel, substance, etc.
Nous devons aux juristes des termes comme dépositaire, dérogatoire, légataire, transitoire, etc. Mais c'est du domaine des sciences que l'ancien français a dû puiser le plus abondamment dans le fonds latin: améthiste, aquilon, aromatiser, automnal, azur, calendrier, diurne, emblème, équinoxe, fluctuation, occident, solstice, zone, etc. Les emprunts au latin classique comptent sûrement quelques dizaines de milliers de termes.
4.3 Un phénomène ininterrompu de latinisation
En fait, cet apport du latin classique n'a jamais cessé d'être productif au cours de l'histoire du français. Le mouvement, qui a commencé même un peu avant le IXe siècle, s'est poursuivi non seulement durant tout le Moyen Âge, mais aussi à la Renaissance et au XVIIIe siècle pour se perpétuer encore aujourd'hui.
C'est au cours de cette période de l'ancien français que commença la latinisation à l'excès et qui atteindra son apogée au XVe siècle, avec le moyen français. L'expression «escumer le latin» est apparue au début du XIIe siècle.
Elle désignait les latiniseurs qui «volaient» ou «pillaient» les ressources du latin, à l'exemple des pirates qui écumaient les mers. Les savants latiniseurs avaient développé un procédé lexical efficace qui consistait à ajouter une désinence «françoise» à un radical latin (savant).
Dans ces conditions d'usage intensif du latin par les savants du Moyen Âge, il était préférable d'écrire dans cette langue pour acquérir un prestige supérieur à celui qui n'écrivait qu'en «françois» (ou en tudesque), car le latin écrit était une langue européenne internationale permettant de communiquer avec l'ensemble des autres savants de l'époque.
Qui plus est, une œuvre écrite en français pouvait être traduite en latin afin d'atteindre la célébrité. Cependant, à la fin du XIIIe siècle, la production latine sera en baisse auprès de la Cour et aura tendance à se replier vers l'école et les sciences, sauf en Angleterre qui avait déjà tourné le dos au latin et qui considérait que le français était aussi une langue de vulgarisation scientifique.
5 L'influence de la langue arabe
C'est grâce à la diffusion de l'islam que la langue arabe s'est répandue après le VIe siècle. Cette langue, l'arabe littéraire ou coranique, fut codifiée et acquit alors le statut de langue savante, ce qui n'était pas le cas du français de l'époque. Puis le rayonnement de la langue et de la culture arabes progressa lors des conquêtes territoriales pendant tout le Moyen Âge.Les villes saintes de La Mecque et de Médine devinrent des centres religieux et intellectuels très importants. C'est par les ouvrages traduits en arabe que les intellectuels chrétiens d'Occident découvrirent la philosophie grecque ainsi que les sciences et les techniques des Anciens.Par exemple, les œuvres du mathématicien Euclide, de l'astronome Ptolémée, des médecins Hippocrate et Galien, du philosophe Aristote. De cette façon, les Arabes transmirent également les cultures indienne, perse et grecque, notamment en algèbre, en médecine, en philosophie, en alchimie, en botanique, en astronomie et en agronomie. Il faut comprendre qu'avec les œuvres se sont aussi transmis les mots.5.1 Les emprunts au français
De fait, la langue arabe a donné quelques centaines de mots au français, notamment au cours des XIIe et XIIIe siècles, mais encore au XIVe siècle. Ainsi, les savants arabes fournirent au français, directement ou par l'intermédiaire d'autres langues (le latin médiéval et l'espagnol), des termes d'origine arabo-persane tels que échec (jeu), jasmin, laque, lilas, safran ou timbale.
C'est ainsi que le français emprunta à l'arabe des mots liés aux sciences, aux techniques et au commerce : abricot, alambic, alchimie, algèbre, almanach, ambre, azur, chiffre, coton, douane, girafe, hasard, épinard, jupe, magasin, matelas, nénuphar, orange, satin, sirop, sucre, tare. N'oublions pas qu'au XIe siècle les plus grands noms de la littérature, de la philosophie et de la science sont arabes.
La science moderne, particulièrement la médecine, l'alchimie, les mathématiques et l'astronomie, est d'origine arabe. Dans ces conditions, il était normal que la langue arabe exerce une influence importante sur les autres langues. Cependant, l'arabe n'a transmis directement au français qu'un petit nombre de mots; la plupart des mots arabes nous sont parvenus par l'intermédiaire du latin médiéval, de l'italien, du provençal, du portugais et de l'espagnol.
De plus, les Arabes avaient eux-mêmes emprunté un certain nombre de mots au turc, au persan ou au grec. Comme on le constate, les mots «voyagent» et prennent parfois de longs détours avant de s'intégrer dans une langue donnée. En voici quelques exemples de l'arabe ayant passé auparavant par le grec, le portu8gais, le latin, l'italien, l'espagnol, etc.:
abricot (port.)
alambic (grec)
alchimie (grec)
alcool (lat.)
alezan (esp.)
algarade (esp.),
algèbre (lat.)
algorithme
amiral
arabesque (it.)
arsenal (it.)
assassin (it.)
azimut
balais (lat.)
bédouincalife (it.)
carafe (it./esp.),
cheik
chiffre (it.)
coton (it.),
couscous
douane (it.)
échec (persan)
élixir (grec)
épinard (lat.)
estragon (grec)
fakir
gazelle,
gilet (esp.)
girafe (it.)goudron
guitare (esp.)
hachisch
harem
iman (turc)
jarre (prov.)
jupe (it.)
laquais (esp.)
laque (prov.)
lilas (it.)
matelas (it.)
minaret (turc)
moka
momie
mosquée (it.)nénuphar (lat.)
orange (prov.)
raquette (lat.)
récif (esp.)
safran (persan)
satin (esp.)
sofa (turc)
sorbet (it.)
sucre (it.)
talisman (grec)
tamarin (lat.)
timbale (esp.)
zénith
zéro (it.)
Les emprunts à l'arabe ont surtout été faits entre les XIIe et XIXe siècles, mais les XVIe et XVIIe siècles ont été particulièrement productifs. Après 1830, c'est-à-dire après la conquête de l'Algérie par la France, d'autres mots arabes (une cinquantaine environ) ont pénétré dans la langue française: zouave, razzia, casbah, maboul, barda, kif-kif, toubib, bled, matraque, etc.
5.2 Les chiffres arabes
C'est la langue arabe qui a permis au français, comme à bien d'autre langues, de découvrir la numérotation en «chiffres arabes». Les Arabes avaient eux-mêmes emprunté à l'Inde ce système de numérotation qu'ils nommaient «chiffres hindîs». En France, un moine mathématicien et astronome du nom de Gerbert d'Aurillac (938-1003) avait découvert les chiffres arabes lors de ses études en Catalogne (Barcelone).
À cette époque, les monastères catalans possédaient de nombreux manuscrits de l'Espagne musulmane; Gerbert s'initia à la science arabe, étudiant les mathématiques et l'astronomie. Il se rendit vite compte des avantages de la numérotation décimale, même s'il ignorait encore le zéro. Il fut l'un de ceux qui favorisa l'élection de Hugues Capet comme roi de France en juin 987.
Devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II (le premier pape français), il employa toute son autorité pour promouvoir la numérotation arabe, ce qui lui valut le surnom de «pape des chiffres». L'érudition de Sylvestre II était si considérable qu'il fut considéré comme l'un des plus grands savants de son temps, puis il tomba dans l'oubli.
Cependant, dans leur forme actuelle avec le zéro, les chiffres arabes furent introduits en Europe par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci (v. 1175 - v. 1250). En 1202, celui-ci publia son Liber abaci (« Le livre des calculs »), un traité sur les calculs et la comptabilité basé sur le système décimal à une époque où toute l'Europe recourait encore aux chiffres romains.
Ce sont des clercs, qui au retour des croisades, furent les véritables diffuseurs de la numérotation arabe en France. Bien que les chiffres arabes soient plus performants que la notation romaine, ils ne se sont pas imposés très rapidement.
Le système fut même mal reçu, en raison notamment du zéro, qui désignait alors le néant ou le vide, une notion familière aux hindous, mais étrangère aux Occidentaux. En 1280, Florence interdit même l’usage des chiffres arabes par les banquiers.
En réalité, le conservatisme des Européen en la matière faisait en sorte que les chiffres romains furent perçus comme l'un des «piliers de la civilisation» occidentale. Se considérant les fidèles héritiers de l'Empire romain, beaucoup d'Européens croyaient qu'ils ne pouvaient utiliser que les chiffres romains ou les chiffres grecs, pourtant très peu pratiques en matière de calcul.
Il faudra attendre le XIVe siècle pour que les chiffres arabes soient acceptés grâce à l'influence de mathématiciens comme Chuquet, Viète et Stevin; ce fut la Révolution française qui généralisa en France l'emploi systématique de cette numérotation.
L'époque de l'ancien français a fait faire des pas de géant à la langue française. Mais le français n'était pas encore une langue de culture et ne pouvait rivaliser ni avec le latin ni même avec l'arabe, dont la civilisation était alors très en avance sur celle des Occidentaux. On comprendra pourquoi le latin de l'Église se perpétua: il n'avait pas de rival. Cependant, le français allait encore s'affranchir de ce qui lui restait du latin lors de la période du moyen français.
SOURCES : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s3_Ancien-francais.htm
-
La terre et les paysans
Théorie :
"Taillables et corvéables à merci", telle est l'expression qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'il s'agit d'évoquer les paysans à l'époque médiévale. Mais cette image correspond-elle à la réalité historique ?
Alleu, tenure et réserve
Au Moyen Âge, la grande majorité de la population vit à la campagne et cultive la terre. En contrepartie de leur protection, les seigneurs exigent des paysans un certain nombre de services et de redevances. Les terres cultivables sont réparties en 3 catégories : l'alleu, la tenure et la réserve. L'alleu est une terre qui n'appartient pas au seigneur. Elle est la pleine propriété du paysan et clé sa famille et est libre de tous droits seigneuriaux. Toutefois, le paysan peut être soumis à certaines obligations.
Mais la grande majorité de la terre appartient au seigneur qui la divise en tenures et en réserve. Les tenures sont louées à des paysans libres qui les cultivent, moyennant l'acquittement d'une location, le cens, et de divers services et redevances, le tout payable en nature ou en argent. Quant à la réserve, elle est constituée des terres qui appartiennent directement au seigneur.Elle est cultivée la plupart du temps par les domestiques et les serviteurs du château. Les produits de la récolte sont stockés dans les greniers et les celliers du seigneur et servent à le nourrir, lui, sa famille et son entourage. Les surplus éventuels sont vendus, ce qui procure au seigneur une source de profit supplémentaire. A certaines époques de l'année, les autres paysans de la seigneurie sont astreints à des travaux agricoles sur la réserve. L'ensemble de ces obligations en nature constitue les corvées.
Paysans libres et serfs
Dans les campagnes, on distingue généralement les serfs des vilains. Les serfs sont des paysans totalement dépendants du seigneur. Ils sont attachés à la terre qu'ils cultivent; si la terre est vendue, ils sont vendus avec elle. En outre, ils ne peuvent quitter leur maître. Pour se marier en dehors de la seigneurie ils doivent s'acquitter d'une taxe, le formariage. Ce ne sont cependant pas à proprement parler des esclaves, tels que l'on en rencontrait durant l'Antiquité. Contrairement à une idée reçue, les serfs sont minoritaires parmi l'ensemble de la paysannerie.
Les paysans libres, appelés vilains, sont moins étroitement soumis au seigneur, même si, comme les serfs, ils sont également astreints à toute une série clé droits seigneuriaux : cens, taille, corvées, obligations d'utiliser le four banal, le moulin banal... En plus de ces taxes, redevances et services, les paysans sont soumis à la dîme, un impôt versé au profit de l'Église et qui représente environ un dixième des récoltes.
Semailles et moissons
Le seul engrais connu au Moyen Âge est le fumier. Or, les paysans ont peu de gros bétail. La terre, qui n'est donc pas correctement enrichie, devient stérile après quelques années de culture. Pour remédier à cette situation, on développe la jachère. Les surfaces cultivées doivent être laissées au repos l'année suivante. Il en découle une rotation des cultures, la moitié des terres étant tour à tour ensemencées puis mises en jachère un an sur deux.
C'est l'assolement biennal. L'inconvénient majeur de cette technique est une déperdition d'environ 50% de la production de la surface agricole. Peu à peu, une autre méthode va être développée : l'assolement triennal. Les champs sont divisés en 3 zones ou soles. Une seule est laissée en jachère tandis que la production est répartie sur les deux zones restantes, où l'on alterne la culture du blé avec celle d'autres céréales ou de légumes qui épuisent moins le sol (seigle, avoine, lentilles, choux, haricots...).
Parallèlement, les XIe et XIIIe siècles sont une période d'intenses défrichements. De nouvelles terres cultivables sont gagnées sur les forêts, les taillis, les marécages. Nombre de villages sont créés durant cette période. Les seigneurs encouragent ces défrichements, car ils leur permettent d'augmenter leurs revenus. Ils proposent aux paysans de venir s'implanter sur ces espaces et leur concèdent certains avantages et libertés. La condition des paysans, et notamment des serfs, s'en trouve améliorée.En effet, les défricheurs reçoivent du seigneur un lot de terres ainsi que la liberté complète, s'ils sont d'origine servile.
L'attrait de la liberté fait, dès lors, affluer les paysans vers ces régions défrichées.
L'étude de la toponymie renseigne sur ce mouvement et l'importance des nouvelles installations humaines.
Ainsi, les localités comportant, par exemple, des noms en -sart, -rode, -hout ou la terminologie «neuville» évoquent ces déboisements et ces récentes implantations.
Cependant, malgré les défrichements, les famines restent une menace très présente et régulièrement, des régions entières sont frappées par ce fléau.Eté 
C'est le foin que l'on fauche en premier, puis vient la moisson.
Les épis sont coupés à la faucille. Les tiges sont laissées sur place pour servir de pâture. Les chaumes seront brûlés afin de fertiliser la terre.La récolte des épis est déposée sur l'aire puis battue au fléau ou piétinée par les mulets. Pendant les mois suivants, le grain sera moulu en fonction des besoins.
Les innovations technologiques
Entre le XIe et le XIIIe siècle, on assiste à de grands progrès dans le domaine de l'agriculture. Jusqu'à cette époque, les paysans disposent d'outils rudimentaires (houe, araire construits en bois) pour cultiver le sol. Enfouies à faible profondeur, les semences ne donnent qu'un faible rendement.
Peu à peu, l'usage du fer se développe, ce qui rend possible l'usage d'instruments métalliques plus perfectionnés : la charrue à soc en fer qui retourne la terre, la herse qui brise les mottes et enfouit les grains ou la faux qui coupe les foins. Mieux mis en valeur, les champs et terres de cultures produisent une récolte plus abondante.
Parmi les autres innovations technologiques, on peut citer l'amélioration de la traction et des procédés d'attelage plus performants : utilisation plus fréquente du cheval (dont les sabots sont ferrés) recours au collier d'épaule, apparition du joug frontal et de l'attelage en file pour les boeufs.
Agriculture et alimentation
L'alimentation est essentiellement composée de céréales : blés d'hiver (froment, épeautre, mil, seigle...) ou de printemps (orge et avoine) utilisés pour confectionner le pain, les galettes, la cervoise et la bouillie. Le pain, blanc pour les nobles et les nantis, est la nourriture de base. Cet aliment a, en outre, une haute valeur symbolique : le pain consacré représente le corps du Christ; partager le pain, en famille, c'est manifester son appartenance à la communauté chrétienne.Les légumineuses (pois, fèves, raves, «herbes» et «racines») viennent en complément, en accompagnement. On les consomme sous formes de bouillies ou de soupes. Les laitages et les œufs s'ajoutent à cette alimentation quotidienne. Les fruits (noisettes, noix, fraises, framboises...) sont rares et essentiellement issus de la cueillette.
Le développement des échanges favorise la culture de la vigne. Celle-ci s'étend progressivement vers le nord de l'Europe, depuis les côtes méditerranéennes jusqu'à nos régions. Mais les techniques de vinification étant rudimentaires, le vin est peu alcoolisé. On le coupe alors d'eau et on lui ajoute des épices.De même, les modes de conservation sont peu développés. Le vin se conserve dans des tonneaux et devient souvent imbuvable au bout d'une année. La consommation de viande est exceptionnelle, sauf à la table des seigneurs, grands amateurs de gibier. Porcs, moutons, volaille et bétail sont élevés pour leur viande, mais également pour les multiples ressources qu'ils procurent (laine, œufs, animaux de trait...).
Automne En octobre la terre est travaillée à nouveau pour recevoir les semailles d'hiver qui germeront au printemps suivant. 

C'est aussi le temps de la vendange. A l'automne la forêt donne ses fruits : miel, glands pour engraisser les porcs, noisettes, châtaignes (dont on fait une farine qui remplace le blé pour les plus pauvres).
Dans les clairières on fabrique le charbon de bois.
Les techniques agricoles
Les rendements sont généralement de 1 pour 2.
On calcule que en général 1 à 1,5 ha étaient nécessaires pour subvenir aux principaux besoins d'une personne. Dans les meilleures périodes (fin du Moyen Age plutôt) le rendement passa à 1 pour 5.
Assolement triennal :
1° année : céréales d'hivers
2° année : céréales de printemps
3° année : jachèreCheptel peu développé => peu de fumier
Hiver La terre gelée est au repos et les paysans se font bûcherons ou artisans.
Le bois sert à tout : à la construction, à la cuisine et au chauffage, à fabriquer des charrettes et des outils (râteaux, herses, fourches).
Sont aussi confectionnés des paniers, est tanné le cuir pour les chaussures et les harnais. Si le seigneur est un abbé, il demandera des peaux de moutons pour ses parchemins.
Textes
La tenure au XIIe siècle
«... Guichard, bon paysan, qui doit en service :
- à Pâques, un agneau;
- à la fenaison, six pièces de monnaie;
- à la moisson, un repas (avec plusieurs associés) et un setier d'avoine;
- aux vendanges, douze deniers;
- à Noël, douze deniers, trois pains, un demi-setier de vin;
- à Carême-entrant, un chapon;
- à la Mi-Carême, six pièces de monnaie...».
G. Duby, L'Economie rurale et la vie des campagnes, livre III, Paris, Aubier, 1962, p. 650.
Rotation des cultures en 1178
«(L'abbaye du Neufmoustier doit remettre à l'ancien détenteur de la dîme entre Champion-Seraing et Seraing-le-Château) trois muids d'épeautre, l'année des blés d'hiver (...), rien qu'un muid d'épeautre l'année de l'orge et de l'avoine; mais la troisième année, pendant laquelle la terre vide reste en jachère, le couvent de Huy ne devra rien».
J.-P. Rorive, «Un cas précoce d'assolement triennal en Hesbaye hutoise (1178)», Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XC, Liège, 1978, p. 3.
Concession de terres à des paysans à l'occasion d'un défrichement(charte du 10 août 1161)
«Moi Thierry, par la grâce de Dieu, comte de Flandre, et aussi mon fils Philippe, nous avons donné à cultiver à des paysans, moyennant un cens annuel, les friches de Reninge (Renninghelst, localité près d'Ypres), qui appartiennent spécialement à notre domaine (...). A tous ceux qui voudraient y demeurer, s'ils sont retenus par leurs obligations dans une autre seigneurie, nous prendrons soin de leur faire donner la permission de venir vers nous.Qu'il soit donc connu aux hommes présents et futurs, que nous avons accordé et donné pour toujours, non seulement à ceux qui demeurent à présent sur cette terre mais à tous ceux qui y demeureront plus tard, une telle liberté qu'ils ne soient en aucune façon soumis aux lois, aux justices ou aux causes de la communauté du pays de Fûmes (...); mais qu'ils soient toujours libres et indépendants, soit de tous les services, demandes, tailles, soit de toutes les autres exactions quelconques, auxquelles sont astreints les autres habitants de notre terre, (...)».
P. Bonenfant, F. Quicke, L. Verniers, Lectures historiques. Histoire de Belgique, t. I, Bruxelles, 1937, pp. 142-143.
Une famine à Liège en 1197
«Une multitude de pauvres gens est morte de faim. On mangeait les cadavres des animaux crevés et presque personne n'avait conservé l'espoir, tant la misère menaçait tout le monde. (...) Les pauvres gisaient dans les rues et mouraient; ils étaient couchés devant les portes de nos églises, lorsqu'on chantait les matines, moribonds et gémissants, attendant l'aumône que l'on faisait à la première lueur du jour. Cette année, le blé nous manqua dès l'Epiphanie (...). Quant à la bière, elle nous fit défaut toute l'année (...)».
P. Bonenfant, F. Quicke et L. Verniers, op. cit., pp. 140-141.
http://lecerclemedieval.frbb.net/
-
Les redevances que doit un paysan à son seigneur sont doubles :
foncières et banales.
Les redevances foncières sont en quelque sorte le prix de la location des terres cédées aux paysans ; elles sont payables en argent, c'est à proprement parler le cens, ou en nature. Elles comprennent également un certain nombre de journées par an, voire même par semaine, réservées au travail des terres non affermées de la seigneurie.
Les redevances banales sont variées : obligation, pour les paysans, d'utiliser, en payant, le moulin banal, le four banal, le pressoir banal ; "corvée", c'est-à-dire réquisition des paysans pour l'entretien du château, des routes, l'abattage des forêts, etc. Et souvent, sous prétexte de se faire aider, le seigneur exige le paiement arbitraire d'une "taille".
Les principales ressources nobiliaires sont les suivantes :
- la taille : impôt direct sur les roturiers,
- la gabelle : impôt sur le sel,
- les fouages : redevance par maison ou par feu,
- les taxes sur le fonctionnement du four banal, du moulin, sur le travail du bouilleur de cru,
- les droits de passage sur les ponts,
- les jours de corvée.
Aucun noble ne pouvant se payer le prix d'une jacquerie, pour que les manants ne soient pas enclins à la révolte face à ces impôts, les seigneurs, en accord avec l'église, accordent de nombreux jours fériés où le peuple fête ses saints patrons, le venue du printemps ou la salaison du cochon.
Revenus royaux
1179 : 20.178 livres pour 41 prévotés
1180 : 20.000 Livres Tournoi
1185 : 24.607 Livres pour 52 prévotés
1200 : 35.000 Livres Tournoi
1203 : 34.719 pour 62 prévotés
1355 : octroi spécial accordés par les pays du nord et du sud : 5.400.000 livres de subsides pour une armée de 30.000 hommes pour un an. (= 5% des transactions nationales).
1360 : 1.500.000 Ecus
1423 : octroi spécial accordés par les pays du nord et du sud : 1.300.000 livres tournois.
1426 : octroi spécial accordés par les pays du nord et du sud : 1.182.000 livres tournois.
1439 à 1444 : octroi spécial : 2.698.000 livres tournois (oil : 918.000, oc : 1.800.000).
1460 : 1.800.000 Livres Tournoi
1461 : 1.800.000 Livres Tournoi dont 1.200.000 pour la Taille
1481 : 4.600.000 Livres Tournoi pour la taille
1483 : 100.000 Livres Tournoi pour le domaine (5.500.000 Francs de 1914)
655.000 Livres Tournoi pour aide et gabelle (36.000.000 Francs de 1914)
3.900.000 Livres Tournoi pour la taille (214.500.000 Francs de 1914)
1490 : 3.900.000 Livres Tournoi pour la taille (214.500.000 Francs de 1914)
Voirie
"Denier de la chaussée" : impot pour l'entretien de la voirie à Troyes dès 1270.
"Droit de Chaussage" : impot pour l'entretien de la voirie à Reims.
Impots pour la voirie à Dijon en 1428 :
16 deniers tournois par mine de blé à moudre,
20 sous par queue de vin déchargée dans l'agglomération.
6 deniers par boeuf entrant ou sortant,
3 deniers par vache entrant ou sortant,
2 deniers par porc entrant ou sortant,
1 denier par ovin/caprin entrant ou sortant,
et sur les chariots en fonction du nombre de roues et du ferrage.
Impots pour la voirie à Dijon en 1374 :
1 gros tournoi d'argent par an par toise de mur ou jardin de la maison au propriétaire (devant, derrière ou sur les cotés).
1 gros viez d'argent/an au locataire.
1 denier tournoi / roue ferrée.
1 obole tournoi / roue non ferrée.
1 denier tournoi par cheval, jument, mule, mulet, ane, anesse, boeuf, vache, porc ou truie qui entre dans la ville.
1 obole (1/2 denier) pour les autres bêtes à 4 pattes.
Impots pour la voirie à St Omer depuis 1320 :
2 deniers par chariot à 4 roues,
1 denier par charrette à 2 roues,
1 maille par cheval de bat.
Les impots pour la voirie rapportent :
5 livres à Moulins en 1421
3 livres à Moulins en 1423
70 livres à Blois en 1475
182 livres à Rennes en 1418
324 livres à Rennes en 1460
431 à 534 livres à Rennes de 1450 à 1500.
La ferme des chaussées de Troyes rapporte 420 livres en 1416-17.
Taxe pour les ordures à Nantes en 1487 : 1 denier par maison par semaine.
Les impots ne taxent pas beaucoup les riches en ville :
0,4% des revenus des riches
1% des revenus des moyennement aisés
0% des revenus des pauvres
Les impots rapportent à Rennes :
les taxes sur le vin : 51,21% des rentrées d'argent,
les taxes sur le textile : 21% des rentrées d'argent,
le pavaige : 8% des rentrées d'argent,
les taxes sur les peaux et laines : 7,25 des rentrées d'argent,
les taxes sur la mercerie : 4,25% des rentrées d'argent.
Les impots rapportent à Nantes :
les impots pour la voirie : 2,5% des recettes,
les taxes sur le vin au détail : 41,5% des recettes,
le "méage" et le "denier par livre" rapportent : 38% des recettes.
Amendes
Pour vendre son vin en dehors des périodes permises : 60 sous d'amende
On a une amende si on utilise un four personnel au lieu du four seigneurial.
Pour avoir fait du mauvais platre : 5 sous d'amende (2 à une chapelle, 2 au maitre du métier, 1 à celui qui aura mesuré le platre).
Si un marchand veut quelquechose de mauvaise qualité, il risque une amende de 5 à 20 sous sous St Louis.
A Nantes en 1468, si on jette ses ordures là ou c'est interdit :
prison + 60 sous au chef de famille,
prison + 7 sous 6 deniers aux autres.
A Nantes en 1468, si on ne nettoye pas devant chez soi : 60 sous d'amendes.
A Troyes, au 15eme, si on a une arme sur soi, elle est confisquée et on a 10 sous d'amende.
Rançons
Rançons du roi Jean Le Bon :
1ere : le Sud-Ouest (le Poitou), l'hommage de Bretagne, 4.000.000 Ecus
2eme : Touraine/Anjou/Maine/Normandie
3eme : Aquitaine/Loire au Massif Central/Pyrenees (1/3 du royaume), Calais + marches, Ponthieu + Guines, 3.000.000 d'Ecus payés en 3 ans (13,5 Tonnes d'or)
Rançon de Du Guesclin : 100.000 F
Rançon de Charles d'Orléans en 1440, 400.000 écus d'or
Rançon d'une noble dame en 1438, 1400 écus.
Louis XI paie à Edouard IV 75.000 écus pour qu'il ne fasse pas la guerre en France, avec une rente de 50.000 écus.
Taxes
Pour faire du pain : sous St Louis un boulanger paie 43 deniers par an pendant 4 ans.
En Septembre 1436, un hotteur paie une taxe de 2 blancs pour entrer dans Paris, une charette de cuves de vignes : 8 blancs, 2 charettes : 16 blancs ; 3 charettes : 8 sous parisis.
Vers 1436, les garnisons au alentour de Paris taxent les vignerons de 8 à 10 queues de vin pour la saison.
Taxe de pont en Mai 1441 à Paris : une charette pleine paie 6 doubles, un chariot plein paie 12 doubles.
La taxe sur la bière rapporte 26400 F en Janvier 1429 à Paris.
La taxe sur le vin rapporte 2200 F en Janvier 1429 à Paris.
La douane des ports Carolingiens (Dorestad, ...) taxe de 10% toute marchandise qui y transite (avec des exceptions pour certain).
La location d'un étal à la foire de Reims, coute 6 deniers à partir de 1345 ; rien si l'étal est mobile.
En 1411, il coute 2 à 16 sous, à la tête.
En 1412, à Reims, un étal de 7 pieds de long paie 12 deniers.Plus de 7 pieds de long paie 2 sous parisis. Si on refuse de payer, l'amende est de 40 sous parisis.
L'amende pour un étal non autorisé est de 22 sous 6 deniers en 1428 à Reims.
En 1428, à Reims, un étal portatif ne paie pas de taxe ;
un étal de cordonier, retingotier, quincailler, de moins de 7 pieds de long, paie 6 deniers parisis ; plus de 7 pieds de long, paie 12 deniers parisis ;
un étal de boucher de moins de 7 pieds, paie 12 deniers ; un étal de boucher de plus de 7 pieds de long paie 24 deniers.
Au 12ème siècle, à Cologne, un paysan paie 6 marks à l'intendant et 3 au prieur de la cathédrale comme taxes annuelles.
Au 12ème siècle, sur le domaine de Rommersheim, les taxes annuelles à l'abbaye sont par manse :
1 porc de 20 pfennigs
1 livre de lin
3 poulets
18 oeufs
1/2 chargement de vin en Mai et en Octobre
5 charretées de fumier
5 javelles d'écorce d'arbre
12 charretées de bois
du travail au fournil et à la brasserie
le transport de 50 planches ou 100 bardeaux à l'abbaye pour le toit de l'église
garder les cochons 1 semaine dans la forêt
travailler 3 arpents de terre 3 jours par semaine
livrer 5 boisseaux de grains de 40 km de distance
surveiller la grange
entretenir une plate bande du jardin
les femmes doivent coudre les culottes Lorsque l'abbé vient en visite, les paysans doivent fournir collectivement 4 boeufs et 1 chariot pour les déplacements.
Taxe sur les juifs par Philippe Auguste :
en 1202, elles rapportent 1200 livres
en 1217, elles rapportent 7550 livresSOURCES DR
-

complémentaires.
SalutationLes origines de la famille carolingienne
Par Numa-Denys Fustel de Coulanges
Historien français (1830-1889), auteur de la Cité antique et de l'Histoire des institutions politiques de l'ancienne France.
Origines de la famille carolingienne.
– Qu’elle ne représente ni le sang ni l’esprit germanique.
Avant d'étudier le gouvernement des Carolingiens, il est utile d'étudier la famille carolingienne.
Il s'est fait de grandes théories sur l'événement de 753 qui a substitué Pépin le Bref aux Mérovingiens. Les uns ont supposé qu'il y avait eu là une révolution politique, c'est-à-dire le triomphe d'une classe d'hommes sur la royauté, et l'établissement d'institutions nouvelles.
D’autres ont présenté l’avènement des Carolingiens comme le résultat d'une nouvelle invasion germanique. Suivant cette opinion, fort en vogue aujourd'hui, il y aurait eu une seconde invasion de Germains au VIIIe siècle, et Charles Martel en aurait été le principal chef. La dynastie mérovingienne aurait été écartée comme devenue trop romaine, et les Carolingiens auraient été élevés au trône pour faire prévaloir les idées, l'esprit, le sang germaniques.
Ainsi suivant les uns l'avènement des Carolingiens est une révolution, suivant les autres une invasion.

Nous avons à chercher si ces théories sont conformes à la vérité. Nous ne le chercherons pas par des raisonnements et des considérations, mais par la simple observation des faits. Il est nécessaire d'observer d'abord les origines de cette famille et ses antécédents. Ce sera le moyen le plus sûr de nous faire une idée juste de l'acte de 753.
1° Les Carolingiens font partie de l’aristocratie mérovingienne.
Le premier point à constater est que cette famille n'a pas surgi tout à coup; elle n'est pas apparue brusquement au VIIIe siècle pour prendre la royauté. Elle ne sortait pas non plus, à ce moment, de la Germanie. Elle n'était pas apportée sur le sol de la Gaule par un nouveau flot de Germains. Elle était déjà depuis deux siècles riche et puissante. Elle faisait partie de l'aristocratie mérovingienne. C'est de la société mérovingienne qu'elle est sortie, et c'est là qu'elle a eu ses racines.
Remontons la filiation. Avant Pépin le Bref il y a Charles Martel, avant Charles Martel son père Pépin dit d'Héristal. Ici la ligne se dédouble. Ce Pépin est fils d'Anségise et de Begga; Anségise est fils d'Arnulf et Begga est fille d'un premier Pépin qui lui-même est fils d'un certain Carloman. Arnulf et Carloman sont les deux ancêtres. Tous les deux sont des hommes du VIe siècle, et les Carolingiens sont la réunion de ces deux familles.
Observons d'un peu plus près cette généalogie. Du premier Carloman nous ne savons rien que son nom. On admet généralement qu'il était un duc, c’est-à-dire un fonctionnaire du roi d'Austrasie. Il était lui-même un Austrasien. Il est tout à fait vraisemblable qu'il était un Franc de race et un pur Germain. Son fils Pépin, très vraisemblablement aussi, était de pure rare franque. Mais ici se présente un fait qui n'aurait pas dû être négligé: ce Pépin se maria avec une femme du midi de la Gaule, avec une riche propriétaire Aquitaine.
Ce fait nous est attesté par son biographe: «La femme de Pépin, dit-il, la vénérable Itta, était issue d'une clarissime noblesse d'Aquitaine.»
Or le biographe, bien qu'il ne fût qu'un moine, était particulièrement instruit sur ce point; car son couvent possédait une charte de donation de propriétés que cette femme avait faite en sa faveur. Apparemment, cette charte portait avec le nom d'Itta le nom de son père et quelques indications sur sa famille.
Le moine pouvait donc «savoir sûrement» qu'elle était d'une «clarissime noblesse d'Aquitaine».
Or la population de l'Aquitaine n’était pas une population germanique. Les Wisigoths n'y étaient pas restés; les Francs ne s'y étaient pas établis. Elle obéissait aux rois francs et à des fonctionnaires royaux qui étaient plus souvent des Romains que des Francs. Nous avons même constaté plus haut qu'il y était resté un assez bon nombre de riches familles de l'aristocratie impériale.
L'expression clarissima nobilitas qu'emploie le biographe était précisément l'expression consacrée pour désigner les familles de cette aristocratie où le titre de clarissime ou de sénateur était héréditaire. L'employait-il sciemment, l'avait-il trouvée dans la charte d'Itta? nous l'ignorons; mais cette expression ne laisse pas d'être significative.
Quant à ce mariage entre un Germain du nord de la Gaule et une Romaine du Midi, il n'a rien qui doive nous surprendre. Pareilles unions étaient fréquentes. Nous savons d'ailleurs que l'Aquitaine faisait partie du même royaume que l’Austrasie. Les rapports entre les deux pays étaient incessants.
Le mélange des races, surtout par mariage entre les Germains et les riches héritières romaines, est un des faits les plus incontestables de l'époque mérovingienne. C'est donc d'un mariage de cette sorte que naquit Begga, laquelle se trouva ainsi fille d'un Germain et d'une Romaine.
Regardons maintenant l'autre ligne, celle d'Arnulf. Nous possédons deux biographies de ce personnage. Les deux auteurs vantent sa haute naissance et sa noblesse. Le premier s'exprime sous celle forme:»Il était né d'une grande famille des Francs; noble par ses parents, il fut encore plus noble par sa foi dans le Christ.» Il n'en dit pas plus, ne nous fait pas connaître le nom de son père, et nous laisse ignorer quelle était cette «grande famille des Francs».
Or on se heurte ici à une difficulté. Il n'y avait pas, au VIe siècle, de familles nobles chez les Francs. Il n'existait pas chez eux de caste nobiliaire. Jamais il n'est fait mention dans les documents de cette époque d'une seule famille franque qui possédât une noblesse héréditaire.
Qu'on lise Grégoire de Tours qui met si bien sous nos yeux les mœurs de ce siècle, on y verra en maints passages une noblesse romaine, qu'il appelle la noblesse sénatoriale; on n'y verra pas une seule fois une noblesse franque, bien que Grégoire ait fort bien connu les plus grands personnages parmi les Francs.
Que veut donc dire l'auteur de la Vie de saint Arnulf quand il parle de prosapia Francorum? Il faut noter que la plupart des Vies de saints de cette époque commencent par vanter la noblesse du personnage. En général ils se servent des expressions nobilis genere, nobilibus parentibus ortus, ortus nobili progenie, ortus inclyta prosapia. Mais parfois ils remplacent ces expressions par celle-ci: Ex nobili Francorum prosapia genitus.
Mais si l'on compare entre elles les Vies où sont employées ces diverses expressions, on voit qu'aucune idée spéciale ne s'attachait à l'une d'elles et que dans la langue fort prétentieuse des hagiographes elles étaient synonymes.
Toutes, également et avec le même vague, voulaient dire que le saint n'était pas de basse naissance. Mais aucun de ces hagiographes ne songeait précisément à la race franque ou à la race romaine.
Pas une fois, en effet, dans un tel nombre de Vies de saints, nous ne voyons que l'auteur oppose les deux races l'une à l'autre, ni même qu'il paraisse connaître deux races.
Pour comprendre ces mots prosapia Francorum que six ou sept hagiographes emploient, et seulement à partir du VIIe siècle, il faut songer que le mot Franci n'avait pas un sens ethnique et qu'il désignait tous les sujets du royaume des Francs. Il est impossible d'avoir lu les textes sans être frappé de cette vérité.
Les mots rex Francorum ne signifiaient pas que le roi ne régnât que sur les Francs de race; si Francorum avait ici son sens ethnique, il en résulterait que le roi mérovingien n'aurait eu aucun titre qui indiquât son autorité sur les hommes de race romaine.
Nous rencontrons fort souvent l'expression palatium Francorum ou proceres Franci; or nous savons par de nombreux exemples que beaucoup d'hommes de race romaine figuraient dans les plus hauts rangs du Palais et parmi les proceres:
On trouve cent fois l'expression exercitus Francorum; or nous savons que ces armées comptaient, au moins en Neustrie, plus de Romains que de Francs; nous savons aussi que le service militaire était obligatoire pour tous indistinctement, et qu'il y eut même des Romains qui commandèrent les armées.
L'armée était donc un mélange de races, et pourtant on l'appelait toujours exercitus Francorum; cela ne signifiait pas autre chose que l'armée du pays ou du royaume des Francs. Dans ces expressions, comme dans beaucoup d'autres, le mot Francus avait perdu son sens ethnique. On était un Francus dès qu'on était un membre du royaume des Francs. Francorum est synonyme de Franciæ.
Lors donc que l'auteur de la Vie de saint Arnulf dit que cet homme était d'une grande famille des Francs, il n'est nullement certain qu'il entende par là qu’Arnulf appartint à la race franque, ni qu'il descendit d'un compagnon de Clovis. Vraisemblablement il se sert d’une expression vague et ne songe pas à chercher si son héros est un Franc ou un Romain. — Il ne nous dit pas quel était son père.
Peu de temps après, Paul Diacre parle d'Arnulf, dans son Catalogue des évêques de Metz, et il en parle, comme l'auteur précédent, sans remonter à son père.
2° Que les carolingiens peuvent être rattachés à la noblesse romaine
Mais un autre hagiographe écrit la Vie de saint Clodulf, fils de cet Arnulf, et il pense à donner la généalogie de la famille. Arnulf, dit-il, était «d'une ancienne race de sénateurs ». Ce terme de sénateur qui apparaît ici est digne d'attention. Le mot est fréquent dans Grégoire de Tours. Seulement, il s’applique toujours à des Romains, jamais à des Francs.
Il désigne des familles de l'ancienne aristocratie impériale, familles où le titre de sénateurs avait été héréditaire sous l'Empire et était resté héréditaire sous les Mérovingiens, au moins jusqu'à la fin du VIe siècle. C'est ainsi que Grégaire de Tours nous apprend qu'un certain Gundulf, duc en Austrasie, était de famille sénatoriale, genere senatorio; et nous voyons en effet que ce Gundulf appartenait à la famille toute romaine des Florentins Géorgius.
Que ce fils des Florentius ait porté le nom de Gundulf, il n'y a rien là qui doive surprendre. Beaucoup de Romains prenaient des noms germaniques, surtout quand ils devaient se placer au service du roi. Les noms n’étaient pas héréditaires, et les formes germaniques avaient la vogue.
Arnulf était donc, suivant l'hagiographe, d'une ancienne famille de sénateurs. Son père, ajoute-t-il, s'appelait Arnoald ou Ansoald, et le père de celui-ci s’appelait Ansbert. De cet Ansbert on parlait très peu; mais on vantait beaucoup ses frères, qui furent presque tous évêques.
Ils s'appelaient Déotarius, Firminus, Agiulfus, Gamardus père de Goéric, et enfin Ragenfrid père du patrice Mummolus et du patrice Hector. Ce mélange de noms romains et de noms germaniques entre des frères n'avait rien qui étonnât à cette époque.
Les renseignements fournis par la Vie de saint Clodulf sont confirmés par d'autres documents. On trouve dans plusieurs manuscrits du Xe et du XIe siècle des tableaux généalogiques de la famille carolingienne.
On peut ne pas attribuer une foi absolue à des tableaux généalogiques. Toutefois il faut songer que dans l'époque mérovingienne les grandes familles avaient leurs archives. Nous avons montré cela par les chartes et les formules.
Un tableau généalogique n'est donc pas nécessairement une œuvre de fantaisie. Chaque famille possédait le sien. Précisément parce qu'il n'existait pas de noms héréditaires, chaque famille était soucieuse de conserver les preuves écrites de sa filiation.
Cinq manuscrits contiennent une Généalogie de la famille carolingienne ; dans un sixième nous trouvons un poème en vers sur cette même généalogie. Ces six manuscrits ne se ressemblent pas; ils ne dérivent donc pas d'un manuscrit unique. Ils s'accordent parfaitement entre eux sur le fond.
Tous sont en conformité avec la Vie de saint Clodulf. Tous établissent la même filiation: Ansbert, Arnoald, Arnulf. Tous mentionnent les mêmes frères d'Ansbert, et notamment Firminus. Tous enfin signalent cette famille comme sénatoriale, et quelques-uns ajoutent expressément qu'elle est romaine.
Une Vie de saint Goéric confirme, sans que l'auteur y ait pensé, cette généalogie. Elle nous apprend que Goéric, dont le second nom était:Abbo, était un Aquitain, qu'il appartenait à une grande famille, et qu'il était parent d’Arnulf.
Or il se trouve en effet que les Généalogies nous présentent un Goéric fils de Gamardus, et dont Arnulf était le cousin germain par son père.
Tout ce que les Généalogies nous apprennent sur Ansbert, et surtout sur ses frères, marque bien que cette famille résidait en Aquitaine. Or une seconde Vie de saint Arnulf, qui d'ailleurs n'a été écrite qu’au IXe siècle, rapporte en effet que le père d'Arnulf était Aquitain.
Cela encore concorde avec les Généalogies, car il n’est pas douteux que l'hagiographe en parlant ainsi n’eût dans l'esprit la famille toute aquitaine d'Ansbert et de ses frères. Lui aussi, il mentionne Goéric, qu il dit être cousin d'Arnulf, et qui vint d'Aquitaine s'établir à Metz.
Toutes ces Généalogies s’arrêtent à Ansbert, dont on peut placer l'existence aux environs de l'année 500. Aucune d'elles ne remonte à son père. Aucune ne nous explique comment il se fait qu'un homme nommé Ansbert soit «d’une famille de sénateurs». Mais il se trouve qu'un des frères d'Ansbert, Firminus, fut évêque, devint un saint, et eut ainsi son biographe.
Or cet auteur nous dit quel était le père de Firminus et par conséquent d'Ansbert; il s’appelait Ferréolus; il était un des grands personnages de la Narbonnaise: il était le descendant des Ferréolus, l'une des grandes familles sénatoriales de la Gaule.
Cette Vie de Firminus est surtout digne d'attention. On ne soupçonnera pas que l'auteur écrive pour louer les Carolingiens; il ne paraît pas les connaître. Ce n'est pas non plus de lui-même, ni de parti pris, qu'il nomme Ferréolus; dans son premier chapitre, il se contente de dire vin quidam. Mais plus loin il raconte, apparemment d'après quelque source ou quelque tradition plus ancienne, comment le jeune Firminus se présenta à l’évêque Roricius pour obtenir d'entrer en cléricature; il rapporte à ce sujet un dialogue. «Qui es-tu? demande l'évêque.
— Je suis né à Narbonne, répond l'enfant, mon père s'appelle Ferréolus et ma mère Industria »
C'est par ce trait naïvement inséré dans le récit hagiographique que nous savons la descendance de Firminus et d'Ansbert. Or ce trait de la Vita Firmini est confirmé par un détail que nous donnent les Généalogies: à savoir qu'Ansbert eut un fils qui portait ce même nom de Ferréolus.
On sait que les grandes familles romaines, sans que l'hérédité du nom fût une règle chez elles, aimaient à transmettre les noms du père au fils, ou tout au moins du grand-père au petit-fils. Les Généalogies qui nous fournissent le nom du petit-fils Ferréolus concordent donc avec la Vita Firmini qui nous fournit le nom du grand-père.
Cette famille des Ferréolus, qui avait été l'une des plus grandes de la Gaule et qui avait fourni à l'Empire des prêtes du prétoire au Ve siècle, paraît avoir eu un moment d'éclipse sous la domination des Wisigoths.
Sa grandeur sous les rois francs s'explique si l'on fait attention à certains détails. Nous devons songer, en effet, que la cité de Narbonne à laquelle les Ferréolus appartenaient, continua, même après la bataille de Youglé, à faire partie du royaume des Wisigoths pendant tout le VIe siècle; mais nous voyons les hommes de cette famille quitter Narbonne.
Or cela coïncide avec une expédition du roi d'Austrasie Théodebert (553), qui conquit sur les Goths, non pas Narbonne, mais les cités voisines, Uzès et Alais. Nous remarquons que, peu après, l'évêché d'Uzès est donné à un membre de cette famille nommé Roricius, puis à un fils de Ferréolus, Firminus, et enfin à un fils d'Ansbert, Ferréolus.
On sait qu'à cette époque les rois disposaient aisément des évêchés. Quant à Alais, nommé alors Arisitum, les rois d'Austrasie qui s'en étaient emparés en firent une circonscription indépendante de la cité de Nîmes et y installèrent un fils de Ferréolus, Déotarius, puis un fils d'Ansbert, Modéric.
En même temps, Agiulfe, fils de Ferréolus ou peut-être d'Ansbert, fut assez en faveur auprès du roi d'Austrasie pour en obtenir le siège épiscopal de Metz. Tous ces faits permettent du nous représenter cette famille comme ayant quitté Narbonne et le royaume des Goths vers 533 pour se lier à la fortune des Francs.
Elle rendit apparemment de très grands services, car elle reçut en récompense trois évêques. Ansbert servit-il comme soldat, ou comme diplomate, ou comme administrateur, nous l'ignorons; mais son zèle parut assez grand et l'appui de cette grande famille du Midi parut assez précieux pour qu'un roi mérovingien lui donnât une de ses filles en mariage.
Ce fait est attesté par des documents de diverse nature, et nous n'avons pas le droit de le rejeter. Il n'a rien d'ailleurs qui est invraisemblable. Il est au contraire en pleine conformité avec la grande faveur dont cette famille a joui au VIe siècle.
Il semble donc bien résulter de tout ce qui précède que la famille carolingienne se rattachait, par Arnulf et Ansbert, aux Ferréolus, et qu’elle était ainsi, en partie, de sang romain.
Mais ces documents méritent-ils une pleine confiance ?
Ce n'est pas sur des raisons de pure vraisemblance ou des raisons subjectives que nous avons à nous décider. Sans doute, ceux qui se figurent a priori que la population romaine dut être écrasée par les barbares, dépouillée, opprimée, réduite au néant, rejetteront cette généalogie comme une fable; ni la richesse d'Ansbert, ni surtout son mariage avec une fille d'un Mérovingien n'entreront dans leur esprit.
Mais ceux qui n'ont pas ces idées préconçues, ceux qui savent que les Romains restèrent riches, qu'il, servirent les rois, qu'ils parvinrent aux fonctions les plus hautes, que plusieurs d'entre eux prirent, par mode, des noms germaniques, qu’enfin les mariages entre les deux races étaient infiniment fréquents, ceux-là ne seront pas arrêtés par des raisons d'invraisemblance.
Au fond, cette généalogie ne doit pas être jugée d'après les diverses préventions qu'on a dans l'esprit. C'est à la valeur seule des documents qu'un esprit critique doit regarder.
D'une part, on peut dire en leur faveur qu'ils sont nombreux. La Vie de saint Clodulf, trois tableaux généalogiques qui viennent de source différente et qui pourtant concordent, le petit poème sur Ansbert, la seconda Vie de saint Arnulf, la Vie de saint Goéric, enfin la vie de saint Firmin, voilà un total de huit textes.
C'est beaucoup d'avoir huit textes sur un seul fait. Ce qui ajoute à leur valeur, c'est que ces différents auteurs ne paraissent ni s'être entendus entre eux, ni s’être copiés, ni avoir copié un modèle commun. La Vie do saint Clodulf et la Vie de saint Firmin n'ont aucun rapport entre elles.
La première ignore tout ce qui concerne Firminus; la seconde ignore tout ce qui concerne Ansbert et les Carolingiens; c'est par d'autres documents que nous savons que Firmin et Ansbert sont la même famille et que nous pouvons associer les deux biographies. Aucune règle de critique ne permet de rejeter de pareils textes ni l'accord qui résulte pour nous de leur rapprochement.
Mais, d'autre part, aucun de ces textes n'est très ancien. La Vie de saint Clodulf est, à mon avis, du règne de Pépin le Bref. Une des Généalogies est du même règne ; les autres sont du temps de Charlemagne ou de ses fils, puisque le nom de Charlemagne y figure, méme celui de Louis le Pieux et de Lothaire. Le petit poème sur Ansbert a été adressé à Charles le Chauve.
La Vie de saint Firmin et celle de saint Goéric sont d'époque inconnue. Lors donc que ces documents mentionnent Ansbert et à plus forte raison Ferréolus, personnages du VIe et même du Ve siècle, ils sont loin d'être des documents contemporains.

Le principal argument contre cette Généalogie n'est pas que les écrits qui nous la fournissent datent seulement du VIIIe siècle; car nous savons que les familles riches avaient alors des archives domestiques, et il n'était pas fort difficile de retrouver la série des six ascendants d'un homme.
L'argument le plus fort est que les documents qui nous l'ont conservée ont été écrits au temps où régnaient les Carolingiens et peut-être dans le but de les louer.
— Ainsi une chose est certaine, c'est que ces tableaux généalogiques ont été dressés au VIIIe siècle.
Une chose fait question, c'est de savoir s’ils ont été dressés d'après des pièces et des actes qui se trouvaient dans la famille d’Arnulf, ou s'ils ont été fabriqués par pure imagination.
Cette question ne peut pas être résolue scientifiquement. Chacun à son gré peut admettre l'une ou l'autre alternative. On peut croire à cette généalogie, comme on peut la rejeter.
Seulement, si on la rejette comme fabriquée, il faudra se demander pour quel motif Charlemagne ou ses contemporains auraient imaginé et fabriqué une généalogie qui, au lien de le faire descendre des Germains, le rattachait à une famille romaine.
De deux choses l'une: ou la généalogie est vraie, et alors Charlemagne descendait, en partie, d'une grande famille de l'aristocratie romaine; ou la généalogie est fausse, et alors Charlemagne prétendait ou croyait en descendre.
Dans le premier cas, il y a un fait réel, qui est curieux. Dans le second, il y a une opinion, une prétention, une conception d'esprit qui serait plus curieuse que le fait lui-même et qui aurait encore plus d'importance.
Quant à nous, nous n'avons pas voulu négliger ces documents, comme ont fait les historiens allemands. Nous ne croyons pas qu'on doive construire sur eux une théorie. Ils doivent seulement nous mettre en garde contre la théorie qu'on a faite.
Quand on a dit que la famille carolingienne représentait le sang et l'esprit germaniques, on a dit une chose que ces documents contredisent et qu'aucun autre document ne confirme.
Nous ne concluons pas de ces documents que la famille de Charlemagne soit romaine; mais on est encore moins en droit de dire qu'elle soit exclusivement germaine.
Si l'on veut absolument introduire ici la question des races, il faut dire que cette famille en représente le mélange. Le mieux est d'écarter de notre étude cette question de races, à laquelle ni les rois ni les peuples d'alors ne pensaient.
Notons que si l'on admet que Charlemagne descende d'Ansbert et des Ferréolus, on ne sera pas en droit d'en conclure qu’à travers ces sept générations cette famille soit restée romaine de sang et romaine d'esprit.
Elle a vécu constamment dans le Nord et dans l'Est. Elle s'est mêlée par mariage à des familles germaines. Ses intérêts n'ont cessé d'être mêlés à ceux des rois d'Austrasie, puisqu'elle les servait et grandissait par eux.
Nous devons même admettre que cette famille mit quelque soin et même quelque affectation à se confondre avec les Francs, puisque tous ses membres, depuis Ansbert, eurent des noms de forme germanique.
Si les Carolingiens descendent d'une famille romaine, c'est d'une famille qui par ambition ou habileté avait eu soin de se franciser.
Elle avait mis de côté sa descendance romaine et était devenue l'une des premières familles franques.
3° Les Carolingiens sont une famille d’évêques et de saints.
Mais cette théorie des races une fois mise de côté, il reste dans cette généalogie plusieurs renseignements que nous devons en dégager et mettre en lumière.
La société que vise notre étude avait deux traits caractéristiques: dans la vie morale, une dévotion extrême, et plutôt aux saints qu'à Dieu; dans l'existence matérielle, la grande influence de la richesse foncière.
Or il ressort de cette généalogie ces deux choses: que la famille carolingienne fut, de toutes les familles de la Gaule, celle qui comptait le plus de saints, et celle aussi qui possédait le plus de terres.
Pour les saints, à la première génération, parmi les frères d’Ansbert, nous trouvons: Déotarius, qui fut évêque d’Alais et devint un saint après sa mort ; Firminus, qui fut évêque d'Uzès et devint aussi un saint des plus vénérés ; Agiulfe, qui fut évêque de Metz; Gamardus, qui ne fut pas évêque, mais qui fut père d'un évêque et d'un saint, saint Goéric.
A la seconde génération, les fils d'Ansbert furent: Arnoald, qui, après avoir vécu dans les dignités laïques, finit sa vie sur le siège épiscopal de Metz ; Ferréolus, qui fut vingt-huit ans évêque d'Uzès et y fut honoré après sa mort comme un saint; Modéric, qui mourut évêque d'Alais «et sur le tombeau duquel Dieu opère beaucoup de miracles »; enfin leur sœur, Tarsitiu, devint aussi une sainte: «tous les jours la puissance du Christ se manifeste pour ses mérites, et l'on rapporte méme qu'elle a ressuscité un mort ».
A la troisième génération, nous avons Arnulf, qui, après avoir été un grand seigneur de la cour d'Austrasie, fut évêque de Metz; plus tard, il se fit moine à Remiremont, ce qui augmenta le prestige de son nom aux yeux des hommes.
On en fit donc un grand saint. Son fils Clodulf devint évêque de Metz; ces évêchés d'Uzès et d'Alais dans le Midi, de Metz dans le Nord, étaient comme la propriété héréditaire de cette famille. Mort, il fut un saint.
Cela fait un total de neuf évêques, de sept saints, et d'une sainte, dans une même famille. Pépin le Bref et Charlemagne descendaient d'évêques et de saints.
Si nous entrons dans les idées des hommes de ce temps-là, nous jugeons quelle force c'était pour une famille d'avoir des ancêtres qui faisaient des miracles.
Longtemps encore après Charlemagne, les peuples croyaient que ces saints continuaient à veiller sur leurs descendants.
4° Les carolingiens sont une famille de grands propriétaires.
C'était en même temps la famille la plus riche. Le premier Carlomun était un grand propriétaire du pays de Liège ; son fils, Pépin de Landen, déjà riche, épousa en Aquitaine une riche héritière qui lui apporta un grand nombre de domaines. D'autre part, les auteurs des Généalogies nous disent qu’Ansbert était très riche.
C'est un trait qu'ils ne négligent pas. Le biographe de saint Arnulf commence aussi par nous dire qu'il était «très opulent en biens du siècle ». Un mariage unit les deux familles de Pépin et d'Arnulf et confondit les deux fortunes sur une seule tête, Pépin d'Héristal.
Aucun document ne nous donne la liste ou le nombre des domaines possédés par cette famille. Mais nous pouvons peut-être en juger par le nombre des donations de terres que nous voyons qu'elle a faites.
Elle possédait dans l'Ardenne un castrum Ambra dont elle fit donation, la villa Germigny dans le pays de Reims ; elle donne à l'église de Metz une villa Nugaretum située dans le diocèse de Verdun.
Elle donne aux monastères fondés par saint Rémacle un domaine dans le Hasbain et un autre dans l'Ardenne ; au monastère de Saint-Trudon, deux domaines ; au couvent de Lobbes une grande forêt située dans le basin de la Sambre.
Nous savons d'ailleurs qu'elle a possédé dans le pays de Verdun le Parrois et Cominières ; dans la vallée de la Moselle un domaine appelé Palatiolum ; dans le diocèse de Trèves la villa Bollumvilla ou Bollumdorf ; deux autres propriétés dans le pays de Maestricht ; dans le diocèse de Liège, deux grands domaines, dont chacun était le chef-lieu de plusieurs propriétés ; dans l'Ardenne, le domaine de Lethernau, qui commandait lui-même à quatre autres domaines.
Elle a fait donation de plusieurs terres dans le Midi. Dans la Neustrie, nous voyons la famille faire don à l'abbaye de Fontenelle de huit domaines situés dans le Vexin et le Beauvaisis.
Ces dix-huit ou vingt propriétés sont peu de chose; mais nous devons calculer, d'abord, que nous sommes loin d'avoir la liste complète des donations de la famille; ensuite, que ces donations qui ne l'ont jamais appauvrie n'ont certainement porté que sur une petite partie de sa fortune.
C'était tout au plus la dîme de sa richesse foncière. Or on était en un temps où la richesse foncière faisait toute la force des familles.
C'était elle qui procurait des serviteurs, des amis, des guerriers. Par elle on était indépendant, et par elle on commandait.
Ainsi, il y avait dans cette famille, d'une part une longue série d'évêques, de saints, d'intercesseurs auprès de Dieu, d'auteurs de miracles, de l’autre une accumulation de domaines épars dans toutes les parties de la Gaule, et surtout au nord-est. Voilà la double origine de la grandeur carolingienne.
A quoi bon imaginer qu'elle ait représenté les appétits d'une race et dirigé une invasion, puisque les documents ne disent rien de cela? La vérité est qu'elle était la famille la plus riche en saints et la plus riche en terres. Nous allons voir qu’elle acquit avec cela la mairie du Palais, puis, par la mairie, la royauté.
SOURCES :
BLOG LIEN - LE CERCLE MEDIEVAL
http://www.lecerclemedieval.be/histoire/
Les-origines-de-la-famille-carolingienne.html
photos google
-

Fin de la lignée directe capétienne (1314-1328) Accueil > Les Capétiens Directs > Fin de la lignée directe capétienne  Prec
Prec Suiv
Suiv
La descendance de Philippe IV le Bel
Le roi Philippe le Bel a eu quatre enfants qui atteindront tous l'âge adulte :
- Louis X, l'aîné, avait un caractère difficile qui lui valut le surnom de "Hutin" : il épousera Marguerite de Bourgogne, fille de Robert de Bourgogne et d'Agnès, elle-même fille de Saint Louis. Altière et un rien frondeuse, cette jolie jeune femme aimait la vie.
- Philippe V le Long, prince intelligent, épousera Jeanne d'Artois, fille d'Othon IV de Bourgogne et de Mahaut d'Artois.
- Charles IV le Bel a une personnalité plus effacée : il épousera Blanche, la soeur de Jeanne d'Artois, plus frivole que cette dernière et facilement influencée par sa belle-sœur Marguerite.
Ces jeunes femmes donnaient à la cour un air de gaieté très apprécié, qui contrastait avec l'austérité du roi et de son entourage.
- Isabelle de France (surnommée la Louve de France), seule fille de Philippe IV le Bel, épousera le roi d'Angleterre Édouard II mais n'aura pas une vie conjugale enviable : elle est délaissée par son époux (qui préférait les jeunes pages), et vivra au vu et au su de tous avec son amant, le baron Roger Mortimer.
La mort du roi anglais en 1327 et le trop jeune âge de son fils Édouard III lui permettront d'exercer avec son amant une régence de fait. Mais en 1330, Édouard III reprend le pouvoir, fait exécuter Mortimer et reléguera sa mère au château de Norfolk où elle mourra en 1358.

Sophie Marceau joue le rôle d'Isabelle dans le magnifique film "Braveheart" de Mel GibsonL'affaire de la Tour de Nesles
Le drame éclate au printemps 1314 : le roi Philippe le Bel a 46 ans, se sent décliner dangereusement et voit l'avenir de la monarchie d'un œil pessimiste.
Les princesses adultères :
La fille de Philippe le Bel, Isabelle, reine d'Angleterre, indique au roi qu'elle a vu deux chevaliers, les frères d'Aunay, arborer les aumônières qu'elle avait offert à ses belles-soeurs. Elle affirme que ces derniers passent leur temps avec les princesses.

Plaque indiquant l'emplacement
de la Tour de Nesles Quai ContiLe roi décide de faire mener l'enquête : les épouses de ses trois fils, Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre, Jeanne et Blanche de Bourgogne, les deux soeurs mariées à Philippe et Charles, sont vite reconnues coupables d'adultère. Il apparaît qu'elles avaient coutume de se livrer à la débauche en plein Paris, dans la Tour de Nesles, au bord de la Seine.
Le scandale blesse cruellement l'amour-propre de ce roi profondément pieux qui, d'après le témoignage des contemporains, restera chaste après la mort de son épouse Jeanne de Navarre, survenue 9 ans plus tôt.
Qu'est-ce que "la Navarre" ? Situé dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantique, ce territoire sera rattachée à la France en 1284.
Le sort des princesses :
Les 3 princesses sont jugées en avril et les châtiments sont les suivants :
- Marguerite, 24 ans, est condamnée à être tondue, vêtue d'une robe grossière et emprisonnée à Château Gaillard : elle occupera une cellule ouverte à tous vents au sommet du donjon, et décédera peu après.
- Blanche, 18 ans, subira le même sort que Marguerite, mais sera un peu mieux traitée dans un cachot "enfoncé dans la terre" : elle sera ensuite transférée à Gavray, en Normandie, et obtiendra l'autorisation de prendre l'habit de religieuse. Elle meurt en 1326, à l'abbaye de Maubuisson.
- Jeanne, 20 ans, est déclarée moins coupable du fait qu'il lui aurait été délicat de dénoncer sa soeur et sa belle-sœur. Elle est enfermée au château de Dourdan.
La Tour de Nesles
L'affaire d'adultère des brus de Philippe le Bel est souvent appelée à tort "Scandale de la tour de Nesles".
L'hôtel de Nesles a bien existé : il a été offert en 1319 à Jeanne par Philippe V le Long, mais n'a pas été le théâtre de ces événements. Jeanne l'occupera seulement après la mort de son époux.

Cette gravure montre la Tour de Nesles telle qu'elle était juste avant sa démolition en 1665. Elle a laissé place à l'Institut de France et à la bibliothèque MazarineLe sort des amants :
Les frères d'Aunay sont aussitôt arrêtés et subissent "la question" :
ils avouent sans tarder et après un rapide jugement à Pontoise pour crime de lèse-majesté, ils sont exécutés dans le foulée en place publique. Leur supplice est épouvantable :
dépecés vivants, leur sexe tranché et jeté aux chiens, ils sont finalement décapités, leurs corps traînés puis pendus au gibet. Dans le mouvement, quelques valets, accusés de complicité, sont également sacrifiés.
 Au-delà de l'affront fait à la famille royale, ce crime était une atteinte aux institutions du royaume plus encore qu'à la morale: il mettait tout simplement en péril la dynastie capétienne.
Au-delà de l'affront fait à la famille royale, ce crime était une atteinte aux institutions du royaume plus encore qu'à la morale: il mettait tout simplement en péril la dynastie capétienne. - quelles auraient été la légitimité et l'autorité d'un futur souverain dont on aurait pu mettre en doute la royale paternité ?
- comment sacrer et donner l'onction divine à un roi qui n'aurait pas été, sans équivoque possible, le fils du roi précédent ?
Les implications politiques étaient si graves que le châtiment se devait d'être exemplaire.
Les Rois Maudits
Cet enchaînement de drames à la cour royale a fait l'objet d'une célèbre traduction romanesque par Maurice Druon, sous le titre "Les Rois Maudits" :
- Le Roi de Fer (Philippe le Bel)
- La Reine Étranglée et Les Poisons de la Couronne (sous le règne de Louis X)
- La Loi des Mâles (décrit l'impuissance des jeunes pour accéder à la couronne)
- La Louve de France et Le Lis et le Lion (Philippe VI de Valois vaincu par Edouard III d'Angleterre)
- Quand un Roi perd la France (le Prince Noir d'Angleterre fait prisonnier le roi de France Jean II le Bon)
A propos de ce roman historique, l'auteur dit avoir pour maxime "de ne jamais transiger avec la vérité historique mais de prendre hardiment parti dans l'hypothèse".
L'affaire de la Tour de Nesle est devenue une légende sulfureuse au fil des ans : un mythe renforcé encore par le destin des trois héroïnes.
Les derniers capétiens directs

- Louis X le Hutin succède à la mort de Philippe IV le Bel en 1314, juste après l'affaire de la Tour de Nesles : il avait déjà eu une fille avec Marguerite de Bourgogne, Jeanne (future reine de Navarre et mère de Charles le Mauvais).
La mort rapide de Marguerite dans sa prison (probablement une exécution) permet à Louis X de se remarier avec Clémence de Hongrie. Il manque d'envergure dans l'exercice du pouvoir et ne parvient pas à juguler les revendications des grands féodaux frustrés par la monarchie absolue qu'était parvenu à imposer Philippe le Bel. Il cède en rétablissant de nombreuses "bonnes coutumes" de Saint Louis, comme lui demandait son oncle Charles de Valois. Il doit son qualificatif à son mauvais caractère, "Hutin" signifiant "querelleur".
Il n'y aura qu'un enfant posthume, Jean 1er, qui ne vivra que 5 jours, le règne le plus court de l'histoire de France !
La condamnation d'Enguerrand de Marigny :
Il a été l'un le plus fidèle conseiller financier de Philippe le Bel, mais suite à des hausses de prix, les nobles se révoltent.
Louis X opte pour la négociation et fait habilement porter la responsabilité de la situation sur Enguerrand de Marigny : il est jugé sans avoir le droit de prendre la parole pour se défendre et sera pendu dans la foulée au gibet de Paris en 1315
(Charles le Valois ne souhaite sans doute pas qu'il évoque ses dettes). Des voleurs descendront son cadavre pour le dépouiller, mais il sera "re-pendu" ... et y restera exposé 2 ans selon la coutume !
Après la mort de Louis X, sa mémoire sera réhabilitée et il sera dignement inhumé. En 1475, le roi Louis XI élève même un mausolée sur son tombeau, qui sera profané à la Révolution.
- Philippe V le Long succède à son frère Louis X Le Hutin en 1316. Il doit évincer son oncle Charles de Valois qui s'était auto-proclamé régent, et n'a pas de mal à utiliser l'affaire d'adultère pour écarter sa nièce Jeanne de la succession au trône.
- Il se justifie par une interprétation erronée de la loi salique interdisant aux femmes de coiffer la couronne de France.
- Il est énergique et se distinguera en organisant des assemblées ou états généraux dans le but pacifier le royaume.
Jeanne d'Artois, son épouse réhabilitée, ne lui donnera "que" trois filles et aucun garçon. Il est atteint de fièvres en août 1321 et se consume lentement avant de mourir 5 mois plus tard.
- Charles IV le Bel monte à son tour sur le trône à la mort de son frère en 1322 : attaché à Blanche, malgré l'affront, il vit douloureusement sa disgrâce.
- Les deux époux s'accordent sur l'obligation politique d'annuler le mariage.
- Charles se souvient que la mère de son épouse, Mahaut d'Artois, était sa marraine et, par là même ... sa "mère spirituelle" : son épouse Blanche était donc en quelque sorte "sa soeur" !
- Cette clause de parenté spirituelle étant un motif de nullité prévu par le droit canonique, il peut se remarier avec Marie de Luxembourg.
Mais cette 2ème épouse, enceinte, meurt prématurément et Charles épouse Jeanne d'Évreux, sa cousine : nécessité faisant loi, il faut bien que le Ciel s'accommode de cette autre parenté !!!
- Le roi, qui meurt en 1328, n'aura pas plus de chance avec cette 3ème épouse : elle lui donne une fille qui meurt prématurément puis une fille posthume. Sa personnalitémédiocre fera dire que "ce roi régna grand temps sans rien faire".
Ainsi troublées furent les destinées conjugales des derniers représentants des Capétiens directs :
si Marguerite de Bourgogne n'avait pas si gravement fauté, peut-être aurait-elle donné un fils à Louis X, assurant ainsi la continuité de la dynastie !
Ces événements permettent également à Charles de Valois, oncle des monarques, de s'immiscer dans les affaires du royaume et d'octroyer aux grands vassaux certaines prérogatives ôtées par son frère Philippe le Bel.
La fin des capétiens directs : une grave crise de succession
A la mort de Charles IV en 1328, faute d'héritier mâle en ligne directe, trois compétiteurs se disputent la succession :
- Philippe comte d'Evreux, roi de Navarre : petit-fils de Philippe III et neveu de Philippe le Bel.
Il a épousé sa cousine Jeanne de Navarre (fille du roi Louis X) : il revendique la couronne au nom des droits de sa femme qu'on a jadis écarté du trône au nom de la Loi Salique. Mais cette loi ayant été entérinée comme loi successorale en France, Philippe ne peut qu'être écarté !
- Edouard III, roi d'Angleterre : fils d'Edouard II et d'Isabelle de France, fille de Philippe-le-Bel.
A la mort de Charles IV, il est le plus proche héritier mâle de la couronne de France et donc celui qui a objectivement les droits les plus valables.
Mais le patriotisme français refuse un roi anglais, bien que : Philippe, comte de Valois : petit-fils de Philippe III, fils du comte Charles de Valois et neveu de Philippe le Bel.- la noblesse anglaise soit de langue et de culture française,
- il soit descendant des normands avec Guillaume le Conquérant et des angevins (d'Anjou) avec les Plantagenêts.
Prenant la suite de son père, il est le chef de file des grands féodaux pairs de France.

(En vert les prétendants au trône et en bleu les derniers rois capétiens)
Les capétiens valois
La noblesse du royaume donnera le trône au représentant de la branche cadette des Valois : le neveu de Philippe le Bel (cousin du dernier roi) deviendra roi sous le nom de Philippe VI de Valois.
Ainsi naîtra la branche des Capétiens Valois qui durera jusqu'en 1589 avec la mort d'Henri III : suivra ensuite la branche des Bourbons avec Henri IV, qui se maintiendra jusqu'en 1791 avec la déposition de Louis XVI.
Cela excitera la rancoeur du roi d'Angleterre Edouard III, à l'origine de la guerre de Cent Ans !

La suite ...  Fin ... provisoire du site : retour accueil
Fin ... provisoire du site : retour accueil 
-
 Les francs Les Francs et l’Empire romainLes Francs apparaissent au début du Ier millénaire dans les sources latines.
Les francs Les Francs et l’Empire romainLes Francs apparaissent au début du Ier millénaire dans les sources latines.Le terme désigne probablement une ligue – ou confédération – de peuples germaniques installés sur la rive droite du Rhin inférieur, au-delà des frontières de l’Empire romain, et qui n’étaient pas assujettis à l’Empire ou à un autre peuple plus important.
Le latin francus, franci tend à prouver qu’ils se nommaient ainsi, puisque frank signifie libre en langue germanique.(L’on peut aussi retrouver l’origine du mot Franc dans le mot Frekkr (signifiant hardi, vaillant) issu de la langue Germanique.)
Ces peuples avaient pour point commun de rivaliser avec les Alamans (germ. Alle Männer, tous les hommes), sans doute à l’origine un autre regroupement d’ethnies établies plus au sud sur la rive droite du Rhin.
La langue – ou les dialectes – originellement parlés par les Francs ainsi que leur faciès culturel sont rattachés au groupe ethno-linguistique indo-européen germain occidental, comme les Angles, les Frisons et les Saxons par opposition au groupe germain oriental auquel appartiennent notamment les Goths.
Les ethnies de la ligue des Francs Les peuples qui constituaient la ligue des Francs comprenaient vraisemblablement :
les Chamaves les Chattes ou Chattuariens les Ansivariens ou Ampsivariens les Bructères les Quades les Saliens, établis près de la rivière Sale et des bouches de l’Yssel les Chérusques les Angrivariens les Hattuaires les Tubantes les Tenctères les Usipètes les Sugambres ou Sicambres n’étaient pas considérés comme des Francs les Chauques, établis au nord-est des Frisons, plus souvent rattachés aux Saxons qu’aux Francs.
Les Grandes Invasions Au IIIe siècle, les Francs participent à la grande invasion de 256-257, aux côtés d’autres peuples germaniques qui entrent dans l’Empire romain pour piller. Le IVe siècle est toutefois une période de répit et de reconquête pour Rome. Vers la fin de l’Empire, au Ve siècle, on retrouve les Francs comme auxiliaires de l’armée romaine, alors grandement barbarisée, et en lutte contre d’autres barbares plus menaçants, tels que les Huns.
Les Mérovingiens Parmi les Francs qui sont entrés au service de l’Empire, sûrement de longue date, se trouvent les Saliens.
Leur ancêtre légendaire, sans doute quasi-divin selon les rites germaniques, est pour eux la principale source de légitimité du pouvoir royal.
Il se nomme Mérovée. Toutefois, au Ve siècle leur roi est aussi devenu un (obscur) proconsul des Gaules, c’est-à-dire un souverain germanique paré d’insignes romains, qui se fait appeler général. Les Francs sont alors solidement établis en Neustrie et leurs fonctions militaires leur confèrent un pouvoir important en ces temps troublés :
le jeune Clovis (germ. Hlodowecus, qui donne par la suite les prénoms Ludovic ou Ludwig en Allemagne et Louis en France) devient leur roi à Tournai, probablement en 481.
Mais il lui faut plus que le pouvoir d’essence divine que lui confère la mythologie tribale germanique, pour s’imposer face aux évêques, aux patrices ou à la population gallo-romaine en partie christianisée. Installé à Soissons, où il a vaincu un général romain nommé Syagrius,
Clovis est sans doute d’abord sensible aux conseils de sa femme burgonde, Clothilde, convertie au catholicisme, et à ceux de l’évêque de Reims, Rémi.
Peut-être au cours d’une bataille importante contre les Alamans, la bataille de Tolbiac, il promet de se convertir à la religion chrétienne catholique s’il est victorieux. Il tient parole et reçoit le baptême en 496 ou 498 à Reims, avec 3000 guerriers.
Par la suite, il tente d’inculquer les principes chrétiens à son peuple qui demeure largement païen.
Après une suite de victoires sur ses rivaux barbares, notamment sur les Burgondes, Clovis apparaît donc comme l’un des premiers rois germains d’Occident à avoir adopté la religion chrétienne dominante, celle de Rome, par opposition à l’arianisme des Wisigoths ou des Lombards et par opposition au paganisme des Alamans.
Il parvient ainsi à gagner le soutien des élites gallo-romaines et à fonder une dynastie durable (laquelle prendra néanmoins le nom de son ascendant germanique) : les Mérovingiens.
Établis en Neustrie, les Mérovingiens règnent sur la Gaule jusqu’au milieu du VIIIe siècle. Leurs souverains les plus connus sont :
Dagobert Ier et la reine Brunehaut.
Il faut noter qu’à cette époque, comme sous la dynastie suivante, il n’est pas question de France, mais bien d’un royaume des Francs :les rois germains, en effet, ne règnent pas sur un territoire, mais sur des sujets. sourcesD.R.
![[sebastien-chabal-1-by-pieddesaux%5B114968%5D.jpg]](http://ekladata.com/vOQyIG2Ry0DBrJl1RMCfD_17Ja4.jpg) superbe article
superbe article
-

On ne doit pas commenter une décision de justice?
Ah bon?
Et bien moi si ! je vais commenter et critiquer même !!!
Une décision de justice a été rendue récemment à propos de la "rénovation" en laideur dont a été victime le Château de Falaise, témoin de la naissance de Guillaume le Conquérant et capitale un temps de Normandie (sous le duc Robert).
Le malaise, l'objet du délit ? :
un beau jour, un architecte débarqua, un obscur architecte des monuments nationaux,
qui non seulement ni connaissait rien en Normandie, ni en patrimoine historique normand, mais en plus il crut qu'il pouvait faire selon son bon plaisir, selon ses fantasmes, selon son nihilisme dégoutant et répugnant !

Trois associations falaisiennes, normandes et aimant le patrimoine avaient donc combattu en justice, le gain n'est pas total puisque les outrages fait à l'auguste Chateau ne seront pas détruits :
Les prévenus saccageurs n'ont écopé que d'une amende.

Nous ne pouvons pas féliciter la justice d'avoir ignorer complètement le dommage esthétique, et même historique de ce vandalisme d'Etat !
Nous remercions les trois associations normandes pour leur courage et tenacité.
Comment éduquer des jeunes, leur apprendre l'histoire en Normandie, si on défigure les témoins, des traces permettant d'expliquer l'art et la construction défensive à ces époques?
Yuca de Taillefer.
D'ailleurs dans le magazine Archéologia, dans son numéro 334 de mai 1997, publiait un encadré intitulé :

« le château de Falaise défiguré»
L’architecte des Monuments Historiques en charge du projet de restauration depuis 1993, ne concevait pas sa tâche comme un simple devoir de préservation, encore moins de restitution, mais plutôt comme la nécessité de marier l’architecture d’un monument médiéval pluriséculaire aux canons en vigueur et surtout… à sa propre sensibilité…
Le résultat est pour le moins saisissant…

A coups redoublés de béton armé, de toile pour les couvertures, sans même aborder le chapitre des restructurations intérieures, le château fut ainsi « réinseré » dans le XXe siècle dont il avait sans doute le mauvais goût de ne pas émaner.

1066 : Guillaume le Conquérant par LeLombardPourquoi mettre des liens inexistants... pourquoi dire que le combat fut difficile... tout simplement parce qu'il y a eu d'énormes pressions tant médiatiques que politiques pour taire au maximum cette "affaire".
Pourquoi ?? Dans quel but ??
Les aménageurs venus d'on ne sait où ne feraient pas toujours du bon boulot??
Ou peut-être tout bêtement que ce château est très, trop "normand"? ....

Le site de France 3 avait également fait un article sur internet (mais l'article n'est plus en ligne... mais il a été récupéré : le voici :
(il était à l'adresse : www.normandie.france3.fr/info/16017600-fr.php france3 conserve des archives.. alors.. pourquoi ??).
Epilogue du procès du château de Falaise
L'architecte de la rénovation condamné pour faute technique pour son "blockhaus" en béton
Un procès frustrant pour les 3 associations qui avaient porté plainte
il y a 9 ans contre la "rénovation" .

Le tribunal correctionnel a retenu l'infraction technique, mais pas le dommage esthétique.
Marc SADOUNI et Thierry LEPREVOSTPublié le 25/11 à

Le coeur du litige n'a jamais été purement technique, ni administratif. En attaquant les représentants de l'état, les associations entendaient d'abord fustiger le parti-pris architectural de l'aménagement du donjon, auquel ils refusaient le nom de restauration.
Bruno Decaris, architecte en chef des monuments historiques et maître d'oeuvre de la restauration et de la modification à partir de 1995 du château, a été condamné à verser une amende de 3.000 euros.
Elisabeth Gautier, ex-directrice régionale des Affaires culturelles de Basse-Normandie, a été condamnée à verser une amende de 2.000 euros avec sursis.
La justice leur reproche d'avoir autorisé et exécuté les travaux de restauration et de modification sur le château sans certaines autorisations administratives.
Le tribunal a dispensé les deux prévenus d'une inscription de leurs peines au casier judiciaire, au vu de leurs fonctions dans la fonction publique et en l'absence d'antécédents.

La verrue en béton continuera à défigurer pour longtemps le château où Guillaume le Conquérant vit le jour, édifié au 12ème siècle.
sources D.R.

préfabriqué posé sur ce site FEODAL ?

 Falaise au XVIe sciècle : gravure de Trolonge (XIXe s.)d'après une estampe du XVIe sciècle.Le site de Falaise, implanté en bordure des premiers contreforts du massif armoricain, est occupé par l’homme depuis au moins le Mésolithique (vers 7 000 av. J.-C).Différents types d’habitats se succèdent au cours des siècles, et il semble qu’à l’époque carolingienne, si l’on en croit d’illustres historiens dont Michel de Bouärd, il existe déjà une fortification sur le rocher.Tirant profit de cette protection, la ville se développe sur l’éperon rocheux formé par les deux vallées de l’Ante et du Marescot. Suit, au début du Xe siècle, la victoire obtenue par Rollon le viking sur le roi de France ; en acceptant de devenir chrétien, il négocie un large territoire au nord de la Seine au cœur duquel se trouve Falaise qui devient l’une des premières cités de Normandie.Dans ce nouveau paysage politique, la ville et le château vont sensiblement se développer et se transformer.
Falaise au XVIe sciècle : gravure de Trolonge (XIXe s.)d'après une estampe du XVIe sciècle.Le site de Falaise, implanté en bordure des premiers contreforts du massif armoricain, est occupé par l’homme depuis au moins le Mésolithique (vers 7 000 av. J.-C).Différents types d’habitats se succèdent au cours des siècles, et il semble qu’à l’époque carolingienne, si l’on en croit d’illustres historiens dont Michel de Bouärd, il existe déjà une fortification sur le rocher.Tirant profit de cette protection, la ville se développe sur l’éperon rocheux formé par les deux vallées de l’Ante et du Marescot. Suit, au début du Xe siècle, la victoire obtenue par Rollon le viking sur le roi de France ; en acceptant de devenir chrétien, il négocie un large territoire au nord de la Seine au cœur duquel se trouve Falaise qui devient l’une des premières cités de Normandie.Dans ce nouveau paysage politique, la ville et le château vont sensiblement se développer et se transformer.Vers l’an mil, la forteresse ducale est particulièrement efficace et protège un vaste domaine.
Construit sur le modèle des mottes fortifiées, le château est alors protégé par une solide enceinte entourant la basse-cour et est, sur la pointe, dominée par un donjon dont les bases au moins sont maçonnées.
Lieu de pouvoir des nouveaux maîtres du pays, la ville est le lieu de naissance du plus célèbre d’entre eux, Guillaume le Conquérant, futur roi d’Angleterre.
A cette époque, c’est une cité prospère qui compte sans doute 3000 ou 4000 personnes.
Il ne reste aujourd’hui que de faibles traces du donjon de Guillaume et c’est à Henry Ier “ Beauclerc”, son dernier fils, que nous devons la construction du plus ancien des bâtiments qui constitue aujourd’hui la place forte de la haute cour (1123).

Les fouilles 1996
Devenu roi d’Angleterre, il s’inspire très directement des forteresses anglaises pour rénover le château familial: il en reproduit le plan carré, avec la partition par étage, l’aménagement d’espaces intérieurs voués à la résidence du seigneur et l’accès bien défendu par un escalier menant à l’étage et protégé par un avant-corps.
Le grand donjon de Falaise est une forteresse typiquement anglo-normande. Henri Ier œuvre également beaucoup pour la ville, et y fait construire de nombreux bâtiments.
A sa mort, de nouveaux conflits secouent le royaume anglo-normand pendant vingt ans. Mathilde sa fille et Etienne de Blois son neveu disparaissent à leur tour, et c’est Henry II Plantagenêt, le fils de Mathilde qui hérite du double titre de duc et de roi.
Son union avec Aliénor d’Aquitaine le place à la tête d’un vaste domaine qui comprend : en France, la Normandie, l’Anjou, l’Aquitaine, le Limousin ; en Grande Bretagne, l’Angleterre.Il exerce aussi un étroit contrôle sur le Pays de Galles et l’Ecosse. Nous sommes en 1154 : jamais le royaume anglo-normand, qu’on appelle aussi l’empire Plantagenêt, n’a été aussi fort.
Ce territoire va nécessairement susciter la convoitise du roi de France, dont le propre domaine est bien moindre… A cette même période, le château de Falaise s’agrandit du “ Petit Donjon ”. Il protège le front ouest de la forteresse et il est aménagé en résidence.
A la fin du XIIe siècle, le roi de France Philippe-Auguste s’oppose fréquemment aux ducs normands : Henry II tout d’abord, puis ses fils, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre : c’est contre ce dernier qu’il obtiendra une victoire décisive : la Normandie devient française.
En 1204, l’annexion du duché Normand au royaume de France met donc fin à la saga des ducs. Le nouveau maître de Normandie a besoin d’appuis locaux : il se montre très conciliant avec les falaisiens et reconstruit nombre de bâtiments détruits pendant le siège. Le troisiéme des donjons du château, voit le jour : c’est une tour de défense cylindrique, plus adaptée au siège et qui, haute de 30 mètres, symbolise son pouvoir.
Dans l’enceinte, Philippe-Auguste aménage un châtelet qui remplace l’ancienne tour-porte qui mène aux donjons.
Il flanque les remparts de tours nouvelles ou transforme celles qui existent et fait construire un logis vicomtal le long du rempart nord .
Aux guerres du XIIe siècle, succèdent de longues années de paix en France. Le XIVe siècle est quant à lui catastrophique : les rois capétiens grèvent lourdement le peuple français ; des famines puis la peste s’abattent sur le royaume. La guerre de cent ans débute en 1337.
Avant l’occupation anglaise , Il n’est pas sûr que Falaise ait été sévèrement touché par la guerre : les témoignages qui subsistent donnent l’idée d’une réelle prospérité.
A cette époque, les étangs qui bordent les remparts du château au sud sont aménagés en viviers ; Au cœur de l’enceinte, un puits profond alimente la communauté en eau potable. Il est au centre d’un complexe résidentiel important, implanté sur le front sud de l’enceinte. Ces bâtiments ont aujourd’hui disparu : l’étude des documents d’archives permet de les imaginer ; mais leur situation précise ne pourra être donnée qu’après une vaste campagne de fouilles.

L’occupation anglaise en Normandie, qui débute en 1418 relance un lourd programme de restaurations et d’aménagements militaires dans l’enceinte, ainsi que la construction de salles attribuées aux nouveaux administrateurs de la ville et de la vicomté. Quinze tours de flanquement protègent les remparts du château.
On aménage des ouvertures adaptées aux nouvelles techniques de combat, des canonnières.
Le XVIe siècle est durement marqué par les guerres de religion et le déclin des établissements religieux. Le couronnement de Henri IV, roi de France protestant, va provoquer de sérieux conflits en Normandie. La ville de Falaise, particulièrement hostile au nouveau roi, subit donc un siège sévère conduit par le monarque lui-même : En janvier 1590, les armées royales détruisent le rempart Ouest de l’enceinte castrale « par 400 coups de canon » et pénètrent dans le château : les marécages qui entourent le château et les vieux murs n’ont aucune efficacité devant les tirs modernes de l’artillerie.
Quelques jours après, le gouverneur de Falaise se rend; en même temps que le rôle militaire du château disparaît.
Le déclin amorcé se confirme, les bâtiments se dégradent. Les XVII et XVIIIes siècles, sont ceux d’un développement général de l’économie de la ville.
De beaux hôtels particuliers sont construits, ainsi que l’actuel hôtel de ville.
Les portes de l’enceinte urbaine, symboles des défenses médiévales, sont rasées : on perce de nouvelles routes : on aménage de nouveaux espaces urbains.
Avant la Révolution Française, Falaise compte 15000 habitants.
Au XVIIIe siècle, on procède à d’importants travaux.
Les fossés sont progressivement comblés.

le plan du château de Falaise par VIOLET LEDUC
Une vaste enceinte irrégulière flanquée d'une quinzaine de tours délimite une gigantesque basse-cour autrefois occupée par des bâtiments résidentiels, des communs et des jardins. Les tours ont une forme cylindrique ou hémicylindrique. Certaines sont probablement l'œuvre des ducs-rois Plantagenêts dans la seconde partie du XIIe siècle, les autres celle de Philippe Auguste après 1204. Ces dernières sont en général reconnaissables à leur base pleine amplement talutée.
Dans l'angle nord-ouest, sur une éminence rocheuse, trône un ensemble architectural colossal des XIIe-XIIIe siècles. Il est composé de trois parties distinctes :
1/ Le grand donjon quadrangulaire à contreforts plats, érigé par Henri Beauclerc en 1123 et conservé sur deux niveaux. Son plan au sol occupe 26,60 mètres sur 22,80 mètres. L'épaisseur des murailles oscille entre 3,15 et 3,50 mètres. Le rez-de-chaussée servait comme bien souvent de cave à provisions avec des murs aveugles. On pénétrait dans le bâtiment par une porte située au premier étage. On y trouvait à l'origine l' " aula " (la grande salle commune), deux autres pièces peut-être à destination résidentielle (chambre et antichambre comme le suggère Jean Mesqui ?), et la " capella " (la chapelle castrale), cette dernière étant logée dans une légère excroissance de la façade sud. L'espace intérieur était éclairé par des baies géminées. Il manque à ce donjon son couronnement et son second étage qui abritait sans doute l'essentiel de la " camera " (les appartements seigneuriaux). Les différents degrés sont desservis par des escaliers à vis ou en rampes droites aménagés, comme à Loches, dans les murailles. Une restauration tragique effectuée récemment a cependant considérablement altéré la structure de l'édifice.
2/ Un peu plus tard fut adjoint au grand donjon un second ouvrage rectangulaire de dimensions plus modestes et désigné sous le nom de " petit donjon ". Il forme à l'ouest une sorte d'excroissance. Le cas n'est pas isolé : on retrouve une disposition similaire un siècle plus tôt à Loches (Indre-et-Loire) et peut-être Langeais (Indre-et-Loire).
3/ Les ingénieurs de Philippe Auguste renforcèrent ce corps préexistant par une tour circulaire appelée " Tour Talbot ", en souvenir du grand capitaine anglais de la Guerre de Cent Ans. Elle mesure actuellement 30 mètres de haut pour un diamètre de 15 mètres. L'épaisseur de ses murs atteint 4 mètres et son diamètre intérieur est donc de 7 mètres. Elle possède 6 étages voûtés en pierre et planchéiés alternativement. On y pénètre par le deuxième niveau qui communique avec le Petit Donjon. Sa base est légèrement fruitée. La tour était autrefois sans doute hourdée, mais fut pourvue de mâchicoulis sur consoles au XIVe ou au XVe siècle comme l'atteste une lithographie du XVIIIe ou XIXe siècle. Le couronnement actuel fut recréé au XIXe siècle.
Nos contemporains fustigent volontiers - souvent sans être en mesure de réellement argumenter - les restaurations jugées abusives effectuées en France, surtout entre 1800 et 1900. Eugène Viollet le Duc est généralement l'une des cibles privilégiées. Marcel Proust évoquait déjà les " déjections " de l'architecte parisien. Notre temps a " heureusement " mis bon ordre à tout cela.
Le magazine Archéologia, dans son numéro 334 de mai 1997, publiait un encadré intitulé : " le château de Falaise défiguré ". L'architecte en charge du projet de restauration depuis 1993 ne concevait pas sa tâche comme un simple devoir de préservation, encore moins de restitution, mais plutôt comme la nécessité de marier l'architecture d'un monument médiéval pluriséculaire aux canons en vigueur. Le résultat est pour le moins saisissant. A coups redoublés de béton armé, de toile pour les couvertures, le château fut ainsi " réinséré " dans le XXe siècle dont il avait sans doute le mauvais goût de ne pas émaner. Cette réalisation hors norme pose la question essentielle des modalités de préservation de notre patrimoine. Cristallisation des ruines, restitution ou adaptation à l'inspiration des goûts actuels ?
Les toitures des donjons s’effondrent et disparaissent, il est envisagé de les faire raser : mais le coût des travaux est si élevé qu’on y renonce.
En 1790, on destine le bâtimen à des fonctions administratives, on élève des arcades classiques dans le vestibule du logis et c’est un collège qui est construit. La chapelle castrale est partiellement détruite.
Les donjons sont abandonnés.
Ce ne sera qu’en 1840 que dans l’esprit d’une reconnaissance générale des monuments anciens – et par la volonté du premier ministre « des Beaux Arts », Prosper Mérimée, -on classe le château. Grâce à cette première restauration, on sauve les murs du château.

Le Château de Falaise en 1900
Mais la dernière guerre et les dommages du temps nécessitent de nouveaux travaux C’est pourquoi, vers 1980, l’Etat et la Ville de Falaise –propriétaire – montent un vaste programme de restauration des donjons : elle durera dix ans (1986-1996).
Depuis 1996, on a créé un bâtiment d’accueil et restauré la Haute-Cour.

Restauration bétonnée devant un Chateau féodal de Guillaume Le CONQUERANT, à Falaise.
Il faut maintenant entamer les travaux de restauration de l’enceinte castrale.
Résidence ducale, résidence royale, symbole du pouvoir politique central pendant de longs siècles, le château a subi ensuite une longue descente vers l’oubli.
Aujourd’hui, il renaît pour le plaisir et la mémoire des visiteurs.

<style><!--
BODY{ cursor:url("http://curseursgogo.free.fr/curanimaux/colleo.ani"); }
--></style>
-
Pour commencer, dans La vie est un choix, le cinéaste Yves Boisset, en rassemblant ses souvenirs, couvre presque quarante ans d’histoire de France.
Petit rappel pour les moins cinéphiles d’entre vous et, peut-être aussi parce que la censure d’aujourd’hui plus subtile ou sournoise l’expose moins aux feux de la rampe, Boisset est le réalisateur de films comme L’attentat sur l’affaire Ben Barka, RAS à propos de la guerre d’Algérie, Dupont Lajoie ou encore Le juge Fayard dit Le Sheriff.

Le simple énoncé de ces titres définit un homme courageux incarnant un cinéma de gauche, appuyant là où ça fait mal sur quelques pans peu reluisants de la société française, n’hésitant pas pour cela à mettre en danger sa carrière, en permanence.
Je l’ai retrouvé, car j’avoue que je l’avais un peu perdu de vue, lors de son passage dans une émission de France 2 qui nous promet de nous coucher fort tard.En égrenant ce soir-là, de sa voix douce et exquise, quelques anecdotes et aussi vérités, il m’a donné envie de feuilleter ses souvenirs rédigés de sa propre main en deux mois, mettant ainsi à profit le report d’un projet de tournage.
Moi-même fils et petit-fils de hussards noirs de la République, je suis évidemment touché lorsque Boisset brosse brièvement un portrait de ses parents, purs produits de l’ascenseur social que constitua la IIIème République.Ainsi, son grand-père, presque illettré quand il partit au front durant la grande guerre de 14-18, côtoya par chance -si l’on peut dire ainsi quand on passe trois ans de sa vie dans les tranchées- des instituteurs qui lui apprirent à lire et à écrire.
En récompense des services rendus à la patrie, il obtint, une fois démobilisé, le droit d’étudier dans une école normale d’où il sortit avec le grade d’instituteur. La vie alors était rude dans les monts du Forez, et, outre d’enseigner dans une école à mi-temps, le valeureux aïeul poursuivit son activité de paysan.
Yves se souvient d’avoir assisté à la cérémonie rituelle de l’abattage du cochon, celle-là même dont Jean Eustache tira un magnifique documentaire tourné dans des contrées sensiblement voisines d’Auvergne.
Et pour bien marquer sa détestation de Hitler et son manque d’enthousiasme pour De Gaulle, papy Boisset prénommait immuablement ses deux cochons, Adolf et Charlot !
Le père d’Yves, reçu au concours de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, dans la même promotion que Georges Pompidou et Léopold Senghor, embrassa une carrière de professeur agrégé de lettres, français, latin et grec avant de la terminer comme inspecteur général.
Pas si anecdotique que cela, il fut aussi détenteur du record de France du 400 mètres en athlétisme, et participa aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936 (sous les yeux d’Adolf ? Non, pas le cochon, le führer !). Sa maman fut professeur d’allemand.
Vous pourriez peut-être supposer qu’Yves fut un peu le crétin de la famille en s’orientant vers les paillettes du cinéma. Que nenni, c’était un élève brillant qui aurait dû entrer à Normale Sup, à la fin de son année de khâgne. Il préféra tenter le concours d’entrée à l’IDHEC (Institut des Hautes Études Cinématographiques) où il fut reçu premier.
Au lieu de suivre une voie royale toute tracée, il est d’autres chemins de traverse. Imaginez par exemple qu’au lycée Claude Bernard à Paris, il avait comme professeur d’histoire un banal monsieur Poirier, « au demeurant assez quelconque » nous dit-il, sous les traits duquel se cachait l’écrivain prestigieux Julien Gracq !

Sachez encore qu’au baccalauréat, lors de l’épreuve de français portant sur la Pléiade, plutôt que rendre un devoir très classique autour des mérites respectifs de Ronsard et du Bellay, il rédigea un mini polar d’une vingtaine de pages
(quand même ! Comme il ajoute, dans les années 1950, « le lycée n’était pas une plaisanterie de garçon de bains » !)) dans lequel du Bellay, bien qu’innocent, était reconnu coupable d’un crime.
Outre le poète du petit Liré puni, Yves fut sanctionné de la note 6 éliminatoire qui lui valut de repasser à la session de septembre où il rafla la mention Très Bien !
Ce n’est pas tous les jours non plus qu’on est accosté à la sortie du lycée par un régisseur de Claude Autant-Lara cherchant l’adolescent susceptible d’incarner le futur héros du Blé en herbe, grand succès tiré du roman de Colette.
Cela valut à Yves de tourner un bout d’essai (on ne disait pas casting en ce temps-là) avec la grande Edwige Feuillère et … une bonne paire de claques et un refus catégorique de la part de son père.
Ce ne fut que partie remise puisque, alors qu’il était en classe d’hypokhâgne au lycée Louis le Grand, on lui proposa, avec succès cette fois, un petit rôle dans Les Tricheurs de Marcel Carné.
En ouverture de son livre, ce n’est pas surprenant quand on connaît un peu le cinéaste qui a choisi de dire 24 fois la vérité ou le mensonge par seconde, à la vitesse des images sur les bobines,
Yves Boisset raconte l’entrée des troupes alliées dans Paris en 1944.
Le gamin, placé aux premières loges puisque ses parents habitaient dans une HLM entre la porte de Vanves et la porte de Châtillon, vécut les bombardements en règle par les aviations anglaise et américaine des proches gares de triage de la banlieue sud.
Il témoigne que l’arrivée des chars du général Patton s’effectua presque à parité sous les insultes et les clameurs d’enthousiasme.
Comme quoi, il y a l’Histoire officielle et … une autre réalité moins reluisante.
Je viens d’évoquer les trente premières pages d’un livre qui en compte trois cent soixante. N’attendez pas de moi que je déflore ici le fourmillement d’anecdotes qui ponctue la passion et le courageux combat menés par Yves Boisset depuis cinquante ans.Vous y retrouvez Raymond Marcellin, celui-là même qui interdit à plusieurs reprises les journaux Hara Kiri puis Charlie Hebdo :
« un mauvais ministre de l’Intérieur devenu un excellent attaché de presse » !
En effet, ses manœuvres pitoyables pour censurer avaient pour effet contraire d’attirer les spectateurs dans les salles. On croise l’ombre de Charles Pasqua qui, s’estimant diffamé, avait exigé que dans Le juge Fayard, chaque énonciation du mot SAC (Service d’Action Civique) soit remplacée par un bip.

Je me souviens que, lors de la projection en salle, à chaque bip sonore, les spectateurs hilares, comme au bon vieux temps du cinéma muet, criaient SAC !

Drôle d’époque que celle actuelle n’a parfois rien à envier quand on voit monsieur Guéant se réjouir devant les micros de son record d’expulsions hors de l’hexagone en 2011 !
La censure s’acharna aussi contre R.A.S, l’un des quelque vingt films français qui témoignèrent sur la guerre d’Algérie alors qu’environ huit cents ont été consacrés aux Etats-Unis à la guerre du Vietnam.
Vous assistez à un magistral coup de poing décoché par Jean-Paul Belmondo au grand réalisateur Jean-Pierre Melville (dont Boisset était l’assistant) pour avoir injurié Charles Vanel sur le tournage de L’aîné des Ferchaux.
Vous apprenez que Dupont Lajoie est entré dans le vocabulaire commun comme synonyme de « beaufitude » depuis le film où l’on découvrit l’immense talent de Jean Carmet autrement que dans des nanars niais (pléonasme ?).
Vous découvrez que Lino Ventura n’acceptait en général que des rôles de héros sympathiques pour que ses enfants n’en gardent pas une image négative.
Moi, pour le fun, à l’occasion, je visionnerai plus attentivement Paris brûle-t-il ? pour repérer parmi les lycéens fusillés par les Allemands à la cascade du bois de Boulogne, deux jeunes inconnus à l’époque, Michel Sardou et Patrick Maurin alias Patrick Dewaere.
Vous, revoyez Le Prix du danger avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin, tous deux remarquables! L’action de ce film d’anticipation tourné en 1983, se déroulait au début du vingt-et-unième siècle : nous y sommes et depuis Loft story, la télé réalité a largement rejoint la fiction.
Allez, je vous en ai assez (trop ?) dit ! « Je crois bien que le combat contre la bêtise satisfaite, la démagogie, la lâcheté triomphante et l’injustice, c’est un peu le sujet de la plupart de mes films » résume Yves Boisset.C’est en tout cas une raison convaincante pour vous plonger dans la lecture de La vie est un choix. Vous visiterez quelques recoins de l’usine à rêves que fut le cinéma au temps de son âge d’or lorsque les vedettes étaient encore d’inaccessibles étoiles au volant de somptueuses voitures de sport. Quoique Yves Boisset avisa sur la Croisette, pendant un festival de Cannes, « un vieux bonhomme coiffé d’une casquette en tweed … il avait une démarche extraordinaire, il progressait comme en dansant sur un trottoir ».
Boisset comprit tout de suite que c’était la personne qu’il cherchait pour le rôle du docteur Scully dans Taxi mauve. Il accéléra donc le pas et découvrit que ce vieillard, c’était Fred Astaire !
Sources
Superbe blog - http://encreviolette.unblog.fr/category/ma-douce-france/page/2/

Yves Boisset, né le 14 mars 1939 à Paris, est un réalisateur français.
Il collabore à un certain nombre de revues spécialisées (Cinéma, Midi Minuit Fantastique), ainsi qu'à l'hebdomadaire Les Lettres françaises, et travaille avec Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier à la première édition (1960) de « Vingt Ans de Cinéma Américain ».
Dans les années 1970, il incarne un cinéma de gauche, s'inspirant souvent d'évènements réels : la police (Un condé), l'affaire Ben Barka (L'Attentat), le racisme (Dupont Lajoie) pour lequel il demandera une coécriture du scénario avec Jean-Pierre Bastid et Michel Martens, l'intrusion de la politique dans le judiciaire (Le Juge Fayard dit Le Shériff). Il est également le premier à aborder la guerre d'Algérie (R.A.S.).
Il adapte ou coadapte par ailleurs plusieurs auteurs reconnus : Michel Déon et son taxi mauve, Marie Cardinal avec André Weinfeld pour La Clé sur la porte, Jean-Patrick Manchette avec Folle à tuer, Philippe Djian et Bleu comme l'enfer.
À partir du milieu des années 1980, il se consacre quasiment exclusivement à la télévision (son dernier long métrage de cinéma en date est La Tribu en 1990), avec des réalisations historiques : L'Affaire Seznec, L'Affaire Dreyfus, Le pantalon (affaire Lucien Bersot, fusillé pour l'exemple), Jean Moulin, L'Affaire Salengro.
Ayant enquêté sur les massacres de membres de l'Ordre du Temple solaire pour son film Les Mystères sanglants de l'OTS, il a été entendu comme témoin de la défense lors du procès du chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik.
En 2011, il publie son autobiographie La Vie est un choix (Plon).
Invité par Radio-Courtoisie le 1er décembre à commenter son ouvrage, il revient sur l'ensemble de sa carrière et raconte à cette occasion comment France-Télévision l'aurait empêché de mettre certaines images d'archives datant de la Seconde Guerre mondiale dans son 12 balles dans la peau pour Pierre Laval.

Filmographie
Assistant réalisateur
- 1959 : Le vent se lève (Il vento si alza) d'Yves Ciampi
- 1961 : Qui êtes-vous, Monsieur Sorge ? d'Yves Ciampi
- 1961 - Le Colosse de Rhodes de Sergio Leone
- 1962 : Liberté 1 d'Yves Ciampi
- 1963 : L'Aîné des Ferchaux de Jean-Pierre Melville
- 1964 : L'Arme à gauche, de Claude Sautet
- 1966 : Un monde nouveau, de Vittorio De Sica
- 1966 : Paris brûle-t-il ?, de René Clément
- 1966 : Roger La Honte (Trappola per l'assassino) de Riccardo Freda
- 1966 : Coplan ouvre le feu à Mexico, de Riccardo Freda
Réalisateur
Cinéma
- 1968 : Coplan sauve sa peau
- 1970 : Cran d'arrêt
- 1970 : Un condé
- 1971 : Le Saut de l'ange
- 1972 : L'Attentat
- 1973 : R.A.S.
- 1975 : Folle à tuer
- 1975 : Dupont Lajoie
- 1977 : Un taxi mauve
- 1977 : Le Juge Fayard dit Le Shériff
- 1978 : La Clé sur la porte
- 1980 : La Femme flic
- 1981 : Allons z'enfants
- 1982 : Espion, lève-toi
- 1983 : Le Prix du danger
- 1984 : Canicule
- 1986 : Bleu comme l'enfer
- 1988 : La Travestie
- 1989 : Radio Corbeau
- 1991 : La Tribu
Télévision
- 1966 : Rouletabille (épisode Le parfum de la dame en noir) (série TV)
- 1979 : Histoires insolites (épisode La stratégie du serpent)
- 1987 : Série noire : La Fée Carabine
- 1988 : Médecins des hommes (série TV)
- 1989 : Le Suspect
- 1990 : Frontière du crime (Double Identity)
- 1991 : Les Carnassiers
- 1993 : Morlock
- 1993 : L'Affaire Seznec
- 1993 : Chute libre
- 1995 : L'Affaire Dreyfus
- 1996 : Morlock: Le tunnel
- 1996 : Les Amants de rivière rouge (feuilleton TV)
- 1997 : La Fine équipe
- 1997 : Une leçon particulière
- 1997 : Le Pantalon
- 1999 : Sam
- 2001 : Les Redoutables (épisode Poisson d'avril) (série TV)
- 2001 : Dormir avec le diable
- 2001 : Cazas
- 2002 : Jean Moulin
- 2005 : Ils veulent cloner le Christ
- 2006 : Les Mystères sanglants de l'OTS
- 2007 : La Bataille d'Alger
- 2009 : L'Affaire Salengro
- 2009 : 12 balles dans la peau pour Pierre Laval avec Christophe Malavoy
Bibliographie
- 2011 : La vie est un choix, (mémoire et témoignage), aux éditions Plon
Récompenses
- L'Attentat : grand prix de la mise en scène au Festival de Moscou.
- Dupont-Lajoie : Ours d'Argent au Festival de Berlin 1975
- Le Juge Fayard : prix Louis-Delluc 1976
- L'Affaire Seznec : 3 Sept d'Or 1994 - Meilleur réalisateur de fiction pour Yves Boisset - Meilleur film de TV - Meilleur auteur pour Yves Boisset
- Le Pantalon : Sept d'Or 1997 du Meilleur film de TV
- Jean Moulin : Prix du meilleur scénario FIPA 2002
-
LE FRANÇAIS , LANGUE "LATINE" ?
Alors que beaucoup trop de gens s’obstinent à considérer le français comme une langue prétendument « latine », je m’inscris en faux contre une telle assertion.
Contrairement à l’ italien, à l’espagnol, au portugais et au roumain, qui sont effectivement des langues latines à part entière, le français n’est en fait que partiellement une langue « latine » (romane, devrait-on d’ailleurs dire de façon plus juste en ce qui le concerne)…
En effet, outre le latin, les apports qui l’ont formé sont également constitués d’éléments grecs, celtiques (beaucoup plus de traces du celtique continental gaulois qu’on ne le croit généralement sont en effet passées dans la langue française, contrairement aux idées reçues. Environ 300 mots courants -voire « populaires »- nous viennent directement du celtique ancien), et germaniques (francique mais pas seulement, et l’ apport germanique dans le français est loin d’être négligeable).
Femelles guerrières Scythes
En fait, le français est un « patchwork ». C’est une langue qui se situe à l’exact carrefour des idiomes greco-latins, celtiques, et germaniques.
Beaucoup n’ont pas conscience, par exemple, du rôle capital qu’a rempli le celtique ancien dans la formation de la langue française.
Quelques exemples parmi beaucoup d’autres :
à ==> du gaulois « ad » (même sens)
abriter ==> du gaulois « abbritto/abbratto »
agacer ==> du gaulois « agacio »
aigre ==> du gaulois « acer/acros »
ainsi ==> du gaulois « ensindo/insindo »
ajonc ==> du gaulois « ation/action »
alise ==> du gaulois « alisia/alesia »
aller ==> du gaulois « alo »
alouette ==> du gaulois « alauda/aloda »
alpe ou alpes ==> du gaulois « alpa »
ambassade ==> du gaulois « ambactiata » (« ambactos » = serviteur, envoyé, ambassadeur)
andouiller (de cerf) ==> du gaulois « antolio »
anguille ==> du gaulois « angis »
ardoise ==> du gaulois « artesia/ardesia »
argent ==> du gaulois « argenton »
argot ==> du gaulois « arcato/arcoto »
arpent ==> du gaulois « arependis »
arracher ==> du gaulois « arraco/arranco/exraco »
arrimer ==> du gaulois « arrimmo »
attelle ==> du gaulois « astella »
auvent ==> du gaulois « aubannos »
bac (bâteau) ==> du gaulois « baccos/bascos »
bâche ==> du gaulois « basca/bascia »
bachelier ==> du gaulois « baccalarios »
badine, baderne, bâton ==> du gaulois « batina/basterna »
bagarre ==> du gaulois « bago »
bague ==> du gaulois « bacca/baga »
baie (maritime) ==> du gaulois « bacia/bacco »
baille (eau) ==> du gaulois « badila »
baiser ==> du gaulois « basio », dérivé de « busio » (bouche, lèvre)
balai ==> du gaulois « banatlos »
balcon ==> du gaulois « balacon »
balise ==> du gaulois « balisia/balidia »
balle/boule/ballon ==> du gaulois « balla/bolla »
bancal ==> du gaulois « bancalis »
baril ==> du gaulois « barriclo »
barrique ==> du gaulois « barrica »
bas ==> du gaulois « bassos »
bassin ==> du gaulois « baccinon »
bec ==> du gaulois « beccos »
bêche ==> du gaulois « besca/bethica »
beigne ==> du gaulois « begna/bogna »
berceau ==> du gaulois « barcio/bertho »
béret ==> du gaulois « berron »
berge ==> du gaulois « berga »
bernique ==> du gaulois « bernica »
béton ==> du gaulois « betomen/beto »
billot ==> du gaulois « bilia »
bitume ==> idem que béton, du gaulois « betomen »
blague ==> du gaulois « balga/bolga »
blaireau ==> du gaulois « blaria »
blason ==> du gaulois « blatio/mlatio »
bloc ==> du gaulois « bloco/blocco »
bagnole ==> terme dialectal du nord-ouest, de « banniole » = mauvaise carriole
braguette ==> du gaulois « braga », les braies (pantalon)Etc etc etc…
On pourrait continuer ainsi très très longtemps, avec toutes les lettres de l’alphabet.
Mais c’est déjà assez édifiant, non ??…
Bataille entre Scythes et Slaves (Viktor Vasnetsov, 1881)
Des mots français directement dérivés du gaulois, il y en a plusieurs centaines (si on compte les dérivés de chaque substantif), et la plupart d’usage très courant. A ce sujet, je vous recommande d’ailleurs un petit ouvrage (dont je possède un exemplaire) intitulé « DICTIONNAIRE DES MOTS FRANCAIS D’ ORIGINE CELTIQUE », par Jean-Marie RICOLFIS (« Celtes et Gaulois » Troisième partie, Editions Paris-Aubusson / Cercle Lugos, 1995).
Tirés du net, quelques exemples de l’apport germanique (francique) dans la langue française :
abandonner (de bannjan = bannir)
astiquer (de steken = pousser, utiliser un bâton pointu, relaté à stakka)
bâtir, bastille (de bast = écorse, écorse de bouleau en lamelle, ficelle, matériel de construction)
bière (de bera)
blanc (de blink = briller)
bleu (de blao)
bordure (de boord = bord)
brun (de bruin)
chic (de schikken = bien ranger, donc être valable)
choc, choquer (de scoc, schok = secousse)
cresson (de kresso = plante signifiant nourriture)
dard (de darod = lance à jeter)
détacher, attacher, tailler, étal (de stakka = pieu, bâton pointu)
écran (de scherm = protection)
épieu, pieu (de speut = pointu)
épier (de spieden)
escarmouche (de skirmjan = défence limitée)
étale, étalage, étable (de stal = construction où l’on ‘case’ un animal)
fief (de fehu, vee = troupeau de bovins)
fouquet (de fulko = écureuil)
frais (de frisk, fris)
fauteuil (de faldistôl = chaise stôl pliable faldi)
galop(er) (de walalaupan, wel lopen = bien courir)
gant (de want)
garant (de warand, ware hand = vrai (et en) main)
garçon (de wrakjo = diminutif de wraker = tueur, donc: petit guerrier )
garde, gardien (de warding, dérivé de wachten = attendre, observer, se tenir prêt)
gaspiller, gaspillage (de wostjan, woest = rendre sauvage , sauvage)
grappe (de greip, greep, grip = prise par une main)
gris (de grîs, grau = brillant mais foncé)
guerre (de werra, war = confusion)
haïr (de hatjan)
honnir (de haunjan, honen)
jardin (de gaarden, dérivé de wachten = (plur.) les parcelles gardées, entourées d’une protection)
landes (de land= terre sableuse)
loge(r) (de laubja)
marche(r) (de marka = marquer d’un pas)
marque (de mark, merk = signe, signe d’une délimitation, frontière)
marquis (de mark = comte d’un région frontalière)
maréchal (de marhskalk= gardien skalk des juments maren royales)
randonnée (de rant, rand = coté)
rang (de hring = chaînon, anneau)
saisir (de sakjan = revendiquer)
standard (de standhard = tenir debout fermement)
trot(ter) (de trotton = mouvement de haut en bas)Etc etc.
Celtes et Gaulois
Enfin, en guise d’appendice, pour tous ceux qui s’imaginent que le français ne comprend que quelques rares mots d’origine celtique et dérivés du breton, précisons aussi que beaucoup de termes bretons sont en fait eux-mêmes apparentés au…gaulois (eh oui !).
Par exemple :
Marc’h ==> du gaulois « marcas » (cheval)
Bagad (et français bagaude) ==> du gaulois « baccatos » (troupe)
Men ==> du gaulois « meno » (pierre, montagne)
Bara ==> du gaulois « barago » (= pain)
Gwin = du gaulois « oinos » (= vin)
Anaon ==> du gaulois « anatmon » (= âme)Etc… (les exemples sont légion, mais vu que je ne connais moi-même que 60 à 80 termes de la langue bretonne, je ne pourrais pas énormément développer le sujet)
CONCLUSION
A l’origine, le celtique continental ancien (auquel se rattachaient les divers dialectes gaulois) était lui-même une langue très proche du latin, dans ses structures grammaticales, syntaxiques, son vocabulaire etc. C’est d’ailleurs pour cette raison que le latin des envahisseurs romains a été si facilement assimilé par les populations des Gaules.
Et à ce titre, il est franchement réducteur de parler de langue « latine », puisque le latin dont découlent les langues romanes ultérieures (langues d’Oc et d’Oïl, dont procède le français) n’a fait que se superposer aux parlers gaulois préexistants.
En outre, comme je l’expose dans le cadre de ce petit article, il y a eu énormément d’apports gaulois et germaniques dans la formation du vocabulaire français. Ce qui n’est pas le cas des langues véritablement latines (Italien, espagnol, portugais etc).
Si le français a été classé officiellement comme langue « latine », c’est surtout parce que jusqu’à une époque récente, on n’avait que très peu de connaissances au sujet de la langue celtique continentale. Mais ces connaissances ont nettement progressé depuis les vingt dernières années, et il est donc aujourd’hui tout à fait légitime de remettre en question certaines « certitudes » en matière de linguistique.
En ce sens, le français est une langue quelque peu « bâtarde », ce qui en fait toute la richesse et la singularité. Et c’est pourquoi il est très réducteur de la classer parmi les langues « latines ». Ce qui ne peut être vrai qu’en partie seulement.
Gaulois (cliquer sur l’image)
L’objet de ce petit exposé est donc juste de vous encourager à en finir avec une idée fausse : non, nous ne parlons pas une langue latine, et oui, il y a beaucoup de celtique, d’ hellénique et de germanique dans notre parler quotidien !
Korreos
http://www.propagandes.info/blog/le-francais-langue-latine-a-dautres-par-korreos/
http://france.eternelle.over-blog.com/pages/LE_FRANCAIS_LANGUE_LATINE_-8679685.html
-

Origines du drapeau breton
Le kroaz-duLe kroaz-du, la croix noire, est peut être le plus ancien drapeau breton.De nombreux drapeaux arborant une croix datent du XIIe siècle. Au départ de la troisième croisade, en 1188, on attribua ainsi la croix rouge aux Français, la croix blanche (sur fond rouge) aux Anglais, et la croix jaune aux Flamands. Même si aucun texte de l'époque ne fait mention de la croix noire des Bretons, on peut estimer que ce drapeau date de cette époque.
On retrouve aussi ces croix sur le drapeau des ports d'embarquements: le drapeau marseillais porte ainsi une croix d'azur.
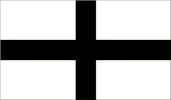 L'origine de l'hermineLes blasons étaient à l'origine des écus: des boucliers qui permettaient de protéger le guerrier. C'est à l'époque des Croisades que l'on s'est mis à les peindre ou bien à les recouvrir de fourrures. Les animaux dont on se servait pour orner ces écus étaient principalement l'hermine et l'écureuil (vair).
L'origine de l'hermineLes blasons étaient à l'origine des écus: des boucliers qui permettaient de protéger le guerrier. C'est à l'époque des Croisades que l'on s'est mis à les peindre ou bien à les recouvrir de fourrures. Les animaux dont on se servait pour orner ces écus étaient principalement l'hermine et l'écureuil (vair).
L'hermine est un animal proche de la belette. Les romains classaient toutes ces charmantes petites bêtes, comme la marmotte, dans la catégorie des rats ! Cet animal portait alors le nom latin de mus armenia : le rat (ou la souris) d'Arménie. L'origine de l'hermine est donc arménienne! En ancien français, ermin désignait aussi bien l'arménien que l'hermine.
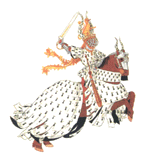
fourrure d'hermine
moucheture
d'hermine
an erminigLe pelage de l'hermine est brun-roux l'été et devient blanc l'hiver (dans les régions froides) : seul le bout de la queue reste noir. On cousait les peaux côte à côte et on plaçait au milieu de chacune la queue fixée par trois barrettes disposées en croix.Puis on s'est mis à représenter les décorations des écus : l'hermine ne désignait plus seulement la fourrure mais aussi cette représentation formée du bout de la queue (appelée plus précisément la moucheture d'hermine) et des trois barettes.
L'hermine ainsi stylisée devient alors un emblème d'héraldique que l'on retrouve dans les armes de plusieurs familles de la noblesse féodale.

l'hermine (animal)
sur le blason de Vannes L'hermine-plainDans le régime féodal, l'aîné héritait du blason paternel. Mais les autres enfants devaient briser les armes: ils ajoutaient une brisure (un signe distinctif). Ainsi, les Dreux avaient pour blason un échiqueté avec une bordure. Pierre Mauclerc, le cadet, a brisé le blason avec l'hermine. Il devait commencer à porter ces armoiries vers 1209.
L'hermine-plainDans le régime féodal, l'aîné héritait du blason paternel. Mais les autres enfants devaient briser les armes: ils ajoutaient une brisure (un signe distinctif). Ainsi, les Dreux avaient pour blason un échiqueté avec une bordure. Pierre Mauclerc, le cadet, a brisé le blason avec l'hermine. Il devait commencer à porter ces armoiries vers 1209.Et c'est à son cousin, Pierre Mauclerc de Dreux, que le roi de France donne le trône ducal de Bretagne. Il emporte alors avec lui son blason. L'emblème de la Bretagne est donc d'origine drésoise !

blason de
Pierre MauclercEn 1316, le duc de Bretagne, Jean III, change d'armoirie : il retire l'échiqueté et la bordure. La brisure d'hermine devient les pleines armes du duc de Bretagne.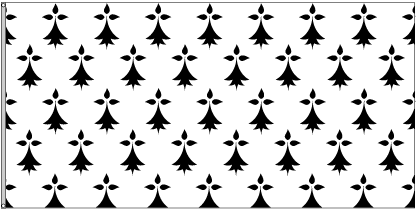 L'hermine est au duc de Bretagne ce que la fleur de lis est au roi de France. En breton, on écrit : an erminig (litt. la petite hermine : la terminaison -ig est un diminutif, de ermin). Au Moyen Âge, le lis et l'hermine sont des symboles de pureté : le lis parce qu'il est associé à la Vierge, et l'hermine pour la blancheur de sa fourrure. Lui est associée cette devise latine :
L'hermine est au duc de Bretagne ce que la fleur de lis est au roi de France. En breton, on écrit : an erminig (litt. la petite hermine : la terminaison -ig est un diminutif, de ermin). Au Moyen Âge, le lis et l'hermine sont des symboles de pureté : le lis parce qu'il est associé à la Vierge, et l'hermine pour la blancheur de sa fourrure. Lui est associée cette devise latine :
Potius mori quam foedari
Plutôt la mort que la souillure
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret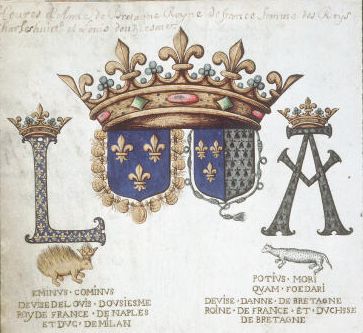
Armes de Louis XII et Anne de BretagneLa duchesse Anne de Bretagne épouse le roi de France Charles VIII ; veuve, elle se remarie avec son successeur Louis XII dont elle a une fille, Claude de France, qui épousera François Ier.
blason de Rennes
XVIIeLe Gwenn-ha-duCe drapeau a été dessiné au début du XXe siècle, en s'inspirant du blason de Rennes et de la bannière étoilée des États-Unis. Les américains ont le stars and stripes, les bretons, le gwenn ha du : littéralement blanc et noir. C'est la bannière herminée ! Les bandes (stripes) du drapeau américain représentaient les 13 états unis à l'origine, de même les bandes du drapeau breton représentent les 9 anciens évêchés :
- les 4 bandes blanches pour la Bretagne bretonnante ou Breizh
- les 5 bandes noires pour la Bretagne gallaise ou BertaèynEn gallo, le drapeau breton porte le nom de Blanc e Neirr.
Les hermines constituent l'héritage du duché de Bretagne. Cependant, le nombre d'hermines (11) n'a pas de signification particulière : mais on peut lui en trouver... Par exemple, les saints de Bretagne : il y a déjà les 7 saints du Tro Breizh... il en reste 4 à trouver...
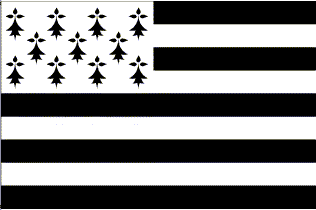 L'Ordre de l'hermineAprès les blasons, apparaissent les ordres. Ce sont d'abord les ordres liés aux Croisades : l'Ordre de saint Jean de Jérusalem (devenu l'Ordre de Malte) ou bien l'Ordre des templiers. Les souverains régnants on voulu faire de même pour récompenser leurs fidèles : ainsi naissent l'Ordre de la Jarretière en Angleterre, l'Ordre de l'étoile en France, l'Ordre du collier en Savoie. Le duc de Bretagne Jean IV a créé l'Ordre de l'hermine, en 1381. Il construit l'abbaye de saint Michel des Champs, près d'Auray, lieu de la bataille qu'il a remportée et l'a consacrée duc. Chaque année les chevaliers de l'ordre de l'hermine se rencontraient dans cette abbaye.
L'Ordre de l'hermineAprès les blasons, apparaissent les ordres. Ce sont d'abord les ordres liés aux Croisades : l'Ordre de saint Jean de Jérusalem (devenu l'Ordre de Malte) ou bien l'Ordre des templiers. Les souverains régnants on voulu faire de même pour récompenser leurs fidèles : ainsi naissent l'Ordre de la Jarretière en Angleterre, l'Ordre de l'étoile en France, l'Ordre du collier en Savoie. Le duc de Bretagne Jean IV a créé l'Ordre de l'hermine, en 1381. Il construit l'abbaye de saint Michel des Champs, près d'Auray, lieu de la bataille qu'il a remportée et l'a consacrée duc. Chaque année les chevaliers de l'ordre de l'hermine se rencontraient dans cette abbaye.La devise de l'Ordre de l'hermine était : À ma vie !
Elle était écrite en français comme la devise de l'ordre anglais de la Jarretière (et n'oublions pas que l'on a jamais vraiment parlé breton à Rennes ou à Nantes !)
Symboles de Bretagne et du QuébecLa Révolution française a remplacé le lis et la Vierge par le bonnet phrygien et Marianne. Cependant le lis est toujours présent sur les blasons de certaines villes de France, à commencer par Paris et Lyon. En Amérique, la fleur de lis est l'emblème de la belle province du Québec. L'hermine est à la Bretagne ce que la fleur de lis est au Québec ! C'est l'emblème de la langue bretonne, l'ame celte de la Bretagne.Le drapeau de Guérande est très proche du drapeau québécois :
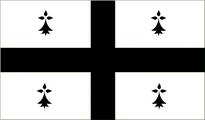 Le drapeau corniqueLes Cornouailles (de Grande-Bretagne) ont une croix blanche sur leur drapeau noir. Son origine est certainement contemporaine de celle du gwen-ha-du. Les couleurs sont les mêmes, pour deux langues, le breton et le cornique très proches l'une de l'autre.
Le drapeau corniqueLes Cornouailles (de Grande-Bretagne) ont une croix blanche sur leur drapeau noir. Son origine est certainement contemporaine de celle du gwen-ha-du. Les couleurs sont les mêmes, pour deux langues, le breton et le cornique très proches l'une de l'autre.
 • les drapeaux de la Bretagne : histoire du gwen ha du, banniel Breizh & drapeaux de la Bretagne (en breton ou français)
• les drapeaux de la Bretagne : histoire du gwen ha du, banniel Breizh & drapeaux de la Bretagne (en breton ou français)• l'hermine : présentation de l'animal & photos de l'hermine blanche avec sa queue noire
-> noms bretons des communes de Bretagne
-> langue bretonne & dictionnaire breton
-> drapeaux du monde
-
ABBE SAUNIERE :
VIDEO SUR L'ABBE SAUNIERE
ET LE TRESOR DE RENNES LE CHATEAU
rennes le chateau partie1 par nwotribeCe film, intitulé "Rennes-Le-Château, du trésor au vertige", retrace l'étonnante histoire de l'abbé Saunière et du trésor qu'il aurait découvert à Rennes-Le-Château et qui lui a valu une notoriété mondiale. Cette notoriété ne se dément pas aujourd'hui encore, alors que Béranger Saunière est mort en 1917. L'abbé Saunière est certainement l'Audois le plus célèbre au monde...
Le film dure 30 minutes, il a été écrit et réalisé par Georges Combe.
La vidéo commence ainsi :Quelle histoire ! Une histoire dont on ne sort pas indemne. Plus de 300 livres, des dizaines de films, des visiteurs venant de tous les coins du monde, tout cela pour un simple curé de campagne qui aurait trouvé un trésor il y a un peu plus d'un siècle, dans un petit village du sud de la France : Rennes-Le-Château...
rennes le chateau partie 2 par nwotribe
rennes le chateau partie 3 par nwotribeNé à Montazels, dans l'Aude (tout près de Rennes-le-Château), aîné d'une famille nombreuse et modeste, Bérenger Saunière devient prêtre (sans doute sous la pression de sa famille) et est ordonné en 1879. Après quelques affectations successives dans son département comme à Clat, il est affecté comme curé de Rennes-le-château en 1885.
Dès son arrivée au village, il est choqué par l'état de délabrement de l'église. Ses débuts dans la paroisse sont modestes : il vit pauvrement et s'occupe comme il peut, en lisant, en chassant... Dès son arrivée, il se liera très vite avec Marie Dénarnaud, sa servante, qui le suivra jusqu'à sa mort. En 1891, Saunière entreprend des travaux dans l'église avec l'argent prêté par la mairie.
C'est lors de ces travaux que les ouvriers découvrent dans un pilier du maître-autel, trois fioles où sont logés des parchemins. L'abbé ne tarde pas à subtiliser les parchemins aux ouvriers, prétextant qu'ils ont une grande valeur. La nouvelle se sait très vite au village, et on demande à Saunière de vendre les documents à un musée, l'argent gagné devant rembourser les frais de réparation de l'église. En 1893, Saunière se rend ainsi à Paris, avec l'accord et grâce au financement de l'évêché de Carcassonne. Il doit s'entretenir avec l'abbé Vieil, directeur de l'église de Saint Sulpice, afin d'obtenir la signification de ces documents.
Durant son séjour à Paris, il rencontre Emma Calvé, célèbre cantatrice de l'époque. Quelques jours plus tard, l'abbé Vieil lui explique, semble-t-il, le sens caché des parchemins. Mais personne ne sait rien de cette discussion. On sait que Saunière repart peu après, laissant les documents, mais en en gardant des copies. Ces parchemins, qui n'avaient au départ rien d'extraordinaire (il s'agissait en fait de passages de la Bible écrits en latin) semblent être la clé du mystère de Rennes-le-Château car c'est à partir de ce moment que débute l'étrange vie de l'abbé Saunière.
Sitôt rentré, Saunière entame d'étranges découvertes : en face du maître-autel, il découvre avec l'aide de ses ouvriers, une dalle dite du Chevalier (aujourd'hui exposée au musée de Rennes) où la face cachée présente d'étranges sculptures de cavaliers, apparemment très anciennes. Il ordonne alors que l'on creuse une fosse à cet emplacement, et congédie ensuite les ouvriers afin d'explorer le lieu lui-même.
L'attitude de l'abbé paraît de plus en plus étrange aux villageois quand ils se rendent compte qu'il efface dans le cimetière les inscriptions dressées sur une très ancienne tombe, celle de la marquise de Blanchefort. Il va même jusqu'à déplacer la stèle. Le maire, choqué par ces saccages, lui demande d'arrêter. Dès lors, les villageois voient Saunière de plus en plus souvent voyager et s'absenter du village, souvent pour plusieurs jours. Durant ses voyages, il est muni d'une valise qu'il porte à dos d'âne.
Autre chose encore plus étrange, le curé de Rennes qui vivait jusque-là dans la pauvreté, se met à faire de folles dépenses dans son église qu'il rénove désormais à ses frais. Il entreprend d'ailleurs une rénovation complète qu'il réalisera selon ses goûts. Elle est achevée en 1897. Mais le style est très original voire choquant au goût des autres ecclésiastiques. En effet, outre des peintures de couleur vive et de nombreuses statues, le bénitier est un diable sculpté.
Les constructions et les rénovations ne s'arrêtent pas en si bon chemin. En 1899, il achète six terrains sur Rennes-le-Château,
Photo de la Tour Magadala construire par Béranger Saunière
Cliquez ici pour découvrir une galerie de photos de Rennes-Le-Château
et les met au nom de sa servante, Marie Dénarnaud qu'il designe comme sa légataire principale.
Le domaine construit jusque-là est terminé en 1906. Il aménage un jardin, une serre, mais aussi une maison : la villa Béthanie, petite, mais luxueuse, comparée aux autres maisons du village.
Mais son œuvre la plus étrange et la plus célèbre est sans aucun doute la tour Magdala qu'il bâtit au bord de la colline. Cette petite tour, aujourd'hui visitable, abrite sa bibliothèque.
Dans sa villa, il accueille des invités de marque qui viennent de très loin, mais dont l'identité reste obscure. Si la villa sert à loger les invités, Saunière ne vivra jamais autre part que dans son presbytère.
Si le luxe fastueux de l'abbé fait murmurer les villageois, il fait aussi grincer des dents l'évêché qui l'accuse de trafic de messe, c’est-à-dire de détourner l'argent expédié par les congrégations et fidèles avec qui il est en contact à travers toute la France à des fins personnelles.
Il est d'ailleurs sermonné par l'évêché dés 1901 c'est-à-dire sous l'épiscopat de Monseigneur Félix-Arsène Billard et continuera à l'être régulièrement sous l'épiscopat de son successeur Monseigneur Paul-Félix Beuvain de Beauséjour.
En 1910, Saunière est interdit de messe et remplacé par un autre curé. Habitant toujours à Rennes-le-Château, Saunière officie dans sa villa, dans la petite chapelle placée dans la véranda où les habitants viennent le rejoindre, boudant toutes les messes de l'autre curé.
Durant la Première Guerre mondiale, Saunière, qui n'a d'ailleurs pas pu récupérer son église, se voit soupçonné d'espionnage par certains villageois. Il meurt le 22 janvier 1917. Marie Dénarnaud hérite de sa fortune et de ses terres.
Elle s'endette et vit recluse jusqu'en 1942 où elle fait la connaissance de Noël Corbu.
En 1946, elle effectue un testament stipulant M. et Mme Corbu légataires universels du domaine où ils s'installent.
Elle est frappée, le 24 janvier 1953, d'une attaque cérébrale, la laissant muette et paralysée.
Elle meurt 5 jours plus tard, le 29 janvier 1953, sans prononcer un mot. Elle avait 85 ans.
Autres pages sur Rennes-Le-Château
Vidéo sur Rennes-Le-Château (aperçu général du village et des paysages, vues de la Tour Magadala et de l'église)
Galerie de photos de Rennes-Le-ChâteauLe trésor de l'abbé Saunière (une autre vision des choses en vidéo)
SOURCES
http://www.aude-aude.com/content/view/3643/1/
-
Par Dona Rodrigue dans Les NORMANDS, Dynastie de CONQUERANTS ( vidéos ) le 20 Septembre 2013 à 13:00
Les Normands, Une Dynastie de Conquerants /
1 / Premières Invasions
Du IXe au XIIIe siècle, les Normands, héritiers des Vikings, dominèrent et façonnèrent l'Europe médiévale.
En quatre siècles, ces guerriers barbares parviennent à former une nation, conquérir un royaume et découvrir tout un continent.
Cette série en trois épisodes retrace leur épopée.
Pour apprécier les vidéos... cliquer sur le logo central
de RADIONOMY - COLONNE à GAUCHE
le fond musical du BLOG Sera supprimé...pour toutes les vidéos ...
Du Xe au début du XIIIe siècle, les Normands, héritiers des Vikings, dominent et façonnent l'Europe médiévale.
En quatre siècles, ces guerriers barbares parviennent à former une nation, conquérir un royaume et découvrir tout un continent.
Au XIe siècle, l'installation de nobles normands dans le sud de l'Italie, puis leur progressive intégration aux populations et aux us de la région. Série documentaire en 3 épisodes écrite :
Par Rees Davies, Elisabeth Van Houts et J. Mervyn Williams, réalisée par Caryl Ebenezer
An 814 :
Charlemagne meurt, laissant l’Europe disloquée, sans résistance face aux Vikings, ces guerriers venus du Nord.
En 911, le roi des Francs, Charles le Simple, confie la future Normandie à l’un de leurs chefs, Rollon.
En échange, Rollon doit lui prêter allégeance et se convertir au christianisme.
Les Normands s’installent, gagnent le soutien de l’Eglise, profitent d’un élan réformiste pour asseoir leur pouvoir, restaurent les abbayes normandes.
Celles-ci accueillent des penseurs de toute l’Europe et deviennent de hauts lieux intellectuels.
Les Normands consolident leur Etat, qui atteint son apogée en 1066, quand le duc Guillaume le Conquérant s’empare du royaume d’Angleterre.
Les Normands - Une dynastie de conquérants 2
De 1010 à 1120 environ, il y eut un flux constant de départs de la Normandie vers l’Italie du Sud.
Mercenaires et chevaliers, ces hommes en quête de nouveaux territoires, s’installèrent dans l’Italie du Sud sans beaucoup de ménagement, n’hésitant pas à user de leurs armes et de la violence pour parvenir à leurs fins.
Certains chevauchèrent des années durant, conquérant de nouveaux territoires comme la Sicile.
Puis, progressivement, au contact des peuples autochtones, les Normands finirent par concilier dialogue et pouvoir.
La Sicile connut alors un développement économique et culturel sans précédent qui devait durer une soixantaine d’années.
Les Normands, Une Dynastie de Conquerants /
3 / Un Nouvel Age
video 3
En conquérant l’Angleterre en 1066, les Normands ont ouvert le pays aux influences continentales. Au départ, chacun parle sa langue mais à mesure que les Normands s’établissent dans le pays et se marient aux autochtones, les deux langues se mélangent.
Finalement la langue anglaise assimile des milliers de mots français.
En Ecosse, les Normands construisent des châteaux et fondent des familles nobles qui doivent fournir les futurs rois.
Le système féodal normand est appliqué dans les «Lowlands».
En Irlande, les Normands s’installent à l’est, autour de Dublin et influencent durablement la culture, l’histoire et l’ethnicité du pays.
-
COUTUMES DE LA GRANDE BOUCHERIE
Statuts de la Grande Boucherie
Les premiers statuts connus de la corporation remontent au XIIème siècle.
En 1182 Philippe Auguste, répondant aux suppliques des bouchers, octroya la confirmation de leurs "antiques coutumes" concédées et perpétuées par son père, son grand père et ses prédécesseurs les Rois de France. Comme ces coutumes étaient restées orales, le Roi les fit coucher sur le parchemin et revêtir de son sceau.
Il y a donc une reconnaissance des pratiques professionnelles d'un métier Juré, d'une Jurande, par la plus haute autorité du Royaume. Inversement, dans le Midi de la France et l'Italie, ce sont les autorités qui fixèrent les règles du jeu et imposèrent les usages aux artisans.
Encore une fois, France du Nord et France du Sud diffèrent.
Le texte ne comprenait que quatre paragraphes. Le premier affirmait que les bouchers pouvaient vendre et acheter bêtes et viandes en banlieue sans acquitter les péages et les coutumes. Ils pouvaient se livrer dans les mêmes conditions au négoce des poissons tant de mer que d'eau douce.
Souvenons-nous, à ce propos, que des étaux de poissonniers souvent loués par les Maîtres de la Porte, garnissaient la ruelle des pierres à Poissons, à l'Ouest du Grand Châtelet.
C'était une compensation pour le "manque à gagner" durant les 150 jours de Carême annuel. D'autres boucheries du royaume bénéficiaient d'avantages similaires, ce qui explique la présence de poissons dans leurs armoiries.

Les articles III et IV se rapportaient à la fiscalité : pour travailler le dimanche les artisans devaient verser une obole au Prévôt. Chaque année, à l'Octave de Noël, les bouchers devaient verser douze deniers au Roi.
A l'Octave de Pâques et à la Saint-Denis ils donnaient treize deniers à
quelqu'un que le Roi mandatait pour cela. Enfin, à l'époque des vendanges, le Roi recevait le "hauban", une redevance en vin, en échange de laquelle les bouchers étaient autorisés à "trancher la viande de porc et de bœuf", c'est à dire exercer leur métier.L'article II faisait allusion aux repas, le "past" et "l'abreuvement", que tout aspirant à la maîtrise devait offrir aux Maîtres pour être admis parmi eux. Nous ne pouvons que déplorer le caractère succinct et l'imprécision de ces statuts. Qui était l'officier royal qui recevait treize deniers ? Était-ce l'un des quatre officiers qui bénéficiaient du past selon les statuts postérieurs de 1381 ?
De même ces textes ne comportent pas la moindre allusion à la mise en commun des étaux ou l'hérédité du métier, deux coutumes importantes de la Grande Boucherie. Cependant il apparaîtra plus loin que dès 1250 le métier s'était fermé aux étrangers et que l'accession à la maîtrise devenait un privilège réservé aux fils de maîtres.Lorsqu'un conflit opposa la Communauté aux Templiers en 1282, les bouchers affermèrent détenir le monopole de vente des viandes et glissèrent une allusion à l'hérédité : "Dicebant se et predecessores suos esse et fuisse en possessione […] faciendi et constituendi carnifices ad scindendum et vendedum carnes pro tota villa, videlicet filios carnificum, auctoritate et assensu nostro."
Vidimés en 1290, 1324 et 1358, ces règlements restèrent deux siècles durant tout ce que nous pouvons connaître des coutumes de la Boucherie.En effet le Prévôt Boileau n'enregistra point les règlements de la communauté dans son "livre des métiers" et ce ne fut qu'en 1381 que le roi Charles VI octroya de nouveaux statuts, beaucoup plus élaborés que ceux de Philippe Auguste.

Par malheur ce texte comportait lui aussi quelques lacunes : il ne traitait ni de la préparation des viandes, ni de l' hygiène alimentaire.Par conséquent il nous faudra recourir d'autres sources : les règlements en vigueur dans des boucheries concurrentes ou des procès-verbaux d'inspection.
Nous nous référerons toutefois aux statuts de 1381 dans ce chapitre pour présenter le personnel de la boucherie, ses juridictions et les usages en vigueur, en nous gardant de commettre des anachronismes : rien n'indique que les usages de 1381 copiaient les "antiques coutumes" de 1096.
Seront évoqués successivement les garants du maintien des usages : le Maître Chef, les Jurés et le Juge placé à la tête du tribunal de la boucherie; puis la mise en commun des étaux ainsi que l'hérédité et l'accession à la maîtrise.
Le Maître Chef (ou Maître, ou Chef)
La première mention de ce personnage remonte à 1196 : à cette date Louis VII établit une rente en viande à percevoir auprès du Maître des Bouchers, au profit d'une léproserie installée dans les marécages du Nord Ouest Parisien, sous le patronage de Saint-Lazare (a) .La fonction de Maître était surtout honorifique : le premier des bouchers devait représenter dignement la corporation auprès des plus hautes autorités civiles et religieuses.
Il n'était pas d'assemblée du métier qui se puisse tenir en dehors de sa présence ou de décision prise sans son aval.
Jusqu'en 1551, date à laquelle le Roi décida de nommer lui-même le Maître, celui-ci était élu par les Maîtres Bouchers durant une réunion extraordinaire.
Dans un délai de un mois suivant le décès du Maître, les maîtres du métier se réunissaient pour désigner un collège de douze électeurs qui choisissaient à leur tour le nouveau Maître perpétuel. L'intérim, nous serions tenté d'écrire l'interrègne, était assuré par les quatre jurés qui percevaient en compensation les revenus habituellement versés au chef défunt.Le nouveau Maître devait compter avec les jurés : s'il incarnait l'autorité suprême, il n'était pas propriétaire du métier . A la différence du grand Panetier ou du grand Chambrier qui régentait la boulangerie ou certains métiers de l'habillement. Ainsi, " le dist maitre ne [pouvait] faire ne recevoir bouchier ne escorcheur senz l'accord et assentement des quatre jures et d'aucun des preudes hommes du métier]" (art. 6).
De même contrôleur des dépenses de la Grande Boucherie il ne pouvait en être le gestionnaire : "ne fera mise en recepte par sa main (art. 8).Certaines décisions du Maitre Chef juges non conformes aux statuts ou à l'intérêt de la Communauté pouvaient être cassées par les Jurés.
En 1459 Richard de Saint-Yon "ordonna et créa" comme Maire, Juge du tribunal, un homme de loi du Châtelet Robert Fessier.
Le choix reçut l'aval desdits Jurés Thibert et Ladehors mais l' année suivante les nouveaux Jurés cassèrent cette nomination et procédèrent à l' élection d'un Maire plus conforme leurs vœux, Nicolas Chapelle, tandis que Fessier devenait procureur du tribunal.
Les décisions du Maître étant à la merci d'une opposition des Jurés, il semble qu' il détenait moins le pouvoir que les apparences de ce pouvoir : les archives et le sceau que peu de corporations pouvaient s'enorgueillir de posséder.Le Roi se montrait, en effet, avare de ce genre de concession, car elle représentait une perte de revenus pour le Trésor : une redevance était perdue chaque fois que le sceau était utilisé pour authentifier un acte ou conclure une transaction .
En ce domaine, comme en beaucoup d' autres, la Grande Boucherie tranchait sur les autres corporations parisiennes : " l'en doit avoir un petit seel ou signet qui sera tout propre et perpétuel à signer toutes les actes ou mémoriaux et les gagements que l' en fera des plaiz et des causes, lequel sera mis en la huche des papiers [archives ] ... dont l' une [des clefs] sera baillée au maistre, et l'autre au maire et la tierce à l'un des jurez".
Cependant la fonction de Maître Chef n'était pas simplement honorifique, elle semble avoir été aussi une sinécure très recherchée.En effet, en sus des avantages en nature versés par tout aspirant à la maîtrise, le tiers des profits du métier tombait dans l' escarcelle du Maître: "de touz les prouffiz et émolumens qui ystront ou pourront issir de la juridicion desdis maitres et jurez soit en deffaux soit en amendes ou autrement, le tiers en tournera par devers et au proffit du dit maistre et les deux pars tourneront au proffit du commun".
Sans aucun doute existait-il de lourds frais de représentations mais ils étaient sans commune mesure avec les bénéfices qui étaient retirés.
Aussi la charge fut-elle activement recherchée et monopolisée par les membres des grandes familles, cette mainmise de ces dynasties étant favorise par l'élection au suffrage indirect.
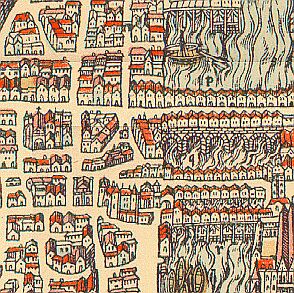
Le Maire et le tribunal de la Grande BoucherieAu Moyen-Age chaque seigneur lac ou ecclésiastique avait à cœur de défendre son rentable droit de justice dans les terres placées sous son autorité. La multiplication des tribunaux des forces de police et des compétences territoriales engendrait une anarchie dont profitaient les malfaiteurs.
En changeant de rue ou d'immeuble le contrevenant pouvait échapper aux poursuites (en théorie). Jeté en prison, il pouvait se prétendre clerc et se faire réclamer par les tribunaux ecclésiastiques souvent plus cléments que les tribunaux du Prévôt, comme le fit le Maître Jean de Saint-Yon en 1417.
Par un lent et opiniâtre grignotement le pouvoir royal réussit heureusement à amoindrir l'im
portance des juridictions privées : au XVIème siècle, le Grand Châtelet devint le seul tribunal compétent à Paris.
Par une insigne faveur du souverain la Grande Boucherie put se doter d'un tribunal privé jugeant tout fait de boucherie ou tout litige dans lequel un membre du métier se trouvait impliqué hormis les cas criminels relevant du Grand Châtelet.
Les réunions du tribunal se tenaient trois fois la semaine, les mardi, jeudi et dimanche, dans la halle de la Porte, puis après la destruction de 1416, dans des hôtels particuliers."Le maistre et les jurez jurent, quant ils sont crées et fais, que il seront presens en leurs personnes tous les trois jours que l'en a acoustumé de tenir leurs plaiz se ilz n'ont grand empechement et aideront au maire ou à cellui qui tendra les plaiz."
Ce "Maire" dont il était question dans l'article 9, plus précisément nommé "maire et garde de la justice de la communauté des bouchers de la Grande Boucherie" était un homme de loi, institué juge du Tribunal. Il était quelquefois ordonné et crée par le Maistre mais il était, le plus souvent, élu par un "Conseil de la Boucherie" qui d'après ce que l'on connaît de l'affaire Fessier était composé de parlementaires et d'avocats du Grand Châtelet.
En revanche nous ignorons tout des modalités d'élection du procureur assistant le Maire.
Tout boucher ayant reçu notification par les écorcheurs sergents d'une convocation devait obtempérer sous peine d'amende ou d'interdiction d'exercer : "il pourra estre contrains à paier dix sept soulz six deniers […] mais selon a que les maistres et jurez le verront obéissants ils tasseront pour le premier deffaut douze deniers".
A la troisième sommation "Lors li puet le mestier estre deffendu, du mestre ou des jurez" (art. 4). Son étal pouvait être détruit par les écorcheurs en cas d'obstruction violente.

A la lecture des registres de séances du XVème siècle, dont deux tomes sont conservés à la bibliothèque historique de la ville de Paris, il semble que les bouchers étaient prompts à l'invective, n'hésitaient pas à se servir de leurs instruments de travail pour vider une querelle et avaient un sens particulier de la plaisanterie.En 1442, 1e boucher Jean Thienau coucha en prison pour avoir " pris et embrassé de forse "une certaine Jeannette des Perrois et l'avoir "mise par deux fois en la rivière jusqu'au dessus des genoux".
Les statuts de 1381 reconnaissaient la rudesse des artisans: "que nul boucher ne die villenie a personne qui viengne acheter chars en la boucherie" (art. 20).
De même, en 1456, tout en rappelant certaines règles d'hygiène, le tribunal dut interdire aux maîtres et aux étaliers de se critiquer mutuellement et de se lancer n' importe quoi la tête l'un de l'autre.
Dans de nombreuses villes françaises, il existe des "rues des Bons Garçons", à proximité des abattoirs du Moyen Age. Ceci démontre que nos anciens ancêtres savaient manier l'ironie et ne se faisaient pas d'illusions sur les mœurs des écorcheurs…
L
es bouchers n'avaient point le monopole des pratiques douteuses; il serait exagéré de leur reprocher "une sorte d'hérédité psychologique" ou d'admettre que " leurs abattoirs [étant] confondus avec leur résidence ordinaire, ils ont toujours sous les yeux le spectacle des animaux tués […] De là des natures vulgaires...
En réalité les bouchers semblent avoir fait de réels efforts pour policer leur métier. Les maîtres excommuniés ne pouvaient exercer ainsi que les maris de femmes de mauvaise vie "se aucun prent femme commune deffamée, sens le congié du maistre et des jurez,il sera privé de la grande boucherie toujours […] mais il pourra tailler à un des estaux de Petit Pont...
Il reste que le mauvais exemple venait de très haut : Jean de Saint-Yon qui deviendra Maître Chef sous la domination anglaise fut jeté dans un cul de basse fosse à la Conciergerie.
Les juges lui reprochaient d'avoir provoqué une bataille rangée après avoir lancé à son adversaire "villain puant je vous crèverai l'œil" et d'être passé à l'acte...
En 1489 Joachim de La Dehors fut enfermé au Châtelet puis transféré au For l'Évêque pour cause de maladie. Enfermé au Petit Châtelet avec ses complices, il fut de nouveau transféré au Grand Châtelet où il était encore détenu pour " certains crimes et délits " en 1491. Lesquels ? On l'ignore, mais ils devaient être assez graves pour justifier une telle durée d'emprisonnement.
Les Jurés et le Maire avaient aussi à juger des problèmes financiers : valets et étaliers réclamant le reliquat de leurs gages, fournisseurs désespérant du règlement de factures. Jean de Saint-Yon -un homonyme du Maître- fut exclu pour cette raison de la communauté en 1432.
Plus heureux, Pierre Sevestre ou Guillaume Thibert furent contraints de payer leurs dettes aux épiciers et aux fripiers. La sévérité était le prix à payer pour ne pas discréditer le Tribunal.
Les Jurés
Au nombre de quatre en 1381 les Jurés étaient des Maîtres de la Grande Boucherie de Paris élus pour un an. A l'expiration de leur mandat (art.7), le jour de la redistribution des étaux, ils désignaient quatre de leurs collègues qui, à leur tour, désignaient les maîtres qui allaient un an durant
tenir l'emploi de jurés; les quatre sortants "eulx memes ou d'autres selon ce que bon leur semble" (art. 15).Avec un tel mode électif, il n'y avait guère de chance pour quelqu'un n'appartenant pas à une grande famille de devenir juré..
Prêtant immédiatement serment les nouveaux élus étaient investis du pouvoir de police. Par police il faut comprendre, selon les légistes du XVIème siècle, non point seulement l'actuelle police judiciaire, mais " un exercice qui contient en soi tout ce qui est nécessaire pour la conservation et l'entretien des habitants et du bien public ... ".
La tâche était énorme : gestion financière, contrôle hygiénique, application des décisions judiciaires, respect des coutumes et surveillance des initiatives du Maître.

Les missions n'étaient pas sans risque et l'aide de trois écorcheurs assermentés sergents n'était pas superflue pour faire entendre raison à des artisans d'autant plus querelleurs et rancuniers qu'ils se savaient en faute.Ainsi, le 2 mars 1409, deux bouchers furent jetés dans les cachots de Saint-Germain "pour se qu'ils [avaient] été trouvez chargez et coulpables d'avoir esté de nuit avcaques plusieurs autres varlets bouchers [...] armez de bâtons ferrez espées et autres armeures pour vouloir battre [deux] sergens de Saint-Germain ou contents de ce qu'ils avaient est présens avecques Mons.
le Prévot […] à faire la visitacion des suifs […] faisant laquelle visitacion l' en avait fait plusieurs rebellions ... "
Cette pièce, il est vrai, se rapporte aux boucheries dépendant de l ' abbaye de Saint-Germain des Prés mais les oppositions, parfois violentes, étaient fréquentes dans tous les corps de métier.
Il fallait recourir à des mesures coercitives : lorsque les sergents de la Grande Boucherie se heurtaient à un refus d'obéissance en signifiant à un boucher condamné une interdiction d'exercer, ils prévenaient aussitôt les Jurés qui décidaient "d'envoier force de leurs escorcheurs et de leurs gens qui l'estal dudit [...] désobéissant, pourront geter jus et abattre terre; ou se il persévère, despécier le ou ardoir ou getter en l'eau"(art. 4).
Les Jurés mettaient leur point d'honneur à respecter l'esprit et la lettre du serment qu'ils prêtaient en entrant en fonction : "il garderont le mestier aux us et coustumes d' icellui et si mauvaise coustume y avait été alevée, i l'abattront et osteront a leur pouvoir et les bonnes garderont" (art. 16).
L'inspection sanitaire était l'une des plus importantes tâches dévolues aux Jurés. Les viandes devaient être irréprochables et '"Le bouchier qui [vendaitl mauvaise char était puniz de LX sous d'amende et de foirier [sera frappé d'interdiction de vente] huit jours ou XV (art. 12). "Les animaux et les carcasses n'étaient pas soumis une inspection systématique car les rédacteurs des statuts avaient jugé que le travail s'effectuant au vu et su de tout le monde, la fraude devenait difficile.
La délation était encouragée car "son voisin qui l'aura veu, se il ne l'en encuse, se il ne puet faire foy souffisans que riens n'en savait foirera selon le regart dessus dit".
La sanction était rude mais c'était ce prix que les Jurés maintenaient la discipline et la cohésion du métier et lui gardaient une bonne renommée.
Ne nous leurrons cependant point sur l'exemplarité de ces châtiments : les fraudes étaient certainement aussi fréquentes qu'à Saint-Germain des Prés ou Sainte-Geneviève dont les statuts contenaient un catalogue très fourni de pratiques formellement prohibées...
Si les Maîtres de l' Apport avaient toujours échoué dans leurs tentatives d'exercer un droit de regard sur tous leurs concurrents, et particulièrement les boucheries ecclésiastiques, l'article 41 leur reconnaissait le droit -étonnant- de perquisitionner chez tout parisien soupçonné de de livrer à l'exercice illégal du métier ... " Se aucun autre que lesdiz bouchiers tait trouvé faisant tuer ou vendant en son hostel ou ailleurs […] " l'usurpateur était incontinent jeté en prison et les chairs détruites.
En 1372 le Prévôt Hugues Aubriot étendit les tâches des Jurés à l'inspection des suifs "dont l'en fait ou pourrait faire chandelles", en les motivant par un intéressement aux amendes.
La principale duperie en matière de chandelles de suif consistait à mélanger la graisse de bœuf avec des graisses de diverses origines. Les statuts des chandeliers de suif interdisaient clairement ces pratiques :"Nul vallès chandellier ne puet faire chandoiles chez regratier [gegne petit, détaillant en alimentation ]à Paris pour ce que li regrattier mettent leur suif de tripes et leur remanans [reste] de leurs oins ".
Fagniez publia le compte rendu de l'interrogatoire d'un valet boucher de Saint-Germain qui n'est pas sans évoquer par sa saveur la farce de Maître Pathelin ..."Il estait en l'ostel de son maître avec [trois autres valets bouchers] et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des fondrilles de suif blanc qui le jour précédent avait esté fondu […]
auquel suif blanc: fut mis […]du saing fondu . Une appellée Philipote [belle fille du Maître boucher] ala en l'ostel de Jean Bisart en une court et leur dit haute voix par dessus un mur […] que l'on visitait le suif parmy les autres ostelz de la boucherie et que
ils fermassent les huys de l'ostel […] Tantost après eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud huys plusieurs coups dont l'un d'eulx, ne scet lequel, dist tels moz : je pense que vecy les visiteurs qui viennent. "
La gestion financière était aussi au nombre des attributions des Jurés.
Au terme de leur mandat ils devaient rendre compte de tous les émoluments, rentes, loyers et amendes qu'ils avaient perçues pour le métier ainsi que de toutes les sommes déboursées.
Mais l'exercice judiciaire réclamant des compétences trés particulière, qui ne pouvaient s'acquérir qu'après de longues années d'études, le Maître et les Jurés s'entourèrent d'un personnel dévoué - il s'agissait souvent de parents des Maîtres de la Boucherie - et compétent qui les assistait dans les démarches ou les procès dans lesquels le métier se trouvait impliqué.
Mise en commun des étals
La mise en commun des étaux n'était pas clairement énoncée dans le texte de 1381. Une partie des boutiques de la halle du Châtelet et des établissements annexes restait la propriété de particuliers puisqu'en 1385 Philippette de Saint Yon donna à son neveu deux étals, peut-être pour se conformer à la règle de l' hérédité par les mâles qui venait d'être instaurée ?.
Quoique imparfaitement respectée la mise en indivis des étals remontait aux débuts de la Grande Boucherie ... il faut se borner à rappeler ici les deux procès intentés en pure perte par Adam Harenc et le ménage Esselin et noter qu' en 1276 Jean Farone pour régler ses droits d' accession céda une bauve
La redistribution des étaux se faisait chaque année : le vendredi après la Saint-Jacques et la Saint-Christophe [25 juilletl 'les quatre jurez nouveaux [prenaient] tous les estaux en leur main" (art. 17).
Par ordre d' ancienneté dans le métier, le Maître Chef bénéficiant d'un droit de préemption, les maîtres défilaient pour énoncer leur choix. L'injustice de cette distribution, qui réservait les meilleurs étals et les profits les plus importants aux aînés, était amoindrie par de fortes disparités de loyer.
Les nouveaux fermiers s'empressaient de louer à un marchand étalier, l'ancien locataire ou un autre plus à leur convenance, percevaient tout ou partie de la nouvelle annuité et réglaient les frais aux Jurés. Sous peine d'amende et d'interdiction d'exercer, les locataires devaient régler le reliquat de l'annuité ancienne (art. 19).
La présence des Maîtres était obligatoire : nul ne pouvait "sauf se il n'a loyal essoigne" se dispenser d'assister la réunion sous peine de perdre ses privilèges pour un an.
La règle était appliquée avec plus ou moins de rigueur mais en 1594 treize absents non excusés et deux absents qui avaient fait parvenir des lettres d' explication aux Jurés furent condamnés : leurs étals furent repris par les Jurés et gérés au bénéfice du métier. Il est vrai que les événements de 1587, la création d'une communauté des étaliers, auraient dû inciter les maîtres à resserrer leurs rangs et donner l'exemple d'un collège uni, soucieux de faire respecter ses droits.
L'hérédité du métier
Les rédacteurs de l' article 23 étaient formels: "nul ne peut estre bouchier de la grant boucherie de Paris ne faire fait de bouchier ne de boucherie se il n'est fils de bouchier de ycelle boucherie". Cette règle était-elle au nombre des antiques coutumes ou n' était-elle qu'une innovation puisque Philippe de Saint-Yon dut s'y soumettre en 1391 ?
II semblerait que cette deuxième hypothèse soit avérée mais que ces usages, sous des formes quelque peu différentes, existaient dés le XIIIème siècle.
En effet si les statuts de 1182 restèrent muets à ce propos, en 1280 lors du procès qu'ils intentèrent aux Templiers, les bouchers évoquèrent l'usage de restreindre l'accession au métier aux fils de maîtres.
L'examen attentif des listes des maîtres présents aux assemblées permet de mettre en évidence un notable resserrement de l'éventail des patronymes. En 1260 sur vingt présents, quatorze appartenaient à douze familles différentes et six artisans étaient affublés de sobriquets ne permettant pas de préciser d'éventuels liens de parenté.Dés cette date il n'apparut plus de noms nouveaux, à l'exception de ceux des "bouchers créés" par le Roi à l'occasion de son avénement.
Certaines lignées s'éteignirent. En 1406, pour douze présents on ne retrouve que six patronymes dont trois sont ceux d'artisans de création récente. Cinquante ans plus tard, en 1458, les trente et un bouchers présents -il n'y avait qu'un seul absent- se répartissaient entre six familles dont quatre ne remontaient pas au delà de 1400.Enfin à partir du XVIème siècle quatre lignées seulement subsistèrent :
les Dauvergne et les Ladehors descendants de bouchers créés au XVème siécle, les Thibert et les Saint-Yon dont les ancêtres appartenaient à la Grande Boucherie avant le Xllème siècle.
Cette continuité est remarquable : en règle générale les lignées bourgeoises s'éteignaient rapidement car il existait un déficit des naissances et la population des villes ne se maintenait ou ne croissait que par un afflux de sang neuf venu des campagnes.

Pour s'établir Maître il fallait être fils de boucher né d'une union légitime. Les femmes ne pouvaient hériter ni transmettre le métier.
Une veuve sans enfant ne pouvait continuer le négoce du défunt dés que les viandes restées en sa possession étaient épuisées (art. 13). Cette misogynie provenait de la crainte de susciter des concurrents: un nouvel époux aurait pu, comme au bourg de Sainte-Geneviève, s'imposer dans la communauté par ce biais.
Les seigneurs de la Porte s' opposaient avec virulence à la " création " de bouchers car ceux-ci étaient souvent pourvus d' héritiers qui venaient prendre place dans les listes d'attente de la profession. Deux arrêts du Parlement furent nécessaires à Guillaume Haussecul pour exercer après avoir été créé et pour faire hériter son fils. Les Maîtres en place prétendirent que le jeune garçon ne pouvait exercer car il était né avant la création de son père.
La situation ne laissa pas d'être préoccupante : Louis XI créa six artisans tandis que ses prédcesseurs n'avaient créé que deux artisans à leur avènement, un la Monnaie et un à la Boucherie. Aussi les bouchers du Châtelet demandèrent-ils et obtinrent que les créations fussent limitées en nombre et dépourvues de tout caractère héréditaire.
Au quatorzième siécle les membres de la Boucherie "faisoient leurs enfants bouchers dés ce qu'ils n'avaient que sept ou huit ans, afin d' avoir grans drois et revenues sur ladicte boucherie" (lettre d'abolition Août 1416). Comme le nombre d' étaux était limité -trente deux dans la halle du Châtelet- et que le choix annuel s'effectuait par ancienneté, ces jeunes enfants devaient souvent attendre quelques années avant d'exercer.
Au XVème siècle ces garçons n'étaient plus astreints à se salir les mains au contact de la viande et se contentaient des revenus du fermage, comme leurs pères dont ils étaient les "hommes de paille". Le travail des enfants n'était pas totalement disparu puisque, tout au long du XVème siècle, les Jurés leur recommandèrent de bien observer les usages du métier et insistèrent auprès des parents pour qu'ils donnent une bonne formation à leurs fils.
A une époque plus reculée les petits maîtres exerçaient en personne leur négoce. Bien évidemment ils étaient incapables d' effectuer des travaux pénibles réclamant une force physique importante : la mise à mort des animaux ou la découpe des carcasses; mais ces tâches pouvaient être remplies par des valets leur solde ou plutôt à celle de leurs parents ou tuteurs.Les jeunes artisans pouvaient alors se consacrer des tâches compatibles avec leur maturité physique... ou intellectuelle : les enfants - apprentis ou jeunes bouchers - restaient joueurs, légers et volontiers fugueurs. Les rédacteurs des statuts de Charles VI reconnaissaient le fait mais ne l'expliquaient pas.
Cependant, il était notoire que certains éducateurs avaient la main très rude.
La réception
Au terme d'un apprentissage dont aucun texte ne précise la durée, le candidat jugé suffisant par ses aînés accédait la maîtrise. Il ne lui était pas demandé de réaliser un chef d'oeuvre. Cet usage était peu répandu : à l'époque d'Etienne Boileau seuls les Chapuiseurs, qui fabriquaient les charpentes en chêne des selles, avaient fait enregistrer la confection d'un chef d'œuvre dans leurs statuts.Le chef d' oeuvre se répandit surtout à partir de la fin du XIVéme siècle dans les métiers parisiens. Ce fut un expédient élégant et efficace pour réserver la maîtrise aux fils de maîtres; les jurés réclamaient la réalisation d'un travail coût
 eux ou difficile : les tondeurs de draps, par exemple, fournissaient une pièce de tissu si élimée, si souvent utilisée que le malheureux candidat nepouvait gratter la moindre bourre...
eux ou difficile : les tondeurs de draps, par exemple, fournissaient une pièce de tissu si élimée, si souvent utilisée que le malheureux candidat nepouvait gratter la moindre bourre...Le futur maître - ou ses parents lorsqu'il était trop jeune - devait acquitter certains droits et offrir un "past" et un "abreuvement" à divers personnages :
le Maître Chef et sa femme, le Prévôt et le Voyer de Paris, le Cellérier et le Concierge du Palais, le Prévôt de l'Evêque de Paris.
Le choix des bénéficiaires de ces largesses est significatif .Les deux Prévôts étaient les représentants des deux plus hautes autorités de la capitale:
le Roi et l'Evêque, et méritaient quelque considération ce titre. L'Evéque, de plus, était censitaire de la Grande Boucherie pour les places aux Bœufs et de l'Ecorcherie.
Le Voyer de Paris était une sorte d'ingénieur des ponts et chaussées dot de pouvoirs fiscaux : il réglementait, en concurrence avec le Prévôt des Marchands, l'emprise des étals sur la voie publique et en tirait bénéfice. La circulation devint trés difficile de ce fait dans les ruelles étroites
de la Porte et même dans les grandes artères.Les liens qui unissaient la Grande Boucherie au Cellérier et au Concierge du Palais sont plus délicats à expliquer. Ces deux officiers étaient-ils les héritiers de celui qui touchait 13 deniers selon les statuts de Philippe Auguste ? Rien ne vient étayer cette hypothèse et nous nous bornerons citer une ordonnance du régent Charles V en 1359 (ns, "nouveau style" : l'année débute le 1er janvier et non au printemps, en "avril"). L'article 8 préfigurait les articles 38 et 39 du règlement de 1381.
L'article 9 faisait état de relations entre le Concierge qui n'était rien de moins qu'un grand personnage et les écorcheurs : '"Et aussi s'il advenait que le dit Concierge voulait envoyer lettres à Gonesse pour faire venir bleds ou autre chose au grenier du Roy, les Escorcheurs de la
Boucherie de Paris les doivent porter ou envoier à leurs propres cousts et despens". Ces liens étaient très étroits : en 1415, Jean de Troyes, chirurgien et concierge du Palais, compromis avec les Cabochiens sera mis au nombre des bannis.
Les dépenses engagées par le candidat étaient importantes : le Prévôt de Paris recevait pour son "abeuvrement" un setier de vin, quatre gâteaux et une "maille" d'or qu'il faisait chercher par un serviteur en laissant deux deniers au jongleur du métier.
Pour le past, le Prévôt recevait "soixante et uns livres et un quarteron pesant de chair de porc et de buef, et un chapon et un setier de vin st quatre gasteaux de maille à maille et de ce pais son message qui vient querri ledit vin et les gasteaux, deux deniers au jugleur de la salle".
En versant un denier de pourboire au jongleur les autres bénéficiaires faisaient retirer leurs dons.

Seuls la Maître et la Maîtresse participaient réellement à la collation (l'abreuvement) et au repas (le past) qui se déroulait dans la salle supérieure de la halle du Châtelet.
D'après nos calculs, le nouveau maitre devait offrir, en nature, soixante quinze litres de vin, cent cinquante quatre livres de viande, vingt huit pains et vingt six gâteaux. A ces dépenses s'ajoutaient les frais d'achat de chandelles et torches qui éclairaient le Maître pendant les repas et le paiement de diverses "droictures" ...
En réalité, la dépense était bien plus importante, car les autres Maîtres devaient également être invités, comme cela se pratiquait dans d'autres jurandes: sans doute étaient ils ces "compaignons qui menjuent avec" le Maître (art. 30 à 32).
La maîtresse recevait aux deux repas "de chacun mès que l'on menjue, quatre mès, se se sont gelines, quatre gelines, et de touz les autres mès, de chacun mès quatre mès ... "(Art.31 & 33).
Dès lors, il est aisé de comprendre qu'un valet boucher si économme fut-il, ne pouvait supporter une telle charge et n'accédait jamais à la maîtrise. Quant aux fils de Maîtres, ils perdaient de si fortes sommes dans des réceptions qu'ils s'endettaient lourdement et devaient récupérer ces frais sur leurs étaliers.Rappelons que ces pratiques furent invoquées par Charles VI dans les lettres d'abolition de la Communauté : " faisoient à leur entrée grant solempnité de disners qu'ilz appeloient leur past […]toutes lesquelles choses estoient à la charge de nostre peuple st l'enchérissement des denrées. "
LA CONFRERIE DE LA BOUCHERIE
Les premiers siècles du Moyen-Age furent marqués par une intense ferveur religieuse. Nombreux furent ceux qui, à l'approche de la mort, donnèrent tout ou partie de leur fortune à des oeuvres pieuses ou philanthropiques, manifestant de façon éclatante leur dégoût pour une existence futile ou vouée à la recherche des biens terrestres haïssables.Chacun, riche ou pauvre, craignant les foudres divines donnait selon ses moyens : la très grande puissance foncière du clergé n'avait pas d'autre origine qu'une multitude de dons, parfois extrêmement modestes.
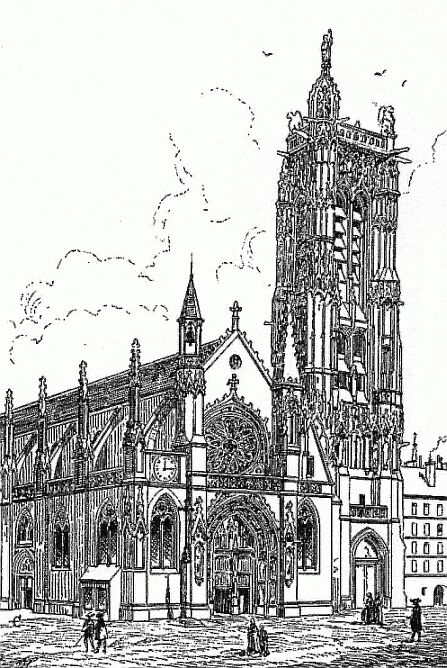
Un même zèle religieux poussa les artisans à se regrouper au sein de confréries qui constituèrent, avec le métier, une des deux facettes de la sociabilité professionnelle.
Les buts d'une confrérie étaient non lucratifs ; les membres se réunissaient pour pratiquer leurs dévotions : messes, prières aux défunts, cortèges funèbres; et la charité : création d'hôpitaux, de maladrerie, distribution d'aumônes ...
La plus grande confrérie parisienne, des "Prêtres et des Bourgeois de Notre-dame", et la confrérie des bouchers se distinguaient de leurs consœurs par le caractère non exclusif de recrutement de leurs membres : la Grande Confrérie Notre-Dame s'enorgueillissait de compter des princes dans son sein.
De même, les statuts de l'association des Maîtres de la Porte indiquaient "ils ["les bouchers) ont bonne volonté et vraye affection de créér ordonner et establir une aconfrérie en l'honneur de la Nativité Jhésus Christ en laquelle ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront devocion" .
Ainsi aprés avoir réglé les droits d'entrée et la cotisation annuelle tout boucher, écorcheur, satellite ou sympathisant de la Grande Boucherie pouvait participer aux réunions de la Confrérie ... ou préparer un complot.Ce qui explique qu'à trois reprises le pouvoir royal -sous les règnes de Philippe le Bel, Charles VI et durant la régence de Charles V- décida d'abolir les confréries pour "éviter moult de maux que par assemblée de gens sous ombre de confrérie soulent ensuivre. "
L'association créée par les artisans de l'Apport Paris était primitivement établie en l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Nous avons déjà signalé qu'en septembre 1406
"les bouchers de ce quartier se regardaient si fort au dessus des autres qu'ils avaient bâti une chapelle dans leur boucherie " et obtinrent de Charles VI l'autorisation d'y transférer leur lieu de culte.
Aprés la démolition de 1416 et la reconstruction sur une base plus restreinte les confrères retournèrent à leur premier lieu de culte dans la chapelle dédiée à Saint-Louis, d'où le nom de "Confrérie de la nativité de Nostre Seigneur aux Maîtres Bouchers de la ville en la chapelle Saint Louis" sous lequel leur association figure de 1426 à 1432 dans les comptes de Saint-Jacques.Les membres se réunissaient une fois l'an pour leur fête solennelle " chascun an une fois seulement, c'est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la feste de Noël
". Apres avoir célébré "une messe haulte belle et notable en l'honneur de la dicte nativité" les bouchers et leurs amis se rendaient dans la salle de fêtes de la halle puis dans un hôtel particulier après 1416 pour "disner ensemble et ordonner des faiz et besongnes appartenant à icelle confrérie".
Ce repas de corps - payé par les cotisations - prit de plus en plus d'importance et le vertueux religieux de Saint Denis déplorait dés le XVème sicle que fête chrétienne et agapes impies se mélangent.Les associations pieuses, et bien que les document n'en disent mot c'était certainement le cas ici, réservaient les reliefs du repas ou quelques portions pour les pauvres et les malades des hôpitaux.
Le profits de la Confrérie provenaient de trois sources : tout d'abord la récolte des dons, des legs ; ensuite la perception des droits d'entrée et des cotisations annuelles; enfin, le recouvrement des amendes frappant une absence à une messe, la négligence aux devoirs charitables . . .Les espèces ainsi recueillies étaient enfermées dans un coffre solide "pour mettre les aumonnes que les confrères d'icelle
Confrairie y vouldront donner et aumoaner pour l'acroissement du service divin en icelle chappelle et pour lad [ladite] confrairie soustenir, [les confrères] auront une
boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront mis estre tournez et convertiz es bienffaiz d'icelle confrairie par la main de certains prodommas dud. mestier d'icelle boucherie et non d'autre".Les prud'hommes dont il est question dans ce texte de septembre 1406 étaient élus chaque année par " Le Maistre jurez et Communauté de lad. grant Boucherie" ce qui trahit une certaine défiance à l'égard des confréres qui n'étaient point des collégues.
Les dépenses des confréries se répartissaient entre la repas, les messes et les oeuvres charitables parfois assise sur une rente, comme chez les drapiers de Paris car même dans ce Moyen-Age finissant la charité ne perdait pas encore tous ses droits ...
Les confréries et les métiers se cotisèrent pour offrir des verrières aux églises. La présence de ces groupements était au départ discrète : des armoiries, un instrument de métier rappelaient seuls l'identité des mécènes.
Ensuite le sujet profane devint de plus an plus important, empiètent sur l'espace sacré puis s'y substituant, la vitrail devenant quasiment une enseigne publicitaire ...

Portail offert par Nicolas Flamel et sa femme, représentés agenouillés sous la protection de deux saints, aux pieds de la Vierge et du Christ (en "C" dans la gravure précédente).
© grande-boucherie.chez.tiscali.fr
sources
http://grande-boucherie.chez-alice.fr/Communaute.htm
-

Le territoire boucher
"C'est une île de faible surface qui s'étend au milieu du fleuve, et un rempart circulaire l'entoure de partout ; on y accède par des ponts de bois à partir de chaque rive. Il est rare que le fleuve baisse ou déborde ; en général, hiver comme été le débit est le même, et il fournit une eau très agréable et très pure à voir comme à boire si on en a envie. De fait, comme on vit dans une île, c'est surtout au fleuve qu'on doit tirer l'eau..."
Julien, injustement surnommé l'Apostat, élu empereur par ses troupes dans l'Île de la Cité en Février 360.

Louis VI fit édifier, au débouché de la rue Saint-Denis devant le Grand Pont, un petit château en remplacement d'une grosse tour de bois qui avait défendu l'Île de la Cité contre les pillards danois. Remanié, agrandi par Louis IX au détriment des maisons particulières qui s'étaient regroupées sous sa protection, l'ouvrage militaire devint l'un des principaux verrous de Paris : le Grand Châtelet.
Devant sa façade nord, une petite place, simple élargissement de la patte d'oie terminant la rue Saint-Denis, rappelait par son nom, la "Porte de Paris", le temps où la poterne du Châtelet s'ouvrait sur une campagne peu fertile, un méandre mort de la Seine y ayant laissé des terres lourdes" marécageuses.
Plus tard, par le jeu des homophonies, la Porte devint l'Apport, allusion à un petit marché à la volaille et à la sauvagine qui s'y installa fort à l'étroit. Dans ces lieux s'installèrent les fondateurs de la Grande Boucherie de Paris entre la Seine, la rue Saint-Jacques et les rues Saint-Martin et Saint-Denis, principaux axes routiers de la capitale dès l'époque romaine.
L'établissement extra muros répondait à des considérations diverses tant hygiéniques que de commodité.
En premier lieu, comme l'écrivit Raoul de Presles dans sa traduction de la Cité de Dieu de Saint Augustin : "L'on faisoit et les boucheries, et les cimentières tout hors des dites pour les punaisies et les corrupcions eschiever".
Punaisie, du bas latin "putire" puer et "nasus" nez, signifie odeur et lieu puant. Cf. le petit insecte hémiptère piqueur qui, écrasé, laisse sourdre d'effroyables remugles d'alcool écossais : la punaise.
Ensuite, la présence d'un point d'eau, la Seine, facilitait l'abreuvement des bestiaux assoiffés par leur longue marche de la pâture jusqu'à la tuerie.
Enfin cette eau était indispensable au décrassage des écorcheries, au nettoyage des carcasses, des tripes et à l'évacuation des déchets ou des marchandises condamnées à être "ruées en fleuve" pour mauvaise qualité.
Cet îlot boucher établi dans un désert se retrouva rapidement noyé dans des habitations : la pression démographique rendait indispensable l'édification de nouveaux quartiers et, par conséquent, de nouvelles fortifications.
Devenu inutile le Châtelet fut transformé en prison et en siège de la Prévôté de Paris.Au sein du lieu "Le plus fétide et la plus encombré de Paris" il passait pour "après le gibet de Montfaucon, le monument le plus sinistre par sa physionomie et sa destination" : tribunal, siège d'institutions policières, lieu de torture, et prison ...
De nos jours il ne subsiste rien qui puisse rappeler les fastes, les splendeurs et les horreurs des environs du Grand Châtelet. Par politique, goût du lucre ou par vandalisme les prédécesseurs, émules ou séides d'Haussmann ont anéanti les vestiges d'un passé attachant.Aussi c'est par la seule imagination que le lecteur sera convié nous suivre dans une visite du "temple" de la viande au début du quinzième siècle.
Le Grand Châtelet et la Porte

A cette époque, trois voies étroites s' ouvraient devant le voyageurs pour atteindre la Seine depuis l'Apport-Paris.
Un passage voûté traversant du nord au sud l'ancienne forteresse, la rue de la Triperie à main gauche et la rue Pierre à Poisson à main droite. Cette dernière voie devait son nom l'existence de dalles sur lesquelles des étaliers proposaient toutes sortes de poissons d'eau douce pêchés en Seine ou achetés dans de lointaines provinces : Picardie, Champagne. Dans le "Livre des métiers", qu'il avait rédigé sur ordre de Saint-Louis, le Prévôt Boileau affirmait : '"L'on ne peut vendre à estal poissons d' eaue douce fors que la porte du grand pont, aux pierres le Roy et as Pierres Poissonniers".
Les poissons de mer, et le plus réputé d'entre eux le hareng, n'étaient pas soumis cette interdiction. Il faut dire qu'ils étaient généralement vendus salés, pour se conserver plus facilement.
Sous réserve que le salage ait lieu immédiatement après la pêche et non lorsque le poisson vire de l'œil, pour lui donner une fallacieuse deuxième jeunesse... La Cour et les grands bourgeois pouvaient consommer du poisson de mer apporté par des attelages de "Chasse marée".
"Harenc caqué soit mis en eaue fresche et laissié trois jours et trois nuis tremper en foison d'icelle eaue, et au bout de trois jours soit lavé et mis en autre eaue fresche deux jours tremper, et chascun jour changier son eaue deux fois. Et toutesvoies le menu et petit harenc veult moins tremper, et aussi est d'aucun harenc qui de sa nature veult moins tremper l'un que l'autre. Harenc sor.
L'en congnoist le bon à ce qu'il est meigre et a le dos espois, ront et vert; et l'autre est gras et jaune ou a le dos plat et sec." Extrait du "Ménagier de Paris".

Le colportage n'était pas interdit mais limité : les quantités mises en vente par le colporteur ne pouvaient excéder la charge supportable par un homme dans un panier reposant sur le ventre, maintenu par une lanière passant derrière la nuque: "et ce fut deffendu pour l'amour de ce qu'on vendait les poissons emblez les mors les pourriz es lieus forains ".
Entre "mi Avrille et mi Moi" les vendeurs de poissons, souvent simples locataires des bouchers, devaient fermer boutique : il convenait de protéger les géniteurs en période de frai. Les "pescheurs de l'eaue du Roy" devaient utiliser des filets au maillage conforme aux règlements.Faut-il voir dans ces mesures des considérations écologiques ou une illustration du principe médiéval du respect des coutumes et de la limitation des initiatives personnelles ?
Lorsque les auvents, de la paille ou le jet d'un seau d'eau plus ou moins propre s'avéraient insuffisants protéger les poissons de la corruption, ceux-ci étaient saisis au bénéfice des prisonniers du Châtelet ou des malheureux mendiants, orphelins, fous et malades de l'Hôtel Dieu.
A un stade trop avancé de putréfaction il fallait se résoudre à jeter les poissons dans le fleuve.
En poursuivant la descente de la rue des Pierres à Poisson les voyageurs débouchaient sur une petite place cernée de maisons encorbellement d'où s'échappaient des senteurs agréables qui masquaient, quelquefois difficilement, les relents de marée.
Cette place, qui après l'inondation de 1496 devint la "Vallée de Misère" puis se nomma "' Trop Va Qui Dure" était habitée par les cuisiniers. Les cuisiniers, ou "oyers" puisque ce palmipède était si apprécié qu'il leur valut ce nom, travaillaient dans de petites échoppes divisées en deux espaces différents. A l'arrière, dans "1'ouvroir", les artisans se livraient à la cuisson de leurs produits.A l'avant, la boutique donnait sur la rue par des ouvertures sans vitres, le verre étant une matière coûteuse, dotées de deux vantaux de bois. Le vantail supérieur servait d'auvent et le vantail inférieur tenait lieu d'étal.
Comme il n'existait aucune séparation entre boutique et ouvroir les chalands pouvaient regarder travailler les cuisiniers et ces derniers pouvaient interrompre leur ouvrage pour servir un client. Certains commerçants préféraient se tenir sur le pas de porte et discutaient avec un client éventuel, faisant l'article ou le dissuadant par leur "baratin" d'aller acheter chez un concurrent dont la viande serait de peu de valeur, étique, ou faisandée.
Etienne Boilleau rapporta les usages professionnels des cuisiniers. "Nuls ne puisse garder viande cuite jusqu'ea au tiers jour pour vendre ne acheter se elle n'est salée souffisamment bien". Les animaux, achetés à la boucherie du Châtelet, devaient être "bons, loyaux et souffisants pour mengier et pour vendre, et qu'ils aient bonne mouelle". Les jurés du métier devaient surveiller leurs confrères : il n'existait à cette époque aucune administration chargée de contrôler la qualité des marchandises.
La Seine, bien plus large que de nos jours, car elle n'avait pas subi de travaux de calibrage, offrait un spectacle extraordinaire aux passants.
Légèrement désaxé par rapport à la rue Saint-Denis, verrouillé au nord par le Grand Châtelet, le Grand Pont était l'un des deux ouvrages, avec le Pont Notre-Dame, qui franchissaient le bras nord du fleuve. D'abord construit en bois, ces ouvrages furent emportés par des crues et reconstruits en
pierre.Ils portaient une double haie de maisons de part et d'autre d'une étroite chaussée centrale, ce qui n'était pas pour faciliter les déplacements.
Dès 1141 des changeurs s'installèrent sur le Grand Pont puis l'ensemble de la profession dut s'y établir en 1305, par ordre de Philippe le Bel pour faciliter la surveillance des transactions monétaires ; le Grand Pont devint "Pont au Change". Mais d'autres corporations y tinrent boutiques :
lesbouchers de la Porte y possédèrent quelques étaux.
Un peu en aval, un spectacle plus curieux s'offrait aux badauds : le Pont aux Meuniers formait un mur de roues à aubes installées entre les arches de pierre, barrant quasi complètement la Seine à l'exception d'une petite portion restée libre, la "navière". D'autres moulins s'élevaient sur des pontons flottants amarrés à des pilotis ou aux arches des ouvrages d'art.
La circulation des bateaux sur la Seine était aussi délicate que celle des chariots dans le labyrinthe des étroites ruelles de la Cité.
Aussi, très tôt, autant pour protéger les ponts que les bateaux, les usages limitèrent le trafic fluvial. La Hanse des Marchands de l'Eau accapara peu à peu le monopole de la circulation des nefs et obligea les "forains" décharger en Grève ou s'associer un Parisien, un "français", pour traverser la capitale.
Face au Grand Pont s'ouvrait la rue Saint-Leufroy qui faisait suite au passage voûté percé sous le Châtelet. La rue devait son nom à une chapelle, simple dépendance de Saint-Germain l'Auxerrois, placée sous le patronage de Saint Lieufroy dont les reliques avaient été apportées de l' Eure
pour les soustraire aux Vikings.Une des maisons coincées entre le Châtelet et Saint-Leufroy se distinguait des autres habitations par ses sculptures de pignon qui l'avaient fait surnommer la Tête Noire. Jusqu'au XIVme siècle, l'élite des bourgeois parisiens se réunissait ici, jusqu'à l'achat de la Maison aux Piliers en place de Grève par le Prévôt des Marchands Etienne Marcel.
En empruntant la galerie du Châtelet les promeneurs retournaient sur la place de la Porte. A leur droite s'ouvrait une minuscule venelle, la ruelle de la Triperie (ou de "l'Araigne", c'est à dire le croc de boucher). La quasi-totalité des étaux possédés par les membres de la Grande Boucherie était rassemblée sous un même toit. L'aspect de ce bâtiment nous est mal connu : au cours des siècles il subit des amputations, des remaniements et un arasement en 1416, " rasée rez pied, rez terre ", en représailles de la collaboration des bouchers avec les anglo-bourguignons.
Le procès-verbal que dressa le Voyer de Paris avant la reconstruction de 1418 nous permet d'établir qu'au XVème siècle la base de la halle était un trapèze irrégulier, ce qui trahit le caractère composite de la construction formée par acquisitions successives.

Tout autour du bâtiment, et même sur la rue de la Triperie qui, avec ses quatre six mètres de large ne demandait certes pas être amputée, étaient installées de petites échoppes abritées par un auvent : les "bauves" louées à des oyers ou des regrattiers (petits revendeurs en comestibles).
En théorie, le Prévôt des Marchands devait veiller à ce que nul n'encombre les rues, mais il fermait les yeux, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes , selon le Livre du Châtelet de 1320 : " des estaulx mis parmy les rues dont il n'y a si petite poraière [vendeuse de poireaux] ne si petit mercier ne aultres quelconques qui mette son estal ou auvent sur rue qu'il ne recoive prouffit et si en sont les rues si empeschées que pour le grand prouffit que le Prévost des marchans en prent, que les gens ni les chevaulx ne pevent aler parmy les maistres rues".
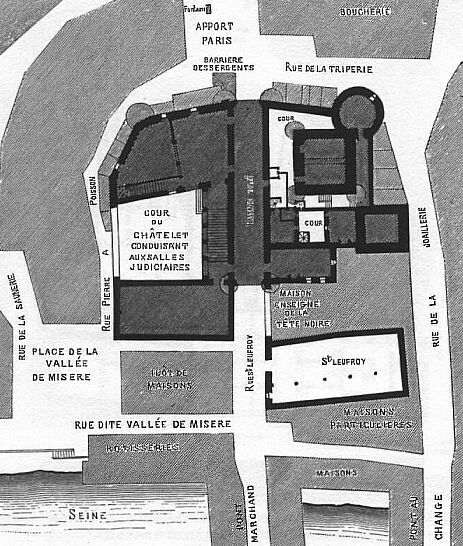
La Grande Boucherie comprenait trois niveaux. En premier lieu les caves où étaient entreposées des instruments, des détritus et même quelques pièces de vin de Bourgogne. Venait ensuite le rez-de-chaussée surélevé de trois ou quatre marches à l'ouest et l'est. Trente taux étaient disposées le long de deux allées se coupant à angle droit.
La lumière provenait de hautes baies dépourvues de vitres. L'éclairage artificiel était prohibé : il pouvait donner un faux aspect aux viandes.
Enfin, à l'étage était installée une salle des fêtes où les hommes de l'art pouvaient procéder aux élections, répartir les étaux et recevoir les nouveaux Maîtres. Une petite chapelle privée permettait le recueillement.Il a été évoqué plus haut les amputations qu'avait subi la Boucherie, aspect qui sera étudié plus amplement dans le chapitre historique. L'une des plus importantes fut en 1375 la destruction d'un "moult bel et notable hôtel" adossé à la Boucherie pour percer une rue neuve joignant la rue Saint-Jacques au Grand Pont. L'emplacement exact de cet "Hostel de l'Ange" encore appel "Four du Métier ou d'enfer" reste inconnu.

Ensuite en 1416, les bouchers ayant embrassé la cause bourguignonne, les Armagnacs rasèrent la halle et abolirent la confrérie. Les vaincus de la veille étant revenus au pouvoir en 1418, le mesures furent rapportées et les Maîtres de la Porte purent reconstruire une halle, un peu plus petite que l'ancienne d'où le transfert -ou le retour - du lieu de culte en l'église Saint-Jacques de la Boucherie.
L'Ecorcherie
Située à angle droit de la rue de la Triperie, troisième voie d'accès à la Seine depuis l'Apport Paris, la rue du Chef Saint Leufroy venait se terminer devant le Grand Pont, le Pont au Change. Elle marquait la limite occidentale du coeur de l'empire boucher : "l'Ecorcherie", qui se trouvait bornée, au nord par la rue Saint-Jacques menant à l'Eglise du même nom, à l'est par la rue "Planche Mibray" ( portion méridionale de l'actuelle rue Saint Martin) et au sud par les berges de la Seine.
Dans ce petit quadrilatère la toponymie reflétait la toute puissance des seigneurs de la Porte.
L'enseigne d'un cabaret fréquentée par les écorcheurs avait donné son nom à la rue "Pied de boeuf".Peut être Villon cite-t'il d'autres cabarets parisiens dans son Lais, à moins que le bœuf couronné, d'où l'on chasse les mouches ne soit qu'une carcasse décorée de feuillages :
Item, a Jehan Trouvé, boucher,
Laisse le Mouton franc et tendre,
Et ung tacon pour esmouchier
Le Beuf Couronné qu'on veult vendre,
Et la Vache, qui pourra prendre
Le vilain qui la trousse au col :
S'il ne la rend, qu'on le puist pendre
Et estrangler d'un bon licol !François Villon
Un marché donna son nom à la rue de la "Vieille place aux veaux" quelquefois nommée "place des Saint Yon" en l'honneur de la plus illustre dynastie des bouchers du Châtelet.*
Une rue de la "Tannerie" coupait en deux la venelle de la "Tuerie" plus tard appelée rue de l'Ecorcherie" puis de la "Lessive".*Une rue de ce quartier porta même le nom évocateur de"Merderet". Nom qui se retrouve sous une forme ou une autre dans de nombreuses villes françaises : Foireuse (Niort), Merdeux, Merdelet Merdusson, Merdrons (à Niort et Chartres ), Merdière (Lagny) ou plus gentiment Pipi (Châlons sur Marne).
Parfois c'est une petite rivière polluée parce que servant d'égout qui est appellée ainsi : Merderon, Merdereau, Merdanson, Merdaric, Merdron à Amiens, Auxerre, Beauvais, Le Mans, Noyon, Provins... (C.F. Leguay, Jean Pierre, -"La rue au moyen âge" Ouest France). Plus à l'Est du Châtelet, le ruisseau de Ménilmontant qui passait au pied de l'hôtel royal de Saint Pol était même surnommé le Grand Egout...
Quant au nom "Planche Mibray" , c'était une allusion aux planches qu'il fallait emprunter pour traverser la braie, c'est à dire la gadoue, ou pis la m...
Paris, il est vrai, n'était pas cette époque un haut lieu de l'hygiène publique. Non que l'on y appréciât la crasse : les bains publics abondaient dans des rues spécialement affectées à cet usage (une rue des Étuves Saint -Martin existe encore) ou en divers lieux jusque dans l'Ecorcherie.
Un texte du XIVème siècle nous apprend que le boucher Haussecul possédait "une maison […] séant à la rue de l'Ecorcherie de la Grande Boucherie, tenant d'une part la maison ou hôtel où sont les étuves aux femmes ... " La réputation de ces établissements était douteuse : les gens d'église fulminèrent contre ces étuves et, sous le règne de Louis XIII encore, un cordelier s'écria "n'allez pas aux étuves et n'y faites pas ce que vous savez ." Le mot anglais "stew", bain, désigne encore actuellement une maison close.
Dès que l'on quittait son logis, il fallait évoluer entre les détritus empilés devant les huis au mépris des ordonnances :
en 1465, les ordures accumulées porte Saint Denis et Saint Antoine permettront d'élever hâtivement des éléments défensifs à l'extérieur des fortifications... Le piéton devait garder un oeil sur le ciel et écouter le cri rituel "gare, gare, gare" : la légende prétend que Saint Louis, se rendant aux Cordeliers reçut le contenu du vase de nuit d'un pauvre étudiant.
Il fallait ranger au passage d'un troupeau , d'un chariot ou d'un cavalier qui projetait de la bouillasse jusqu'aux visages des piétons et laisser le "haut du pavé", cette portion de chaussée protégée par les encorbellements des maisons, à plus puissants que soi.
A diverses reprises, preuve d'incapacité, les rois ordonneront un pavage, un curage des fossés, et la réalisation d'égouts. Charles VI constata : "et sont les chemins des entrées des portes si mauvaiz et telement dommagiez, empiriez et affondrez, que à de tres grans perilz et paines l'on y peut admener des vivres et denrées pour le gouvernement de nostre peuple".
Théoriquement, chacun devait envoyer ses ordures hors les murs, mais en réalité les ordures étaient laissées sur place en comptant que les pluies et la force de gravité les emporteraient, ou que les cochons en feraient leurs choux gras. Le rabbin espagnol Maimonide considérait toutefois les porcs comme une source de pollution supplémentaire : "si la consommation du porc était permise, les rues et les maisons en seraient encore plus souillées, comme des latrines ou les fumiers, ainsi qu'on peut le voir en Gaule de nos jours".
Les ordures étaient jetées en Seine...ce qui n'empèchait pas les porteurs d'eau de se fournir en liquide dans le fleuve...
D'autres villes expérimentèrent des solutions ingénieuses : à St Omer, tout livreur de matériaux de constructions devait repartir avec un volume équivalent d'ordures! Des accords furent passés avec des paysans des environs pour qu'ils fument leurs champs avec les boues de ville.
Dans le quartier de la Porte, comme près des boucheries de Saint-Germain des Prés ou de Sainte-Geneviève, la situation était pire encore.
A tous les inconvénients que nous venons d'évoquer s'ajoutaient les matières fécales, les urines, les rognures et les morceaux de gras, ainsi que ce qu'il faut bien nommer des ruisseaux de sang s'écoulant dans les caniveaux en provenance des échaudoirs établis dans les rez-de-chaussée des boutiques.
La mauvaise hygiène favorisait la contagion en cas d'épidémie. Les puces et les rats pullulaient dans les villes encombrées d'ordures. Et certains germe, par exemple celui de la peste, survivent longtemps dans les cadavres contaminés.
Bien évidemment, la nappe phréatique ne pouvait pas longtemps supporter une telle charge de polluants et les puits ne délivrent pas de l'eau de source.
Plus effrayant encore, les portes de Paris pouvaient, en temps de guerre, s'orner de cadavres d'ennemis suppliciés. Quant au cimetière des Innocents, ses tombes peu profondes empuantissaient le voisinage et servaient de garde manger aux cochons de Saint Antoine, seuls autorisés à se promener librement dans Paris depuis 1131...
Tout animal errant pouvait être capturé : ainsi en 1418, le sinistre bourreau Capeluche reçut 25 sous pour avoir mené un porc à l'Hôtel Dieu.
Nous ne saurions terminer ce voyage imaginaire sans évoquer l'édifice qui donna son nom au quartier : l'église Saint-Jacques de la Boucherie, ainsi nommée car elle était située au début du chemin vers Compostelle.

De cette église fondée au Xème siècle agrandie au XIVème et au XVIème siècles, ne subsiste de nos jours qu'un clocher d'époque Renaissance quoique bâti dans le plus pur style gothique flamboyant. Le précédent clocher ayant été jugé indigne de la paroisse, la décision fut prise de le remplacer en 1501. Les travaux ne commencèrent toutefois qu'en 1508 pour finir en 1522.Ce clocher est tout ce que les révolutionnaires laissèrent debout, car la tour servit à fabriquer des plombs : on chauffait le métal au sommet de la tour et on le lançait dans le vide. Des grilles fractionnaient la masse en fusion et les gouttelettes finissaient leur course dans de grands bacs d'eau...
"Leur église, car c'est ainsi qu'on peut bien, en réalité, nommer l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, dont ils étaient les principaux et les plus nombreux paroissiens, a subi également, à diverses reprises, des changements, mais ce fut toujours pour agrandissement.
Aussi, on peut dire qu'elle a été en quelque sorte construite de pièces et de morceaux. La simple chapelle, élevée à sainte Anne vers 954, se trouve, en 119, devenue église paroissiale. Evidemment, on a dû singulièrement l'agrandir ; de 1119 à 1217, elle s'est encore augmentée. Dans le cours de l'année 1217, un acte fut donné par l'abbé de Saint-Maur, en décembre, qui permettait aux confrères de Saint-Jacques d'augmenter leur église, s'ils le jugeaient convenable.
L'abbé Vilain, dans son Essai historique sur cette église, a donné trois plans iconographiques indiquant les diverses modifications qu'elle a subies depuis le treizième siècle jusqu'à l'époque où il écrivait. L'on conçoit, dès lors, qu'en procédant ainsi par voie de réparations et d'adjonctions successives, on n'ait jamais pu faire de cette église un édifice remarquable. Aussi contenait-elle des piliers dits vieux et des neufs, des voûtes de style différent.
On y voyait des chapelles gothiques à côté de chapelles modernes. Comme la paroisse, quant il s'agissait de faire un agrandissement, n'était pas toujours disposée à voter la dépense nécessaire pour achat de terrain et pour frais de construction, on s'ingéniait beaucoup pour obtenir donation du terrain qu'on convoitait.Le nombre des donateurs qui ont contribué à embellir et agrandir cette église est assez considérable : les noms de la plupart sont parvenus jusqu'à nous.
Parmi ces donateurs, on doit citer Jacqueline la bourgeoise, teinturière, rue de Marivaux : en l'année 1380, elle laissa, par disposition testamentaire, 22 livres pour restaurer le chœur de l'église.
Marie Béraud, veuve d'Antoine Héron, et mère de Marie Héron, femme d'Abel de Sainte-Marthe, doyen de la Cour des aides, fonda, au profit de cette église, la dépense des toiles nécessaires pour l'ensevelissement des pauvres.
Vers le même temps, Jean Damiens et Jeanne Taillefer, sa femme, faisaient bâtir deux voûtes de bas côtés méridionaux : leurs armes, qui terminaient les nefs de ces deux voûtes, ne permettent pas de douter qu'il faille leur attribuer ce morceau de bâtiment qui renfermait alors une chapelle
" F. Rittiez, Notice historique sur la tour Saint Jacques de la Boucherie. 1856
Il était aussi d'usage d'enterrer les morts de qualité dans les chapelles privées, sous les vitraux représentant la vie professionnelle des confréries ou sous les dalles du chœur. Ceci n'allait pas sans quelques émanations fort peu angéliques.Mais, en contrepartie le clergé était assuré de la générosité des bourgeois qui quittaient cette vallée de misère. Le plus célèbre donateur de Saint-Jacques, Nicolas Flamel, y gagna une bonne renommée posthume (quoiqu'entachée du reproche d'alchimie, alors que sa richesse ne devait rien à la pierre philosophale mais provenait de l'usure et de la spéculation immobilière).
Divers métiers s'étaient fait attribuer des chapelles pour se livrer à leurs dévotions et pour y tenir les réunions de leurs confréries, ce qui n'était pas toujours du goût du clergé car les offices étaient quelquefois troublés.
Les bouchers avaient fait de même. En 1406, toutefois, " ils se regardaient si fort au-dessus des autres qu'ils avaient bâti une chapelle dans la boucherie. Ils exposèrent au Roy Charles VI qu'ils désiraient y établir une confrérie en l'honneur de la Nativité de notre Seigneur".
Cette confrérie "dont on sent assez par le choix du jour de cette fête l'allusion au boeuf qui estait en étable de Bethlehem, suivant l'idée des peintres" fit retour à la chapelle Saint-Louis après la destruction de 1416 .
Les bouchers du Châtelet et leurs satellites comptèrent parmi les membres influents de la paroisse. Certains devinrent marguilliers : ces laïcs étaient élus par "une assemblée d'environ 120 notables" (1432).Ou moins : une quarantaine au seizième siècle, car on prétexta qu'il fallait " éviter murmure et scandalles." Ils géraient les biens temporels de la paroisse. Parmi les listes de ces "marregliers de l'œuvre et fabrique"dressées par M. Meurgey, nous pouvons relever les noms de Bonnot, de Pierre Bonefille (Maître Chef) et d'Eudes de Saint Yon en 1270, puis ceux de Dauvergne, de Marcel ...
Les marguilliers surveillaient les dépenses de la paroisse : cens et rentes dues à d'autres paroisses ou à des particuliers, achats de bougies, d'huiles, de "chapeaux de roses vermeilles", frais de procès et de travaux d'embellissement ou d'agrandissement.
Les recettes provenaient de rentes ou de locations de biens : en 1315 la communauté des bouchers racheta, pour 10 livres parisis de rente, un étal et un cellier que la paroisse possédait dans la halle du Châtelet. Souvent, ces rentes avaient été données par des paroissiens en échange de l'établissement de messes perpétuelles : chaque mois un service était célébré à la mémoire de Simon de Saint Yon, deux obits (messe anniversaire pour le repos d'un mort) étalent instituées pour le repos de l'âme de Jean Bonefille.
La politique n'était pas absente de la vie de la paroisse. Jeanne Dupuis, veuve en premières noces de Nicolas Boulard, eut à subir les foudre du "parti des bouchers bourguignons qui dominoit alors dans la paroisse". Remariée à Jean de la Haye, elle suivit ce dernier dans sa fuite en 1419.Considérée comme responsable du non paiement des rentes assignes à la fondation de trois messes quotidiennes par son premier mari, la malheureuse vit ses biens saisis. Elle obtint en 1436 des lettres de rémission car elle était "de très grand âge, comme de soixante dix ans ou environ, fort débilitée" et put rentrer dans Paris, comme beaucoup de fugitifs de 1418. Puis elle mourut, en 1436 ayant récupéré ses biens grâce à la "réduction d'icelle ville en l'obéissance du Roy".
Puissance, brutalité, aspirations politiques et goût de la chicane n'est-ce pas, résumé en une anecdote, toute l'histoire de la Grande Boucherie de Paris ?
© grande-boucherie.chez.tiscali.fr
SOURCES
http://grande-boucherie.chez-alice.fr/Grand-Chaelet-Grande-Boucherie.htm
-

Hygiène, fraudes et inspection sanitaire
Dés sa naissance, sans aucun doute, le commerce engendra la fraude : des viticulteurs gaulois avisés de la Narbonnaise contrefaisaient adroitement les marques de négociants campaniens et paraient ainsi leurs piquettes du prestige des meilleurs crus italiens.
Le Moyen-Age connut lui aussi ses fraudeurs : les produits de la glyptique antique et tout particulièrement les " grylles ", ces figures grotesques composes d'une tête et d'une paire de jambes sulptées dans des camées étaient imités à la perfection par des artisans joailliers.
Les tapissiers "sarrazinois" cités par le Prévôt Etienne Boileau, imitaient au vu et su de tous les fleurons de la tapisserie arabe.

Les "regrattiers" mouillaient quelquefois leur lait, à leurs risques et périls... Les boulangers eux-mêmes n'étaient pas toujours très délicats : en 1316 tandis que la disette sévissait, seize artisans furent condamnés au pilori puis au bannissement du Royaume pour avoir mêlé des ordures à leurs farines ...Les bouchers de Paris ou d'autres villes recouraient quelquefois à des pratiques qui pouvaient porter préjudice à la santé des consommateurs, formellement interdites par les Ordonnances royales ou par les règlements des Communautés.
Le respect des bonnes coutumes était l'une des attributions du Maître Chef et des Jurés de la Grande Boucherie, en l'absence de tout service sanitaire officiel.
Les Inspections des tueries ou des étals semblent avoir été fréquentes, voire systématiques. Tous les bouchers étant installés dans un espace restreint : il était difficile un contrevenant de ne pas être trahi par un voisin jaloux ou craignant de devoir acquitter la taxe de non dénonciation ...
Bien évidemment les inspecteurs ne pouvaient durant leur travail faire appel à des notions de microbiologie ou de parasitologie.
Pas plus que les médecins de l'époque, ils ne savaient que les asticots étaient pondus par les mouches et pensaient qu'ils naissaient par génération spontanée. Ils étaient bien incapables de relier le ténia, grand ver parasite de l'intestin de l'homme, aux petits grains blancs dans la viande bovine, ses formes larvaires.
Cependant, si nos ancêtres du Moyen-Age ignoraient tout des agents infectieux, ils possédaient quelques idées sur le caractère nocif de certaines denrées, idées quelquefois entachées de considérations religieuses, superstitieuses.
Ou de conclusions hatives : si une épidémie de rougeole s'abat sur la France en 1411 et qu'une épizootie de clavelée ravage au même moment les troupeaux de moutons, avec des rougeurs comme symptômes communs, c'est que la maladie peut passer de l'homme à l'animal.
Ils avaient pu constater que certaines affections de l'animal pouvaient se transmettre à l'homme et que des mauvaises pratiques ou des erreurs de travail pouvaient faire rapidement "tourner" les viandes.
Le Prévôt de Paris interdira aux charcutiers de vendre "chair cuite, soit qu'elle soit en saucisses ou autrement, qui soit puante ou infectée, et non digne de manger à corps humain."
"Que chascun charcutier cuise les chairs qu'il cuira en vaisseaux [récipients] nets et bien écurés; et couvre les chairs, quant elles seront cuites, de nappes et linge blanc qui n'ait à rien servi depuis qu'il a été blanchi."
"Nul cuisinier, ne paticier, ne pourront tuer ne faire tuer nulle bestes, fors cochon de lait, pour ce qu'ilz ne sont pas cognoisseuans de maladies qui sont ès betes" ( Henry VI de France et d'Angleterre 1425, boucherie d'Evreux).
Inspection ante mortem
Les animaux devaient arriver sur leurs pieds jusqu'au lieu de l'abattage et de la découpe : ceci permettait d'empècher que des bouchers malhonnètes tuent discrètement des bêtes malades, voire qu'ils saignent une bête morte et ne les apportent ensuite à la découpe.
Les animaux destinés à l'abattage devaient être en parfaite santé ; à plus forte raison la préparation de viandes cadavériques était prohibée :
"nul bouchier ne pourra admener chars mortes pour escorchier ne vendre, ne aussi tuer aucune bête malade qui ne menguent [mangent] point qui ne soient voues par les jurez avant qu'ils les tuent" (Statuts de la Boucherie de Sainte-Geneviève 1381).
" Que nul bouchier ne soit si hardy de vendre chars à la porte, se elle n' a été vue estre vive de deux ou trois hommes qui le tesmoigneront par un serment convenable et souffisant, et non pourtant ne la povant-ils vendre tant que les Juréz l'aient veue et instituée à bonne" ( Le Mans, statuts de 1317).
Comme aujourd'hui, les personnes chargées de faire respecter l'hygiène alimentaire pouvaient décider de laisser consommer ou non un animal malade, en appréciant le risque pour le consommateur : "l'an de grace l305 […] fut arse [brûlée] une vache qui fut condampnée par les jurés et par le maire [...] pour ce que la dite vache n'estait pas souffisant et qu'elle avait été IIII jours en son hostel, que les piez ne pouvaient porter le cors ...
"
 Une exception notable : les porcs nourris avec les résidus de boulangerie, car ils étaient obèses. Ils pouvaient donc être amenés en chariot.
Une exception notable : les porcs nourris avec les résidus de boulangerie, car ils étaient obèses. Ils pouvaient donc être amenés en chariot. Mais ces animaux, qui permettent aux boulangers de gagner correctement leur vie, étaient moins recherchés que les porcs de banlieue ou de province nourris aux fruits des bois.
Une mention toute particulière était faite des bestiaux atteints du fil encore appellé fy ou loup, transmissible à l'être humain. A Sainte-Geneviève '"Nul boucher ne pourra tuer char pour vendre qui ait le fil sur peine d'être arses devant son huys, gectée aus champs ou en la rivière et de payer l'amende ".
Même prescription à Pontoise en 1403 "que toutes bêtes aumailles gouteuzes, mortes de loup ou fy courant ne doivent astre vendues en la dicte boucherie".
Cette maladie est mal identifiée, mais on peut raisonnablement penser qu'il s'agissait de la tuberculose.
Toute bête simplement suspecte étant détruite, ceci montre que les bouchers du Moyen Age étaient plus radicaux que nos services sanitaires actuels puisque, au début du XXème siècle, on assainissait certaines viandes en les cuisant à l'autoclave et que, actuellement, toutes les formes de tuberculose n'entrainent pas une saisie totale.
Du fait de son caractère de commensal de l'être humain, et de ses moeurs alimentaires assez répugnantes, le cochon semble avoir été soupçonné d'être à l'origine de maladies variées : "Nul bouchier […] ne pourra tuer char de porc qui ait est nourris en maison de huillier, de barbier, ne de maladrerie sur peine estre gectées aus champ ou en la rivière et de payer l'Amende (Sainte-Geneviève).Nous avouons ne pas comprendre l'ostracisme frappant les pourceaux élevés par les huiliers : leur chair était-elle désagréablement parfumée par les résidus da pression des amandes, des olives ou autres oléagineux ? Etait-elle huileuse ?
L'interdiction d'abattre des pourceaux vendus par des barbiers se comprend plus facilement : ces artisans soignaient des malades, effectuaient des saignées ou des amputations. L'horreur de l'anthropophagie, par cochon interposé, s'alliait à l'hygiène dans l'esprit des législateurs.
L' interdiction frappant les cochons nourris en maladrerie pose un problème. Peut-être voulait-on éviter tout contact entre individus sains et lépreux? La claustration des malades dans les léproseries ou "maladreries" n'avait pas d'autre but.
On confondait également sous le même vocable la "ladrerie" ou cysticercose porcine, affection parasitaire due à un ténia dépistée par les languiers et la "ladrerie" humaine, la lèpre infectieuse, quelquefois caractérisée par des formes noduleuses.
Cette hypothèse est confirmée par la lecture du "traité de Police", de Nicolas de La Mare et par divers textes antérieurs. Sous le règne de Charles VI, des "langoyeurs" institues par le Maître Chef se chargèrent d'inspecter les porcs pour dépister la ladrerie.
En 1517, on marquait les porcs ladres à l'oreille, et leur viande était "assainie" par quarante jours de salage, temps suffisant pour tuer les parasites. " Les porcs dont les chairs ne sont encore que sursemées de quelques grains de ladrerie peuvent être ramendez. Si les chairs ne sont pas encore corrompues, le sel peut en corriger la malignité, on peut ensuite en user sans péril.
La chair de porc sursemée sera mise au sel pendant quarante jours puis vendue dans un coin particulier des Halles, [marqué] par un poteau et un drapeau blanc" ( in traité de police de Delamare, 1729). De nos jours, on serait plutôt tenté de recourir à la congélation, s'il n'y a pas trop de kystes répugnants.
Les porcs les plus atteints étaient amputés d'une oreille et leur viande n'était pas destinée à la vente en boucherie. Elle devait être ruée en Seine, mais sous Louis XI, on la juge assez bonne pour les prisonniers du Châtelet. Ou bien, on pouvait la donner aux lèpreux, puisqu'ils étaient déjà infectés.
La viande des femelles en activité sexuelle n'était pas utilisée.
"Sa il y a quelque vache qui requière le toreau ou qui y ait esté de nouvel, ou qui ait de nouvel veellé [...] une truie qui est en ruit ou qui a nouveau cochonné il esconvient qu'elle soit résidiée de 3 sepmaines et 3 jours avant qu'elle soit disirée de vendre" (Pontoise 1403).Sans doute les considérations hygiéniques (risque de microbisme post-partum) ne pesaient-elles pas lourd devant le dégoût de la sexualité.
Les animaux trop jeunes n' étaient pas abattus : "nul bouchier ne pourra tuer ne vendre char de lait, se elle n'a plus de 15 jours" (Sainte-Geneviève).
"Le veau ne doit étre vendu en ladicte Boucherie se il ne a XVII jours frans, et si ne doit estre plus hault de une nuit en sa pel et n'en doit on oster quelque membre jusques a se que la pel en soit toute hors" (Pontoise).
Les jurés ne méconnaissaient pas la maturation des viandes, absolument nécessaire à son attendrissement : "On ne pourra […] exposer nulles chars chaudes et nouvelles tuées jusques à ce qu'elles soient refroidies bien…"
(Henry VI, roi de France et d'Angleterre, 1426, boucherie d'Evreux).
Il fallait plutôt craindre la trop grande maturation ou la putréfaction des viandes, puisqu'il n'existait aucune méthode correcte de longue conservation des aliments, si ce n'était le salage et l'entreposage dans des pièces fraîches, parcourues par des courants d'air perpétuels. Ceci étant, les bouchers pouvaient et devaient ajuster la quantité de bêtes abattues aux consommations estimées.
A Saint-Médard, nul boucher ne pouvait "ne par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, au jour dont l'en ne mengera point de char l'endemain..." Idem à Sainte geneviève.
Il était aussi interdit de tuer des animaux dans les derniers jours du Charnage et à plus forte raison dans le Carème, sauf pour les malades.
Le Prévôt ordonna en 1391 de brûler "toute char fresche [non salée] gardée du jeudi au dimenche et tout rost aussi gardé…" Au total, il semble que les viandes devaient être consommées dans les deux jours suivant l'abattage.Donc, la légende d'un cuisinier du Moyen Age camouflant l'odeur des viandes putrides sous une tonne d'épices est totalement controuvée.
Nous ne saurons malheureusement jamais de quelle façon se comportaient les artisans de la Porte lorsqu'ils découvraient un kyste hépatique, un abcés pulmonaire ou des arthrites non décelées à l'inspection ante mortem.
Paraient-ils largement la pièce de découpe surtout lorsque l'aspect des lésions était trop répugnant ? Se contentaient-ils d'ôter les formations suspectes et maquillaient-ils les défauts de leurs viandes ? II semble que ce fut parfois le cas, car le Prévôt de Paris dut leur interdire de laisser brûler des chandelles autour des étaux aprés sept ou huit heures, selon la saison :les bouchers "presque tout au long du jour avoient et tenoient grands foisons de chandelles allumées en chascuns leurs étaux.
Par quoi leurs chairs, qui étoient moins loyales et marchandes, jaunes, corrompues et flétries, sembloient aux acheteurs très blanches et fraîches sous la lueur d'icelles chandelles." Le travail de nuit était interdit à tous les métiers, sauf exception : par exemple les armuriers, pour une commande urgente et vitale....
Ainsi, les autorités réclamaient des bouchers qu'ils vendissent "de bonnes chars et loiaux et marchandes". Ce n'était pas toujours le cas mais, comme aujourd'hui dans les pays ou les classes sociales défavorisés, les chalands se souciaient souvent plus de manger que de la qualité de la nourriture.Il semble que dans certaines villes du Midi, les animaux malades ou accidentés étaient interdits de commercialisation dans le circuit des boucheries traditionnelles, mais qu'elles pouvaient être vendues dans des boucheries de deuxième rang. Dès lors, il y avait un marché à deux vitesse :
les gens aisés pouvaient faire acheter de la viande réputée saine au "mazel" et les pauvres se rendaient à la "bocaria" pour acheter de la viande malsaine, en toute connaissance de cause.

Les ordures, boues et effluents
Au terme de ce chapitre consacré à l'inspection sanitaire nous désirons évoquer le délicat problème des effluents.
Nous avions rappelé dans le premier chapitre la déplorable situation dans laquelle se trouvait Paris au Moyen-Age : aucun égout digne de ce nom, des rues boueuses remplies d'immondices, des puits contaminés par des fosses à déjections à l'étanchéité sciemment déficiente.
Sciemment, car la vidange d'une fosse par les Maîtres "Fy Fy " coûtait cher au propriétaire, alors que si l'on disjoignait discrètement quelques moellons de maçonnerie, on pouvait espacer les curages…
"Chacun laisse boues fientes et ordures devant son huis, au grand grief des créatures humaines" (Ordonnance de 1388). La situation était des plus catastrophique encore près des tueries et des boucheries : les urines, les fientes, le sang des bêtes écorchées, le contenu des viscères, les sérosités empruntaient des rigoles creusées dans le sol des ateliers, coulaient dans les rues et stagnaient dans les caniveaux.Les bouchers de Sainte-Geneviève eurent à soutenir les attaques de l'Université qui réclama, longtemps en vain, le respect de la loi : les ordures devaient être transportées hors de la capitale et répandues dans des champs, loin des cours d'eaux ou des voiries.
Une ordonnance royale, en 1353, dut interdire le rejet des immondices sur la voie publique et le comblement des fosses :
"Nul ne pourra avoir ezvier ne agout par lequel il puisse laissier couler sang […] ne autre punaisie se ce n'est eaue qui ne sente aucune corruption. "
"Nul bouchier ne pourra avoir ne tenir fosse, et celles qui a présent sont, seront emplies dedans la mi août prochain venant, aux dépens et frais de seulz qui les ont ... "En 1366 un arrêt du Parlement constatant l'inefficacité de ces mesures exila les bouchers de Sainte-Geneviève en dehors de Paris :
"Seront tenuz de tuer […] sanz laissier aller ne getter les ordures de leurs escorcheries, excepté que les fanz et laveures qui pevent passer par uns plataine de fer [trémie] percée tros mesnuz du gros d'un petit doigt d'un homme ..."

Les bouchers d'Amiens connurent les mêmes difficultés en 1281 (ordonnance du 1er avril) : " Il est interdit aux bouchers d'écorcher leurs moutons, veaux, agneaux, pourceaux et autres menus bétails dans leurs maisons ou devant leurs étals, car le sang, les boyaux et la fiente des entrailles de ceux-ci sont jetés et coulent depuis leurs maisons et leurs étaux dans la rue ce qui corrompt l'air, rend malade les hommes, et fait souffrir les passants à cause de cette abomination.
Il est donc ordonné aux bouchers de tuer les animaux à l'écorcherie. Ils pourront toutefois tuer des animaux chez eux à condition qu'ils recueillent le sang et les ordures dans des récipients qu'ils iront ensuite porter à l'écorcherie "..
Leurs collègues du Châtelet ne subirent pas le même sort car ils étaient installés dans une enclave industrielle dont tous les habitants tiraient leurs revenus du travail de la viande et des cuirs : bouchers, écorcheurs, tanneurs, tripiers ... Ils purent dont, à loisir, empuantir le voisinage et souiller les rives de Seine en amont du Louvre.
L'abolition de la Communauté en 1416 devait s'accompagner d'un transfert de la tuerie dans un terrain de l'Ouest parisien "prés ou environ des Tuileries Saint-Honoré qui sont sur ladicte riviére de Seine, oultre les fossez du chasteau de bois du Lovre".
Cette excellente mesure fut hélas rapportée "et l'eaue de la riviére de Seine [resta] corrompue et infecte par le sang et autres immondices desdites bestes qui descendait et que l'en gectoit en ladite rivière de Seine ..."
Peut être les autorités parisiennes auraient elles pu s'inspirer d'une mesure radicale des échevins d'Amiens en 1413 :
" Tout animal découvert en train de divaguer, sera amputé d'une patte la première fois, d'une seconde patte en cas de récidive puis livré au bourreau si le propriétaire n'a pas encore compris. "
Mesure jamais appliquée ; en 1454 il faudra rappeler : " Parce que plusieurs inconvénients peuvent naître à cause du fait que plusieurs personnes demeurant en la dite ville entre les quatre portes, nourrissent des pourceaux dans leur maison, celliers, ou d'autres lieux et que ces bêtes sont sales, corrompent l'air à cause de leurs odeurs, ce qui pourrait rendre dangereusement malade des gens, ces messieurs de la ville ont fait crier et ordonner que personne ne nourrisse des pourceaux entre les quatre portes de la dite ville. "
Précisons toutefois, à 1'intention des beaux esprits et persifleurs, prompts se moquer de nos lointains ancètres que l'on ne cessa qu'en 1849 d'épandre les ordures à Montfaucon et que la capitale ne fut dotée qu'en 1894 d'un réseau de tout-à-l'égout au terme d'une bataille épique ou s'illustrèrent médecins et ingénieurs des Ponts et Chaussées...

La fameuse truie de Falaise. Elle fut condamnée à mort pour avoir dévoré un jeune enfant.
sources
http://grande-boucherie.chez-alice.fr/Hygiene-fraudes.htm
Les Jurés
Au nombre de quatre en 1381 les Jurés étaient des Maîtres de la Grande Boucherie de Paris élus pour un an. A l'expiration de leur mandat (art.7), le jour de la redistribution des étaux, ils désignaient quatre de leurs collègues qui, à leur tour, désignaient les maîtres qui allaient un an durant
tenir l'emploi de jurés; les quatre sortants "eulx memes ou d'autres selon ce que bon leur semble" (art. 15). Avec un tel mode électif, il n'y avait guère de chance pour quelqu'un n'appartenant pas à une grande famille de devenir juré..Prêtant immédiatement serment les nouveaux élus étaient investis du pouvoir de police. Par police il faut comprendre, selon les légistes du XVIème siècle, non point seulement l'actuelle police judiciaire, mais " un exercice qui contient en soi tout ce qui est nécessaire pour la conservation et l'entretien des habitants et du bien public ... ".
La tâche était énorme : gestion financière, contrôle hygiénique, application des décisions judiciaires, respect des coutumes et surveillance des initiatives du Maître.

Les missions n'étaient pas sans risque et l'aide de trois écorcheurs assermentés sergents n'était pas superflue pour faire entendre raison à des artisans d'autant plus querelleurs et rancuniers qu'ils se savaient en faute.Ainsi, le 2 mars 1409, deux bouchers furent jetés dans les cachots de Saint-Germain "pour se qu'ils [avaient] été trouvez chargez et coulpables d'avoir esté de nuit avcaques plusieurs autres varlets bouchers [...] armez de bâtons ferrez espées et autres armeures pour vouloir battre [deux] sergens de Saint-Germain ou contents de ce qu'ils avaient est présens avecques Mons. le Prévot […] à faire la visitacion des suifs […] faisant laquelle visitacion l' en avait fait plusieurs rebellions ... "
Cette pièce, il est vrai, se rapporte aux boucheries dépendant de l ' abbaye de Saint-Germain des Prés mais les oppositions, parfois violentes, étaient fréquentes dans tous les corps de métier.
Il fallait recourir à des mesures coercitives : lorsque les sergents de la Grande Boucherie se heurtaient à un refus d'obéissance en signifiant à un boucher condamné une interdiction d'exercer, ils prévenaient aussitôt les Jurés qui décidaient "d'envoier force de leurs escorcheurs et de leurs gens qui l'estal dudit [...] désobéissant, pourront geter jus et abattre terre; ou se il persévère, despécier le ou ardoir ou getter en l'eau"(art. 4).
Les Jurés mettaient leur point d'honneur à respecter l'esprit et la lettre du serment qu'ils prêtaient en entrant en fonction : "il garderont le mestier aux us et coustumes d' icellui et si mauvaise coustume y avait été alevée, i l'abattront et osteront a leur pouvoir et les bonnes garderont" (art. 16).
L'inspection sanitaire était l'une des plus importantes tâches dévolues aux Jurés. Les viandes devaient être irréprochables et '"Le bouchier qui [vendaitl mauvaise char était puniz de LX sous d'amende et de foirier [sera frappé d'interdiction de vente] huit jours ou XV (art. 12). "Les animaux et les carcasses n'étaient pas soumis une inspection systématique car les rédacteurs des statuts avaient jugé que le travail s'effectuant au vu et su de tout le monde, la fraude devenait difficile.
La délation était encouragée car "son voisin qui l'aura veu, se il ne l'en encuse, se il ne puet faire foy souffisans que riens n'en savait foirera selon le regart dessus dit".
La sanction était rude mais c'était ce prix que les Jurés maintenaient la discipline et la cohésion du métier et lui gardaient une bonne renommée.
Ne nous leurrons cependant point sur l'exemplarité de ces châtiments : les fraudes étaient certainement aussi fréquentes qu'à Saint-Germain des Prés ou Sainte-Geneviève dont les statuts contenaient un catalogue très fourni de pratiques formellement prohibées...
Si les Maîtres de l' Apport avaient toujours échoué dans leurs tentatives d'exercer un droit de regard sur tous leurs concurrents, et particulièrement les boucheries ecclésiastiques, l'article 41 leur reconnaissait le droit -étonnant- de perquisitionner chez tout parisien soupçonné de de livrer à l'exercice illégal du métier ... "Se aucun autre que lesdiz bouchiers tait trouvé faisant tuer ou vendant en son hostel ou ailleurs […] " l'usurpateur était incontinent jeté en prison et les chairs détruites.

En 1372 le Prévôt Hugues Aubriot étendit les tâches des Jurés à l'inspection des suifs "dont l'en fait ou pourrait faire chandelles", en les motivant par un intéressement aux amendes.
La principale duperie en matière de chandelles de suif consistait à mélanger la graisse de bœuf avec des graisses de diverses origines. Les statuts des chandeliers de suif interdisaient clairement ces pratiques :
"Nul vallès chandellier ne puet faire chandoiles chez regratier [gegne petit, détaillant en alimentation ]à Paris pour ce que li regrattier mettent leur suif de tripes et leur remanans [reste] de leurs oins ".
Fagniez publia le compte rendu de l'interrogatoire d'un valet boucher de Saint-Germain qui n'est pas sans évoquer par sa saveur la farce de Maître Pathelin ...
"Il estait en l'ostel de son maître avec [trois autres valets bouchers] et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des fondrilles de suif blanc qui le jour précédent avait esté fondu […] auquel suif blanc: fut mis […]
du saing fondu . Une appellée Philipote [belle fille du Maître boucher] ala en l'ostel de Jean Bisart en une court et leur dit haute voix par dessus un mur […] que l'on visitait le suif parmy les autres ostelz de la boucherie et que
ils fermassent les huys de l'ostel […] Tantost après eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud huys plusieurs coups dont l'un d'eulx, ne scet lequel, dist tels moz : je pense que vecy les visiteurs qui viennent. "
La gestion financière était aussi au nombre des attributions des Jurés. Au terme de leur mandat ils devaient rendre compte de tous les émoluments, rentes, loyers et amendes qu'ils avaient perçues pour le pour le métier ainsi que de toutes les sommes déboursées.
Mais l'exercice judiciaire réclamant des compétences trés particulière, qui ne pouvaient s'acquérir qu'après de longues années d'études, le Maître et les Jurés s'entourèrent d'un personnel dévoué - il s'agissait souvent de parents des Maîtres de la Boucherie - et compétent qui les assistait dans les démarches ou les procès dans lesquels le métier se trouvait impliqué.
-

Il fut un temps ou les épices étaient aussi rares et chers que l'or. Arabes, Vénitiens, Portugais, Hollandais Tous ont voulu contrôler la route des Indes et dominer le fructueux commerce des épices. (Mars 2004)
Qu'est-ce qu'une épice ?
Le mot "épice" (du latin "species" qui signifie "substance"), apparu à la fin du XIIème siècle, désigne une substance aromatique d'origine végétale.Les épices sont originaires pour la plupart des régions tropicales d'Asie (Inde, Indonésie, Asie du sud-est) et d'Amérique (Mexique, Pérou, Antilles).
Les épices ne constituent pas une famille botanique en tant que telle et proviennent de différentes parties de plantes : le gingembre et le curcuma sont des rhizomes ; la cannelle est une écorce ; le clou de girofle est un bourgeon ; le safran est une fleur ; le poivre et la coriandre sont des fruits ; la noix de muscade et la moutarde sont des graines...

La route de la soie suivait le même parcours que la route des épices
Sur la route des épices
Dans l'Antiquité, en Mésopotamie, les Assyriens et Babyloniens utilisaient déjà des épices dans la nourriture, en médecine et en parfumerie. Le commerce des épices était alors comparable en importance à celui de l'or ou des pierres précieuses. Les Egyptiens se servaient aussi des épices pour embaumer les morts, confectionner des parfums et des onguents.Ce sont les marchands arabes qui, les premiers, ont rapporté des épices de Chine et d'Inde vers l'Occident. Alliés aux Vénitiens, ils bâtissent une puissante marine qui leur assure un rôle influent en Méditerranée.
A partir du XVème siècle, les navigateurs portugais, à la suite de Vasco de Gama, franchissent le cap de Bonne-Espérance et se lancent pour eux-mêmes dans ce fructueux commerce.

La route des épices est alors contrôlé à l'est par les Arabes et au sud par les Portugais. Christophe Colomb convainc la couronne d'Espagne de tenter sa chance par... l'ouest. Et, bien qu'ils n'arrivent pas aux Indes, ils découvrent l'Amérique, un autre continent riche en épices.
Au XVIIème siècle, c'est au tour des marchands hollandais et anglais de se lancer dans le commerce des épices en créant des compagnies et des comptoirs sur les côtes asiatiques.
En 1654, les Français s'installent aux Indes avec la création par Colbert de la Compagnie des Indes Orientales. Plus tard, ils développent la culture des épices dans leurs colonies de la mer des Antilles (Guadeloupe, Martinique) et de l'océan Indien (Madagascar, La Réunion, Maurice).
A la fin du XVIIIème siècle, les Anglais dominent le marché des épices, alors que leurs cours sont en baisse.
Aux XIXème siècle, la culture des épices s'est très largement étendue. L'Indonésie, restent un fournisseur important, mais est supplantée sur le marché international par l'Amérique latine.

De nos jours, les épices sont devenues de banals ingrédients de l'art culinaire. Aujourd'hui en France, l'épice la plus consommée est le poivre (86 000 quintaux importés par an), suivi par le gingembre, le safran et le curcuma (63 000 quintaux environ chacun), les piments (28 000 quintaux), la cannelle et la muscade (8 000 quintaux environ chacun), le girofle (6 000) et la vanille (4 000).

SOURCES
http://cuisine.journaldesfemmes.com/magazine/dossier/0403epices/histoire.shtml

Les épices étaient très rares au Moyen Age, elles étaient tellement rares qu’elle coutaient plus cher que... l’or (qui était déjà très cher à l’époque) !!! Elles ont joué un rôle important dans l’histoire culinaire, culturelle voire scientifique.

De la Grèce antique, jusqu’aux débuts des temps modernes, la route des Épices est aussi celle de la Soie : elle part de Chine, traverse l’Asie pour atteindre l’Europe.
Tout au long de cette route terrestre, entre l’Orient et l’Occident, les riches marchands gardent le contrôle des échanges commerciaux : de la soie contre des épices, des épices contre des bijoux, des fourrures, des couvertures de laine ou de la vaisselle de luxe.
Les épices fascinent par leurs parfums, leurs saveurs et leurs vertus médicinales. On disait même qu’elles avaient des pouvoirs magiques ! C’est au Moyen Age que se développe une véritable folie pour les épices : poivres, girofle, cannelle, muscade et macis, gingembre, cardamome, safran, sumac, galanga…
Les marchands racontent sur elles des récits fabuleux : la graine de paradis n’est-elle pas pêchée aux filets dans les eaux du Nil (qui prend sa source au jardin d’Eden !). Quant à la cannelle, ce sont les brindilles des nids de gros oiseaux carnivores. Ces histoires étranges entretiennent la curiosité des clients fortunés qui veulent absolument posséder des épices.
Les riches seigneurs disposaient des épices sur la table lors des grands banquets pour montrer leurs richesses.
En bref, les épices étaient très importantes au Moyen Age.
Par Léo, 5e 1.http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/spip.php?page=article&id_article=1437
Soiries et épices sont les principales marchandises que trafiquaient les Polo et les commerçants occidentaux. D'une grande valeur sous un faible poids, les marchandises étaient revendues plusieurs fois leur prix d'achat en Orient. Les plus pauvres occidentaux se contentaient d'herbes locales ou de poivre. Les couches supérieures de la société recherchaient les épices les plus exotiques et les plus chères . Snobisme oblige. Ainsi s'explique la vogue du poivre long, plus rare que le poivre normal, jusqu'à ce que l'on découvre sa provenance réelle, puis que le piment américain apparaisse sur les tables et le remplace.
Dès l'empire romain, les Arabes s'emparèrent du commerce des épices car leurs pays étaient des intermédiaires obligés entre le monde méditerrannéen et le Sud-Est asiatique. Les marchands occidentaux, coupés des sources d'approvisionnement propageaient ils des légendes sur ces épices, involontairement ou sciemment : leurs produits n'en paraissaient quye plus désirables.
Ainsi le poivre noir ne doit pas sa couleur au sèchage et à la fermentation mais au feu que les récolteurs doivent périodiquement mettre à la forêt où il pousse, pour en chasser les serpents mortels qui l'infestent. Telle est du moins l'opinion d'un savant du XVIème siècle, Bartholomeus l'Anglais.
Pour Joinville, historien et sénéchal de Saint Louis qui avait accompagné son maître en Croisade en Egypte, il était avéré que les épices - gingembre,
rhubarbe, cannelle et aloes- étaient pêchées dans le Nil, avec des filets, après qu'elles soient tombées du Paradis...On sait désormais que ce n'est pas vrai : la rhubarbe asiatique a désormais envahi nos jardins et tout restaurant chinois propose du gingembre confit.Seule la Maniguette a garda longtemps de son aura, puisque cette épice africaine s'appelle encore "graine de Paradis"...

Décrits par Marco Polo, les Cynocéphales sont les indigènes des iles Adaman, dans l'Océan Indien. Quoi que dotés d'un aspect peu amène, ces hommes-chiens sont bien plus civilisés que les Sciapodes, Blemmies et autres Cyclopes qui habitent la lointaine Sibérie, ou les idolâtres anthropophages de Java la mineure (Sumatra). Ils se livrent à la récolte et au commerce des épices qui traverseront la moitié du globe pour venir sur les tables parisiennes.
Petit somme réparateur sur un sac d'écorce de Cannellier. Pour les hommes du Moyen Age, qui révèrent les textes de l'Antiquité, la cannelle est une épice trouvée dans le nids de divers oiseaux, dont le fabuleux phoenix, cet animal qui renait de ses cendres.
© grande-boucherie.chez.tiscali.fr
-

Les femmes artistes du Moyen âge ...à l'enluminure ....
" A propos des femmes douées pour la peinture, je connais une femme du nom d'Anastaise dont le talent pour les encadrements et bordures d'enluminures et les paysages des miniatures est si grand que l'on ne saurait citer dans la ville de Paris où vivent pourtant les meilleurs artistes du monde, un seul qui la surpasse.
Personne ne fait mieux qu'elle les motifs floraux et décoratifs des livres et l'on estime tant son travail qu'on lui confie la finition des ouvrages les plus riches et les plus fastueux.
Je le sais, par expérience, car elle a peint pour moi certaines bordures qui sont, de l'avis unanime, d'une beauté sans commune mesure avec celles exécutées par les autres grands maîtres !'
Christine de Pisan (Bio p. 84) "La Cité des Dames"
Artiste faisant son autoportrait
Boccace - Le livre des cleres et nobles femmes - XV°
A partir du X° et jusqu’au XV° s., d’autres femmes, prennent le stylet, le pinceau, la couleur et pratiquent l'enluminure.
Nous trouvons la première enluminure qui porte un nom de femme, dans un manuscrit espagnol de l'Apocalypse, en 970 :
"Ende pintrix et Dei Aiutrix et Frater Emeterius Prêtre".
Autoportrait sur bois
Boccace - Le livre des cleres et nobles femmes - XV°
Au cours du Moyen-âge ancien, l’enluminure des manuscrits est une activité à laquelle se consacrent aussi bien les moines que les nonnes. Bien que quelques noms d'artistes percent au cours de cette époque, la très vaste majorité de ceux-ci ou celles-ci reste inconnue. Dans toute l’Europe on dénombre une dizaine d’artistes femmes qui enluminent des manuscrits ou illustrent des codex. et dont le nom est connu ( leur œuvre a souvent disparu).
Nous pouvons citer toutefois, Ende, Guda (nonnes du Xe siècle et XII° s.) ou encore Claricia, laïque employée dans un scriptorium de Bavière.

Ces femmes bénéficièrent de l'environnement favorable des couvents, lieux d'apprentissage et de culture, et sans doute choix le plus judicieux pour une femme "intellectuelle"de l'époque.
Les couvents offrent une alternative acceptable au mariage. Une dot étant là aussi exigée, les nonnes sont en général issues des classes supérieures ou de la bourgeoisie. Le couvent est également le meilleur moyen de recevoir une bonne éducation permettant aux femmes de se rendre utiles en dirigeant des écoles et des hôpitaux, en gérant les terres du couvent ou en s'occupant des nécessiteux.
Artiste préparant une fresque
Boccace - Le livre des cleres et nobles femmes - XV°
L'enluminure, devenue au XIII°s. une activité laïque, reste une activité où les femmes peuvent œuvrer, le plus souvent aux côtés de leurs pères ou maris ( telles les filles de Maître Honoré et de Jean le Noir, célèbres enlumineurs de l'époque)
Femme sculpteur
Boccace - Le livre des cleres et nobles femmes - XV°
Mais les femmes sont aussi artistes dans bien d'autres domaines: elles sont aussi musiciennes, troubadours professionnelles, et écrivent ou éditent des livres.

Femme troubadour
Livre d'heures- Fance - 1500-1525
Les artistes du Moyen Âge, furent oubliés par leurs consoeurs de la Renaissance, au profit de celles de l'Antiquité.
La joueuse de Harpe
Boccace - Le livre des cleres er nobles femmes - XV°

Femme écrivain
Bocece- Le livre des femmes nobles er renommées - XV°.
http://ocre-bleu.over-blog.com/article-les-femmes-artistes-du-moyen-age-a-l-enluminure-60665582.html
-

L’église Saint-Martin de Moings fut donnée à
l’abbaye Saint-Etienne de Baignes (Charente)
à la fin du XIe siècle.
La nef, qui semble dater du XIe siècle, est la partie la plus ancienne de l’édifice. Non divisée, elle est couverte d’une charpente et ouvre par un portail très simple.
Le cœur et le clocher ont par contre fait l’objet d’une reconstruction très soignée au XIIe siècle.
L’abside en hémicycle, voûtée d’un cul de four est éclairée par trois fenêtres en plein cintre pourvues de colonnettes.
Le clocher, qui se dresse en avant du cœur sur une travée couverte d’une coupole sur pendentifs, est d’une architecture exceptionnellement riche. La tour est d’abord percée de douze baies à colonnettes, dont quatre se trouvent dans les angles abattus. Par devant, il a été plaqué une arcature ininterrompue reposant sur de colonnettes alternativement simples et jumelées.
On remarque à l’intérieur de l’église, sur les murs nord et sud ainsi que dans l’abside, un ensemble de graffitis représentant des cavaliers armés partant au combat, des éléments d’architecture et un paon. Ces graffitis paraissent dater du XIIe siècle.
http://www.eglises-en-charente-maritime.fr/moings%20eglise%20saint-martin.html
L'église Saint-Martin est une église romane dont la nef serait de la fin du XIe siècle. L'abside semi-circulaire est éclairée par trois ouvertures à colonnes-contreforts.
En avant du chœur le clocher surmonte une coupole sur pendentifs.

Ce clocher carré à pans coupés est percé de douze fenêtres à double colonnade dont quatre sont dans les angles. Ces 60 colonnes sur un seul étage ceinturent le clocher.

Les graffiti du XIIe siècle de l’église de Moings ont été découverts en 1953 lors d'une restauration. Ils paraissent être l'œuvre d'un seul graveur qui les auraient faits juste avant la pose de l'enduit du décor peint au XIIe siècle.

Sur la paroi nord les dessins sont très variés, avec des cavaliers, des paons, des écussons des fleurs de lys.

Sur la paroi sud c'est une scène de guerre, l’affrontement de deux groupes de cavaliers, sortant de deux édifices fortifiés.

Lors de cette même restauration en 1953 les armoiries des seigneurs patrons-fondateurs ou haut-justiciers qui avaient été recouvertes d'une couche de chaux pendant la Révolution ont été redécouvertes.


Elles sont sur trois hauteurs.
Sur la partie haute, sous une couronne de marquis ce sont les armes des héritiers des Poussard, les du Chilleau (d'azur à trois moutons d'argent) et celles des Montullé (gueules au chevron d'or avec trois étoiles) ornées du ruban et de la croix de Saint Louis.
LES LITRES
Les seigneurs patrons-fondateurs ou hauts-justiciers avaient le droit de faire peindre leurs armoiries au-dedans et au dehors des églises et chapelles construites sur le territoire de leur seigneurie.
Ce droit était notamment exercé au moment des obsèques du seigneur ou d’un membre de sa famille. Les armoiries étaient alors peintes sur une bande noire. C’est ce qu’on appelle une litre (du bas latin « litra », qui signifie lisière, bordure). Pendant la révolution, les armoiries furent détruites ou recouvertes d’une couche de chaux. A Moings, au cours des travaux de restauration de 1953, apparurent trois litres à trois niveaux différents.Ces blasons illustreraient le mariage d'une Montullé avec un baron de Moings en 1774.

Sur les parties du milieu et du bas, ce sont trois litres, des armoiries peintes sur une bande noire lors des obsèques, du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle, avec à gauche les armes des Poussard d'Anguitard, à droite celles des Saint-Gelais, le tout sous une couronne ducale et sur le niveau inférieur, l'une en fasces de gueules, constitue les armoiries des Sainte-Maure, seigneurs de Jonzac,
l'autre est en chef de gueules.

Le château de Moings a subi de nombreuses transformations. Une longue aile de dépendances est percée d'une porta cochère du XVIIe siècle et flanquée de deux pavillons dérasés.






clichés sources
http://animulavagula.hautetfort.com/album/les_graffiti_de_marsilly/page1/
Repérés pour la première fois en 1953 lors de travaux, les graffiti de l’église représentent une sorte de bande dessinée médiévale qu’on peut découvrir dans l’église de Moings. Réalisés avant la pose de l'enduit du décor peint au XIIe siècle, ils auraient été réalisés par un seul et même graveur. S’agit-il d’un apprenti qui, pour tuer le temps, s’amusait à créer des scènes de combats ?

Cette tapisserie de pierre, dont les personnages ne sont pas sans rappeler la bataille d‘Hastings, offre des gravures variées avec des cavaliers en armures, des écussons, des forteresses, mais aussi des paons et des fleurs de lys. Sur la paroi sud, deux groupes de soldats s’affrontent. Tout un univers !
« Ces dessins remontent vraisemblablement à 1130, 1140. Ils forment une composition iconographique qui ne semble pas avoir d’équivalent ailleurs. Elle est unique » estimait l’historien Jean Glénisson. Une mise en valeur a été réalisée dans les années 90. Plongeant dans une époque reculée, le visiteur imaginatif peut rechercher de quels châteaux ou mottes foédales des environs (Pons, Jonzac, Archiac ?) arrivaient les soldats…
A voir également les armoiries des seigneurs du lieu. « Sur la partie haute, sous une couronne de marquis, ce sont les armes des héritiers des Poussard, les du Chilleau (d'azur à trois moutons d'argent) et celles des Montullé (gueules au chevron d'or avec trois étoiles) ornées du ruban et de la croix de Saint-Louis. Sur les parties du milieu et du bas, ce sont trois litres (armoiries peintes sur une bande noire lors des obsèques, du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle), avec à gauche les armes des Poussard d’Anguitard, à droite celles des Saint-Gelais. Sur le niveau inférieur, l'une en fasces de gueules constitue les armoiries des Sainte-Maure, seigneurs de Jonzac » expliquent les spécialistes.
Pour les journées du patrimoine, une visite s’impose dans ce village pittoresque, proche de Jonzac.Article de Madame Nicole BERTIN, Journaliste
http://nicolebertin.blogspot.fr/2012/09/les-fameux-graffiti-de-leglise-de-moings.html

BLOG MEMOIRE des MURS
http://www.memoiredesmurs.com/themes.html

-
Le Chantier Médiéval de Guédelon:
un livre d'histoire vivant
Guédelon, une idée originale :
Construire dans l'Yonne, en Bourgogne, un Château Fort avec les matériaux et selon les méthodes du 13è siècle.
Dans un site naturel d'exception, au cœur de la forêt poyaudine (région de la Puisaye), 50 ouvriers relèvent ce défi hors du commun.Le charretier et son cheval
Chantier Médiéval de GuédelonSitué en Puisaye ( sur la commune de Treigny), le Chantier Médiéval de Guédelon permet d’assister à la construction d’un Château Fort, dont les travaux sont prévus sur 25 ans. (début des travaux en 1997)
La visite guidée du Chantier propose l’observation et l’explication des techniques de construction et de utilisation des matériaux employés au XIIIème siècle.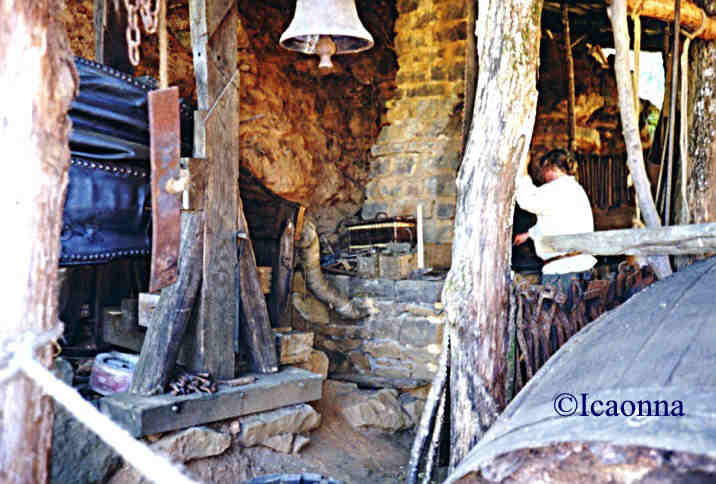
La forge de Guédelon
Chantier Médiéval de Guédelon
A découvrir, dans une « ambiance médiévale » un cinquantaine d'ouvriers (oeuvriers):
►les carriers, les tailleurs de pierre, les maçons : extraient, travaillent et assemblent la pierre de Guédelon, le grès ferrugineux.
►les bûcherons, les charpentiers : exploitent et travaillent le bois de la forêt de Guédelon pour produire les échafaudages, coffrages, portes et outils nécessaires.
►les charretiers, les potiers, les cordiers, les vanniers, les forgerons produisent les objets nécessaires à la vie de tous les jours.
►A voir également le village avec les loges des oeuvriers, les écuries, les animaux d'élevage (moutons, chèvres, basse-cour...)La loge du vannier
Chantier Médiéval de GuédelonDiaporama du Chantier Médiéval de Guédelon :
Photos des années 2001 à 2004 (Photos © Claude RICHARD)



Le diaporama du chantier médiéval de Guédelon montre l'évolution des travaux de construction du Château Fort de Guédelon de 2001 à 2004. Les photos présentent des vues générales du chantier, la cour du Château, la Tour de la Chapelle, la Tour d'angle et la Tour Maitresse d'un diamètre de 12 mètres, qui atteindra la hauteur de 30 mètres.
Adresse du Château de Guédelon :
Chantier médiéval de Guédelon
D955 89520 TreignyPour en savoir plus sur Guédelon, visitez le site Internet officiel :
TED LE FORGERON
HELOISE LA POTIEREDiana à l'atelier pavement

LOUIS, le GUIDE

YVON, allume le feu le matin, la journée peut commencer.
Hommes de pierre


CLEMENT, tailleur de pierre
EUGENE, compagnon tailleur de pierre
JEAN-PAUL, le carrier

JOEL, qui fabrique un tour..
PHILIPPE
JEAN-FRANCOIS
PASCAL
Hommes de BOIS

JEAN NOEL, bucheron

FRANCK, charpentier
NICOLAS, charpentier
ROGER, essarteur

JEAN MICHEL, essarteur.
THIERRY
THIERRY, essarteur

STEPHANE, charpentier
LAETITIA, qui s'occupe des beaux chevaux
LUDOVIC, maitre équestre, qui s'occupe des beaux chevaux de travail
MERCI à tous ces MAITRES COMPAGNONS, CES BATISSEURS, MERCI à TOUS CES ARTISTES.
Les compagnons de Guédelon 1 2 3 4
Faites connaissance avec quelques compagnons oeuvriers qui bâtissent le château
Un clic sur une vignette ouvre en grand format dans une page indépendante.
Voir le site officiel http://www.guedelon.orget <renseignements cliquez
Mon but : faire connaître le chantier Guédelon et vous donner l'envie de rejoindre ces fous qui ont entrepris de réaliser un château fort au XXI°
Les photos prises lors de mes séjours en tant que participant peuvent être différentes de ce que vous verrez car le chantier est en perpétuelle évolution.
cliquer sur l'étiquette blanche
Nouveautés - Ne pas manquer
-

Histoire de la Normandie NORMANDIE
On trouve des traces d'habitats dans la région depuis plus de 5 000 ans.

Pont mégalithique, construction datant de la préhistoire, sur la rivière Varenne, commune Le Châtellier, près de Domfront, Orne, Basse Normandie
Nous savons peu de choses de ces peuples, si ce n'est qu'ils vont devenir, à l'âge du bronze, des experts dans la fusion du cuivre et de l'étain.

Ce sont les Celtes qui vont envahir, habiter et organiser le pays derrière les
tribus Véliocasses, Lexoviennes, Calètes et Aulerques Eburovices.

Chateau de Pirou, XIème siècle
Auguste incorpore le pays à la Lyonnaise.
La réforme de Gratien redonne aux cités leur frontières historiques et permet aux villes de se développer.
Le christianisme arrive avec St-Nicaise au IIIe siècle, qui va évangéliser le pays.
Les Francs vont réorganiser la région en pagus.
Riche et fertile, ce dernier est dévasté au IXe siècle par les invasions normandes et ne connaît plus la paix jusqu'à l'établissement à demeure des Normands (Vikings).

Charles le Simple, cède à Rollon, chef des hommes du nord, les terres de haute Normandie. Lors du traité de Clair-sur-Epte, il fait de Rollon l'homme du roi après sa conversion au Christianisme. Profitant des luttes internes franques et celles contre la Bourgogne, les chefs normands
(Rollon et Guillaume) en profitent pour élargir leurs possessions à la Basse-Normandie et constituent une unité stable. Ils sont fait ducs de Normandie.

Après quelques révoltes internes (dont celle de Riulf, matée par Guillaume Longue-Epée), la Normandie retrouve son unité. Hugues le Grand est confirmé dans son duché par Louis IV.
Après maints conflits, le traité de Gerbevoy en 945 instaure une période de paix en Normanie. Par la suite, une politique d'alliance avec les capétiens devient la tradition normande, jusqu'à Guillaume le Conquérant.
Manoir de la Saucerie, La Haute Chapelle, près de Domfront, Orne, Basse Normandie, France

Manoir de la Saucerie, La Haute Chapelle, près de Domfront, Orne, Basse Normandie, France
Les ducs de Normandie favorisent la féodalité et placent à la tête des comtés (anciens pagus) des membres de leur famille.

L'Eglise profite de l'essor de la puissance ducale. Rollon s'applique à doter les églises, à reconstituer et instruire le Clergé, tout en soumettant l'Episcopat. Sous Guillaume le Conquérant, la Normandie bénéficie d'un renouveau économique continu.

Guillaume le Conquérant reprend la politique centralisatrice de ses prédécesseurs. Omniprésente, l'autorité du duc assure la sécurité du pays et l'unité du duché.

La tour de Bonvouloir, Juvigny-sous-Andaine, Orne, Normandie
Après le mariage avec Mathilde de Flandre, puis la conquête de l'Angleterre en 1066, la puissance normande inquiètera les rois de France.
La succession de Guillaume marque une crise de l'autorité ducale, laissant la Normandie tomber en anarchie.

Le conflit entre Robert Court-Heuse (héritier de la Normandie) et Guillaume-le-Roux (héritier de l'Angleterre) durera neuf ans. Henri Beauclerc, troisième frère et héritier de l'Angleterre gagnera la Normandie après la bataille de Tinchebray en 1106 et rétabliera l'autorité ducale, ainsi que l'empire anglo-normand.

L'empire va passer dans la mouvance angevine avec Geoffroy-le-Bel. Henri II se consacre à la restauration de ses états et poursuit la politique d'octroi de libertés communales, dont Evreux, Bayeux, Alençon, Fécamp bénéficieront.

En 1197, Richard Coeur de Lion construira la forteresse de Château Gaillard pour protéger la Normandie des attaques du roi de France, avec qui il est en lutte permanente. Philippe Auguste arrivera finalement à ses fins avec l'avenement de Jean-Sans-Terre comme duc de Normandie, qui est incapable de résister au roi de France.

La "Paix Française" confirmera les privilèges municipaux, respectera les institutions centrales et locales, ainsi que le droit coutumier, et rattachera la Normandie au domaine économique français.

La Guerre de Cent-Ans, entraine le pillage et l'occupation temporaire de la Normandie, à partir du débarquement de St-Vaast-la-Hougue d'Edouard III.

Elle est progressivement reconquise par Du Guesclin et retrouve pour un temps la paix.
Henri V d'Angleterre enlève Rouen en 1419 et soumet toute la Normandie.
La reconquête française du pays se fera de 1436 à 1450 par Charles VII.
Louis XI fait déclarer la province solidaire du domaine royal en 1468 et un parlement avec les mêmes privilèges que celui de Paris est créé en 1515.

Dès lors, l'histoire de la Normandie se confond avec celle de la France.
En 1790, la province a formé cinq départements
(Manche, Calvados, Orne, Eure et Seine-Inférieure).
En 1944, après quatre années d'occupation nazie, la Normandie sera le théatre du débarquent des troupes alliées pour libérer la France.
Les Normands paieront un lourd tribut pour cette liberté retrouvée.
..Dona Rodrigue...